Paris-Delhi-Bombay…
L’Inde vue par des artistes indiens et français
Du 25 mai au 19 septembre 2011 - Galerie 1, niveau 6
Nalini Malani, Remembering Mad Meg, 2007-2011
Vidéo / théâtre d’ombres
Introduction : art et société indienne
Bien qu’étant aujourd’hui la plus grande démocratie du monde et un acteur économique émergent de premier plan, l’Inde reste très mal connue du public français, et sa scène artistique, pourtant effervescente depuis deux décennies, plus encore. Avec l’exposition Paris-Delhi-Bombay …, le Centre Pompidou, grâce à une collaboration inédite entre l’Inde et la France, invite à découvrir la société indienne à travers les regards croisés d’artistes plasticiens indiens et français.
Vue de l’exposition, Centre Pompidou, 2011
Au centre de la salle documentaire, Tara, sorte d’icône de la femme indienne contemporaine, de Ravinder Reddy
L’espace de l’exposition est organisé autour d’une salle documentaire circulaire, au centre de laquelle s’impose la tête monumentale de Ravinder Reddy, Tara, sorte d’icône de la femme indienne contemporaine. Textes, photographies, reportages télévisés, documents graphiques, affiches rappellent les grandes dynamiques, les éléments structurants et les événements marquants qui font l’Inde d’aujourd’hui depuis l’indépendance en 1947. Six thèmes sont développés : politique, urbanisme et environnement, religion, foyer, identité et artisanat. Ils sont issus d’un conséquent travail mené sous l’égide des commissaires, Sophie Duplaix et Fabrice Bousteau, par un groupe de recherches, sociologues, politologues, philosophes ou anthropologues des deux pays, et des historiens de l’art dont les travaux nourrissent également le catalogue.
À partir des thématiques dégagées dans cette salle centrale, le public peut rayonner ensuite dans l’espace vers des îlots identifiés grâce à des pictogrammes [voir plan ci-dessous]. Dans chaque séquence, cohabitent les œuvres des artistes indiens et français.
Parmi la cinquantaine de travaux exposés, pas moins d’une trentaine a été produite spécifiquement pour cette manifestation.
Plan de l’exposition
Architecte-scénographe : Corinne Marchand
Télécharger le plan de l'exposition (PDF, 900ko)
 Politique
Politique 
Le passé colonial, la question des frontières, les conflits et la violence sont présents dans les œuvres de beaucoup d’artistes indiens. Cristallisant tous ces aspects, la Partition de 1947 entre l’Inde et le Pakistan, au moment de l’indépendance, figure parmi les sujets récurrents, au cœur de leurs préoccupations. Evénement majeur de l’histoire de l’Inde contemporaine, elle a eu d’importantes répercussions politiques et sociales, mais également, comme le souligne Rita Kothari dans le catalogue de l’exposition1, émotionnelles et intimes chez les individus et les familles qui l’ont vécue.
Ainsi en est-il de Nalini Malani, dont l’œuvre Remembering Mad Meg fait sans doute partie des plus marquantes de l’exposition.2
Nalini Malani, Remembering Mad Meg, 2007-2011
Vidéo / théâtre d’ombres
Trois vidéos d’animation, sept cylindres en plastique, Lexan peints, armatures d’acier, lumière, moteurs, son
Trois projections vidéo, sept cylindres en plastique peints, armatures d’acier, lumière, moteurs, son… Autant d’ingrédients qui forment un inquiétant théâtre d’ombres, d’images et de sons entremêlés, un environnement en hommage à Mad Meg, personnage issu du tableau de Pieter Bruegel, Dulle Griet (ou « Margot la folle »). Dans la peinture du maître flamand, la figure féminine traverse, casquée, un champ de ruines peuplé d’étranges créatures où des femmes affrontent des soldats. Ainsi, pour Nalini Malani, Mad Meg incarne-t-elle les femmes engagées, militantes, combatives, qui font évoluer l’Inde contemporaine.
Telles des lanternes magiques portant sur leurs flancs les images éparses peintes par l’artiste : poissons, armes à feu, morceaux de corps humains, créatures fantastiques, scènes mythologiques… les sept cylindres sont mus par une rotation régulière qui donne à l’installation, avec ces « moments » toujours recommencés, une dimension d’éternité et une intensité hypnotique. Des projections vidéo les traversent et brouillent définitivement les repères, venant nourrir des rencontres inattendues entre les images, comme celles qui traversent et fracturent notre esprit. Le son alterne voix, cris humains et animaux, chants et rythmes endiablés de percussions, portant à son comble le sentiment d’« inquiétante étrangeté » que produit cette œuvre3. Faisant ressentir avec force des sentiments intimes de violence et de destruction, elle fait écho aux conflits communautaires, religieux et politiques que vit l’Inde aujourd’hui, et dont les femmes sont les premières victimes.
Alain Declercq, Borders/Pakistan, 2010
12 500 tirs sur panneaux de mélaminé noir, 280x621 cm
Sur un mode complètement différent, presque selon une démarche inverse, Alain Declercq s’est lui aussi attaché à cette question de la Partition. Comme la plupart des artistes français invités, il s’est rendu en Inde. Là-bas, il a exploré la zone frontalière avec le Pakistan, et réalisé de nombreuses photographies afin de parvenir à en saisir une image. Revisitant à cette occasion son intérêt pour les rapports de pouvoir, son envie de jouer avec l’illégalité et son désir de frôler le danger dans la production de ses œuvres, il a tenté de s’approcher au plus près de la L.O.C. (Line Of Control) dans la région particulièrement sensible du Jammu-et-Cachemire. La prise de risque fait ici, comme souvent dans le travail d’Alain Declercq, partie intégrante de l’œuvre.
Pour Borders/Pakistan, il sélectionne l’un des clichés réalisés lors de cette exploration et le reproduit à l’aide de 12 500 impacts de balles sur des panneaux de mélaminé noir. « Le motif, simplifié, livre quelques clefs de lecture d’une image de frontière : un mirador, ou encore une clôture, renforçant la violence sourde qui émane de l’œuvre. »4 L’artiste dresse ainsi la silhouette obscure d’un no man’s land sous tension permanente.
 Urbanisme et environnement
Urbanisme et environnement 
Après le thème du conflit traité dans l’îlot « Politique », celui de l’environnement fournit une autre clef de lecture de l’Inde contemporaine. Le pays connaît en effet, depuis de nombreuses années, et de façon accentuée depuis la libéralisation de l’économie dans les années 1990, une croissance urbaine démesurée. Les bidonvilles parmi les plus grands au monde se multiplient, tel celui de Dharavi dont des quartiers entiers sont reconstitués dans l’exposition par Hema Upadhyay5. Les zones rurales subissent elles aussi les conséquences de la mondialisation, notamment le pillage des ressources naturelles6 et l’installation d’industries polluantes.
Les paysages périurbains qui voient le jour sont révélés dans l’installation vidéo proposée par Raqs Media Collective, tandis qu’Alain Bublex puise son inspiration dans les bricolages omniprésents qui construisent le visage si particulier de la ville indienne, notamment dans les quartiers populaires.
Raqs Media Collective, Strikes at Time, 2011
Diptyque vidéo, HD DV, son synchronisé
Depuis une dizaine d’années le collectif Raqs Media7 a contribué à mettre en place sous le nom de CyberMohalla8, en collaboration avec une ONG, des actions d’éducation alternative dans plusieurs quartiers de Delhi. Avec des artistes, des écrivains, performeurs, photographes, blogueurs ou géographes, il a construit un dispositif incitant les jeunes à développer leur réflexion et leur créativité. De cette expérience, associée à l’intérêt du collectif pour le livre du philosophe français Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires, traduit en hindi en 2009, est née la vidéo installation Strikes at Time9.
L’ouvrage de Rancière raconte comment les ouvriers qualifiés des années 1840 trompent l’ordre du temps, et notamment le cycle travail/repos qui leur est imposé, en mettant à profit la nuit pour produire des textes militants et engagés. Refusant de se considérer comme des outils de production soumis à un ordre social et politique imposé, ils reprennent de cette manière le contrôle de leur corps et de leur individualité.
Projeté sur l’écran principal de l’installation, le film a pour personnage principal un homme en tenue d’ouvrier, le visage peint en bleu. Des bribes de phrases tirées d’un journal intime rendent compte des journées de façon très sommaire, ponctuées régulièrement d’une sentence : « Tout le reste est ordinaire ». Des réflexions d’ordre philosophique émanant des artistes et quelques phrases extraites de l’ouvrage de Rancière sont intercalées. À l’image, des paysages industriels nocturnes se succèdent, ainsi que des vues de lieux de production (usines, ateliers) laissés à l’abandon.
À côté de cet écran principal, comme en aparté, un autre écran plus petit diffuse les images des pages d’un carnet de notes, traduction en hindi des textes diffusés sur le premier écran, en alternance avec celles d’une camionnette sillonnant un terrain vague. Par cette installation qui propose une méditation sur l’aliénation du travail, l’homme est invité à reprendre le contrôle de sa vie et à questionner sa présence au monde. La nuit n’est plus l’espace du sommeil réparateur mais celui de tous les possibles.
Alain Bublex, Contribution #2 (Delhi Cold Storage, notes & hypothèses [de travail]), 2010-2011 (détails)
250 photographies couleur, 20x26 cm chacune
C’est dans cet environnement construit par les hommes au fil des petites touches de leurs nécessités qu’Alain Bublex évolue. Lors de son séjour en Inde, à Delhi, il procède par prise de notes photographiques. Câbles circulant le long des murs ou au-dessus des rues, branchements de fortune, bâches tendues ou parapluies suspendus pour procurer un peu d’ombre, tables et chaises sorties dans l’espace public, autant de « détails singuliers observés dans l’enchevêtrement urbain de quartiers populaires »10 qui retiennent son attention.
Il extrait de ces images des éléments qui deviennent, par le biais de cette mise en exergue, structurants et signifiants. Enchevêtrement de câbles, parapluies suspendus, draps tendus pour faire de l’ombre, véhicules hybrides, etc. Les images ainsi produites par ordinateur, retracées en noir sur fond blanc, viennent compléter le premier panel. Enfin, dans un dernier travail de manipulation des images, et fidèle à ses travaux antérieurs, il propose une vision d’un Centre Pompidou « à l’indienne ». Des bâches sont tendues au-dessus des coursives du bâtiment, des câbles pendent au milieu des salles du musée, des cales soutiennent les socles des œuvres, une accumulation d’enseignes et d’affiches saturent l’espace d’accueil de l’exposition Paris-Delhi-Bombay… Par ces images elles-mêmes bricolées, les installations précaires des rues de Delhi viennent rendre le Centre Pompidou plus vivant, moins lisse, plus inventif, moins « institutionnel » aussi.
 Religion
Religion 
La religion, les croyances, les rites sont omniprésents dans la société indienne et marquent particulièrement les représentations que l’on s’en fait depuis la France. Dans l’exposition, cet angle d’approche a particulièrement retenu les artistes français. Les artistes indiens se font, sur ce sujet, plus discrets. Ou adoptent un regard un peu décalé, comme Riyas Komu qui a pour terrain de prédilection l’univers du football, souvent comparé dans ses logiques et dans ce qu’il met en œuvre au sein de la société, à la religion.
Riyas Komu, Beyond Gods, 2011
Bois recyclé, fer et bronze, 188x993x96 cm
Spectaculaire, tant par ses dimensions que par le travail et le savoir-faire qu’elle a nécessités, son œuvre intitulée significativement « Au-delà des Dieux » est une monumentale sculpture en bois de onze paires de jambes de footballeurs supportant un long tuyau sculpté. Entre les jambes des joueurs, des cadres en bois semblables à des écrans de télévision intègrent des têtes de joueurs français : Zidane, Anelka, Thuram…
N’appartenant pas à la culture indienne, le football tend néanmoins à s’y développer depuis quelques années, sous l’influence de la mondialisation. À la suite du Mondial de 1998, c’est par ailleurs souvent l’équipe de France, victorieuse, qui incarne aux yeux des Indiens l’identité de la France. L’œuvre de Riyas Komu est également sous-tendue par une dimension critique, évoquant ces footballeurs portés aux nues et dans le même temps stigmatisés par leurs origines. Les jambes aux proportions idéales, sculptées avec soin, portant le poids de cet étrange tuyau dont on ne sait s’il évoque une longue vue (permettant de projeter son regard au loin) ou un oléoduc (transportant les ressources naturelles, qui seraient ici le talent et l’énergie des footballeurs, souvent issus de milieux défavorisés), sont néanmoins représentées comme des « écorchés », évoquant à la fois la perfection anatomique des muscles et des tendons, la dimension mécanique attribuée au corps des sportifs, et la souffrance de la chair à vif.
Camille Henrot, Le Songe de Poliphile, 2011
Vidéo HD, son stéréo, 9’30’’
L’œuvre de Camille Henrot emprunte son titre à un mystérieux ouvrage datant de la fin du 15e siècle, Le Songe de Poliphile, sorte de récit initiatique ayant inspiré ensuite de nombreux écrivains, artistes et penseurs. Poliphile poursuit Polia, l’être aimé, à travers jardins, temples, palais, ruines antiques et forêts sauvages. Alors qu’il est sur le point de l’embrasser, Polia s’évapore et Poliphile voit que son voyage n’était qu’un songe… Voyage au cœur de l’inconscient, donc, que réalise aussi à sa manière Camille Henrot lorsqu’elle se rend, pour l’exposition, en Inde. En témoigne, en exergue de son film, la citation du psychanalyste indien Sudhir Kakar : « L’Inde est l’inconscient de l’Occident ».
L’artiste choisit d’explorer la peur, par le biais de l’animal qui l’incarne le plus intensément : le serpent. « Symbole ambivalent en Orient comme en Occident, à la fois dangereux et prophylactique, [il] incarne la pulsion de vie et de création inséparable de la peur. »11 Par le biais d’images filmées en Inde et en France, dans un laboratoire, des temples, des musées, ou chez des chasseurs de serpents, tirées aussi de films ou de dessins animés, Camille Henrot retisse les liens entre des civilisations qu’on pouvait croire éloignées. Son œuvre nous fait ainsi pénétrer au cœur d’un inconscient collectif qui, peut-être, dépasse les contingences culturelles.
 Foyer
Foyer 
La famille est, encore largement aujourd’hui, un élément structurant de la société indienne et l’un des lieux où la résistance à la mondialisation se fait la plus forte. Le maintien des traditions, même au sein des classes moyennes tendant à s’occidentaliser, est particulièrement significatif de ce phénomène, en Inde.
Le rapport à la nourriture qui recouvre les notions de pur et d’impur, la question du mariage (arrangé et régi par le dispositif de la dot), le tabou de la sexualité sont abordés dans l’exposition uniquement par des artistes indiens. Comme s’il s’agissait de domaines trop intimes, trop « réservés », et donc trop difficiles à maîtriser de l’extérieur pour que les Français s’y attèlent.
Vue de l’exposition, Centre Pompidou, 2011
À droite : Thukral & Tagra, Kingdom Come IV (Group) et Kingdom Come V (Group), 2011
Acrylique et huile sur toile tendue sur mousse
À gauche : Atul Dodiya, Mahalaxmi, 2002
Peinture émaillée sur rideau en métal, peinture acrylique, poudre de marbre sur toile, 275x183x35,6 cm
Créée par Jiten Thukral et Sumir Tagra en 2009, la fondation Thukral & Tagra s’est donné pour mission de contribuer à la lutte contre le sida en Inde, en participant à la diffusion de connaissances sur le VIH et à l’éducation sexuelle des jeunes et de leurs familles. Paradoxalement, alors que la sexualité est un sujet tabou en Inde, les images érotiques, qu’il s’agisse des représentations de divinités12 ou du Kâmasûtra13, font partie de la culture traditionnelle indienne.
Avec la liberté que permet la création artistique, Thukral & Tagra réinvestissent cette iconographie traditionnelle, la déclinent dans des couleurs pastel ou la brodent sur des rideaux, des couvertures, y ajoutant des instructions pour mettre un préservatif. Ils proposent ainsi à la société indienne de renouer avec son héritage historique, afin de pouvoir agir de façon responsable face au danger que représente le sida dans la société contemporaine, danger qu’un rejet de tout discours sur la sexualité ne fait qu’aggraver.
Les images, ludiques et joyeuses, sont loin de la pornographie à laquelle on pourrait vouloir les confiner. Elles répondent véritablement à une volonté de dédramatisation du rapport à la sexualité, fondement du travail de Thukral & Tagra.
Non loin de ces images réjouissantes, un autre visage de la société indienne contemporaine se donne à voir. Sur un rideau de fer à moitié relevé, une représentation colorée de Maha-Lakshmi, déesse hindoue de la richesse, nous sourit dans un paysage idyllique. Deux de ses quatre mains tiennent des fleurs de lotus, de la troisième jaillit du riz tandis que la quatrième semble venir vers nous dans un geste tendre. Ce store métallique est à l’image de l’un des nombreux stores de boutiques indiennes qui ornent aux horaires de fermeture les rues indiennes.
Le peintre Atul Dodiya l’utilise ici pour révéler une scène tragique, reproduction d’une photographie parue dans la presse, d’un suicide collectif, par pendaison, de jeunes femmes dont les familles n’avaient pas pu payer la dot. Cette image apparaît lorsque le store est ouvert.
La coupure de presse, magnifiée par le format (1,50x2 m environ) change ici de statut et nous assène sa terrible vérité. L’effet est encore augmenté par le contraste avec l’image de la déesse dont le visage réjoui, quand le store est entièrement relevé, reste visible. Maha-Lakshmi semble alors contempler la scène avec un sourire lointain que l’on hésite à rattacher à de la gène, à de la bienveillance, ou à la plus complète indifférence.
 Identité
Identité 
La question de la place des femmes est très présente dans la séquence consacrée au thème de l’identité, notamment dans la salle documentaire où elle est abordée à travers une série d’affiches réalisées par des collectifs indiens mobilisés pour la défense du droit des femmes. Ce thème est également traité sous l’angle des questions de genre et de sexualité, particulièrement taboues dans la société.
Ici, les œuvres de deux artistes sont intéressantes à croiser, toutes deux consacrées au troisième genre qu’incarnent en Inde les hijras14. Il s’agit de celles du Français Kader Attia et de l’Indienne Tejal Shah. « Socialement définies comme des presque femmes », invitées de façon rituelle lors des mariages et des naissances, les hijras sont d’une certaine manière reconnues comme indispensables au bon fonctionnement de la société. Leurs conditions de vie restent toutefois très précaires et difficiles. Leur nombre est estimé entre cinq cent mille et un million en Inde.
Kader Attia, Collages, 2011
Installation vidéo en trois écrans
Vidéo HD format DV, son, env. 67’
Depuis le diaporama La Piste d’atterrissage consacré à la communauté des transsexuelles algériennes exilées à Paris, réalisé en 2000, Kader Attia s’est attaché dans son œuvre à explorer ce domaine du transgenre. De façon particulièrement pertinente, il a su croiser sa démarche personnelle d’artiste avec la commande qui lui a été faite pour l’exposition.
L’installation vidéo intitulée Collages orchestre, sur trois écrans juxtaposés, une rencontre entre des transsexuelles de Paris, d’Alger et de Bombay. Accompagné dans ce projet par son amie Hélène Azera, transsexuelle française, militante et journaliste, il part à la rencontre de la communauté des hijras de Bombay. Des échanges entre elles, conjugués avec le récit de vie très émouvant de Pascale Ourbih en Algérie, naissent une évocation du transgenre qui va bien au-delà des seules questions de sexualité et une réflexion plus profonde sur les rapports entre tradition et modernité, entre Orient et Occident.
Tejal Shah, Untitled (On Violence), 2010
Triptyque multimédia
Écran vidéo,
photographie numérique sur papier Archive et texte sur panneau à LED
Non loin de l’œuvre d’Attia, les photographies réalisées par Tejal Shah semblent évoquer un univers idéalisé dans lequel des hijras posent, incarnant des personnages fantasmés. Dans cette série intitulée Hijra Fantasy, l’artiste se propose de donner vie à leurs rêves. La difficile réalité de leur existence qui, malgré une certaine reconnaissance sociale, les contraint souvent à la prostitution et les expose à la violence, perce dans l’aspect très artificiel des images ainsi produites.
En contrepoint à ces vies rêvées, l’installation Untitled (On Violence) ne laisse plus planer le doute. Au centre, une photographie montre une hijra allongée au sol dans un bois, meurtrie. Debout, un policier, dont on ne voit que les jambes et le buste, de trois-quarts, la domine et l’éclaire de sa lampe de poche. Alors qu’on pourrait imaginer qu’il s’apprête à la secourir, notre regard commence à discerner dans l’obscurité du cliché un jet d’urine, vision confirmée par le visage et le buste mouillés de la victime.
Sur le mur à droite, un écran montre le visage d’une autre hijra défigurée par les coups. Filmée, elle reste face à la caméra et ne dit rien, mais son silence est encore plus violent que des mots. Ceux-ci se retrouvent sur le mur d’en face (à gauche de la photographie). Défilant sur un panneau lumineux en lettres rouges, le récit de l’agression prend l’étrange apparence d’un message à caractère informatif diffusé dans l’espace public.
 Artisanat
Artisanat 
Après les sujets de fond traités dans les cinq premières séquences de l’exposition, le dernier, consacré à l’artisanat, pourrait sembler bizarrement décalé. Il n’en est rien. En effet, l’artisanat occupe une place centrale tant dans la société que dans le travail des artistes contemporains indiens. L’attention portée aux objets, aux matériaux, à leur fabrication et à leurs usages est essentielle dans la culture indienne, et il faudrait même dire ici dans les cultures indiennes, tant la multiplicité des arts et traditions populaires est importante dans ce pays où se côtoient plus de 600 communautés différentes15.
Sheela Gowda, Gallant Hearts, 1996 (détail)
Bouse de vache, pigments, ficelle, 304,8x38,1x20,32 cm
Sheela Gowda fait partie des artistes qui ont connu dans les années 1990, en lien avec les bouleversements que vit alors l’Inde, une mutation significative de leur pratique. Auparavant peintre figurative, elle se met à avoir recours à des matériaux issus de la vie quotidienne pour traiter de sujets liés à cette société en transformation.
Parmi les premières œuvres qu’elle réalise sur ce principe dans les années 1990, Gallant Hearts prend l’allure d’une guirlande rouge bricolée avec des bouts de ficelle et suspendue au mur. Les « cœurs » reliés les uns aux autres sont constitués de bouse de vache malaxée et enduite d’un pigment rouge, le kumkum, utilisé dans les cérémonies religieuses et appliqué notamment sur le front des Hindous. La bouse de vache, elle, loin de ce qu’elle pourrait représenter en Occident, est une matière sacrée utilisée dans les rituels, mais également dans la vie quotidienne, comme combustible ou pour enduire les sols et les murs des maisons.
La pauvreté des matériaux, alliée à leur dimension à la fois sacrée et quotidienne, confère à l’œuvre une puissance étonnante et une forte charge émotionnelle. Ces cœurs pressés entre les mains de l’artiste, écrasés et malaxés, soigneusement reliés les uns aux autres, suggèrent une violence troublante, exercée avec amour, ou une forme de réparation des souffrances endurées.
Fabrice Hyber, Monstres divins, 2011
Ensemble de peintures. Huile sur toile, fusain, collage, résine époxy, son
C’est à Fabrice Hyber que revient l’honneur de conclure l’exposition. Concevant la peinture comme une construction non restreinte à l’espace du tableau, il propose une vaste installation occupant une salle entière. Dix-sept tableaux mêlant peinture, fusain, collage et résine époxy prolifèrent sur les murs tandis qu’au centre de la pièce une accumulation de chaises en tous genres invite le spectateur à s’assoir.
Le regard qui s’attarde sur les murs voit apparaitre tout un monde à décrypter : créatures hybrides, fragments de corps humains, cartographies de corps-mondes, amas cellulaires, molécules d’ADN. L’oreille de celui qui se déplace perçoit des sons qui semblent provenir des tableaux eux-mêmes. Ici, une voix récitant la fable du bœuf et de la grenouille, là, des cris d’animaux : bœuf, grenouille, tigre.
L’installation, intitulée Monstres divins, explore ce qui relève pour nous de l’anomalie et du monstrueux et qui, en Inde, devient sacré, divin, à la manière de Shiva avec ses bras démultipliés. En même temps, par ces corps en morceaux et ces évocations de manipulations génétiques, Fabrice Hyber parle aussi des effets de la mondialisation sur le corps humain, et de l’Inde comme une réserve d’organes (ou réserve de vie ?) pour un monde occidental malade et vieillissant.
Conclusion 
Hormis la tension tradition-modernité sous-jacente à de nombreuses œuvres de l’exposition, le thème de l’hybridation y est très présent. Au fil des œuvres des artistes indiens et français, cette dynamique anime tout le parcours. Ainsi, ORLAN accueille-t-elle le visiteur avec son drapeau hybridé (Draps-peaux hybridés) mêlant les motifs indiens et français ou encore Pushpamala N. s’érige-t-elle en liberté guidant le peuple, d’après le célèbre tableau de Delacroix.
Performance de Nikhil Chopra
Dans l’exposition, Centre Pompidou, mai 2011
D’autres artistes se posent de manière différente la question de la rencontre entre les cultures. Côte à côte dans leurs espaces respectifs, Stéphane Calais et Nikhil Chopra en témoignent. L’un, refusant le voyage, s’enferme dans son atelier et propose sous le titre Inde au noir une image à la fois intime et distanciée de l’Inde, à l’encre noire sur papier. L’autre se faisant symboliquement enfermer dans l’espace d’exposition pour y dessiner, au fusain et directement sur les murs, la vue de Paris qu’il perçoit par une petite ouverture ménagée dans la cloison. Dans les deux cas, qui peuvent sembler relever de démarches opposées, ce sont des visions intérieures de l’altérité qui sont mise en scène.
Leandro Erlich, Le Regard, 2011
Installation : chambre française décorée par Jacques Grange, vidéo
Vidéo réalisée par Fabrice Launay
C’est sans doute à Leandro Erlich que l’on doit l’œuvre qui interroge le mieux la proposition de l’exposition. Son installation Le Regard recrée une chambre française au décor bourgeois, avec cheminée, moulures, lit à baldaquin, tapis et guéridon, éclairée par deux fenêtres. L’une donne sur la vue de Paris qui s’ouvre depuis la Galerie 1 du Centre Pompidou, l’autre sur une rue animée de Bombay, dont le caractère étranger nous assaille. Depuis Paris, dans un univers familier et confortable, nous regardons l’Inde de loin et sans être vus. Les artistes nous donnent des clefs, ouvrent des portes. Une partie du chemin reste à faire.
Liste des artistes de l’exposition 
Artistes de la scène indienne 
- Ayisha Abraham
Née en 1963 à Londres. Vit à Bangalore. - Sarnath Banerjee
Né en 1972 à Calcutta. Vit à New Delhi. - Atul Bhalla
Né en 1964 à New Delhi. Vit à New Delhi. - Krishnaraj Chonat
Né en 1973 à Madras. Vit à Bangalore. - Nikhil Chopra
Né en 1974 à Calcutta. Vit à Bombay. - Atul Dodiya
Né en 1959 à Bombay. Vit à Bombay - Anita Dube
Née en 1958 à Lucknow. Vit à New Delhi. - Sunil Gawde
Né en 1960 à Bombay. Vit à Bombay. - Sakshi Gupta
Née en 1976 à New Delhi. Vit à New Delhi. - Sheela Gowda
Née en 1957 à Bhadravati. Vit à Bangalore. - Shilpa Gupta
Née en 1979 à Bombay. Vit à Bombay. - Subodh Gupta
Né en 1964 à Khagaul. Vit à New Delhi. - Sunil Gupta
Né en 1953 à New Delhi. Vit à New Delhi. - N. S. Harsha
Né en 1969 à Mysore. Vit à Mysore. - Jitish Kallat
Né en 1974 à Bombay. Vit à Bombay. - Amar Kanwar
Né en 1964 à New Delhi. Vit à New Delhi. - Bharti Kher
Née en 1969 à Londres. Vit à New Delhi. - Sonia Khurana
Née en 1968 à Saharanpur. Vit à New Delhi. - Riyas Komu
Né en 1971 dans le Kerala. Vit à Bombay. - Nalini Malani
Née en 1946 à Karachi. Vit à Bombay. - Pushpamala N.
Née en 1956 à Bangalore. Vit à Bangalore et New Delhi. - Raqs Media Collective
Jeebesh Bagchi est né en 1965, Monica Narula en 1969, Suddhabrata Sengupta en 1968 à New Delhi.
Vivent à New Delhi. - Ravinder Reddy
Né en 1956 à Suryapet (Andhra Pradesh). Vit à Visakhapatnam (Andhra Pradesh). - Tejal Shah
Née en 1979 à Bhilai. Vit à Bombay. - Sudarshan Shetty
Né en 1961 à Mangalore. Vit à Bombay. - Dayanita Singh
Née en 1961 à New Delhi. Vit à New Delhi. - Kiran Subbaiah
Né en 1971 à Sidapur. Vit à Bangalore. - Vivan Sundaram
Né en 1943 à Shimla. Vit à New Delhi. - Thukral & Tagra
Nés en 1976 et en 1979 à Jalandhar et à New Delhi. Vivent à New Delhi. - Hema Upadhyay
Née en 1972 à Baroda. Vit à Bombay.
Artistes de la scène française 
- Kader Attia
Né en 1970 à Dugny (Seine-Saint-Denis). Vit à Paris et Berlin. - Gilles Barbier
Né en 1965 à Port Vila (Nouvelles-Hébrides). Vit à Marseille. - Alain Bublex
Né en 1961 à Lyon. Vit à Lyon. - Stéphane Calais
Né en 1967 à Arras. Vit à Paris. - Alain Declercq
Né en 1969 à Moulins. Vit à Paris. - Leandro Erlich
Né en 1973 à Buenos Aires. Vit entre Paris et l’Argentine. - Cyprien Gaillard
- Né en 1980 à Paris. Vit à Paris et à Berlin.
- Loris Gréaud
Né en 1979 à Eaubonne. Vit à Paris. - Camille Henrot
- Née en 1978 à Paris. Vit à Paris.
- Fabrice Hyber
Né en 1961 à Luçon. Vit à Paris. - Jean-Luc Moulène
Né en 1955 à Reims. Vit à Paris. - ORLAN
Née en 1947 à Saint-Étienne. Vit à Paris. - Jean-Michel Othoniel
Né en 1964 à Saint-Étienne. Vit à Paris. - Gyan Panchal
Né en 1973 à Paris. Vit à Paris. - Pierre et Gilles
Pierre est né en 1949 à La Roche-sur-Yon.
Gilles est né en 1953 au Havre.
Vivent au Pré-Saint-Gervais. - Philippe Ramette
Né en 1961 à Auxerre. Vit à Paris. - Soundwalk
Collectif de designers sonores fondé par Stephan Crasneanscki au début des années 2000 à New York. Vivent à New York.
Autour de l'exposition 
- Images de l’Inde. Du 25 mai au 5 septembre 2011
En contrepoint de l'exposition Paris-Delhi-Bombay …, le Forum -1 invite les visiteurs à expérimenter une autre approche de l'Inde contemporaine, complémentaire à celle proposée dans la Galerie 1. Ils peuvent découvrir dans trois espaces scénographiés par les designers Tsé & Tsé la culture numérique indienne, consulter la presse, écouter de la musique et assister à des projections en continu. Installation de l’artiste JR. - Visites commentées de l’exposition
Tous les samedis à 15h30. - Parole aux expositions
Débats-rencontres les 25 mai, 8, 22, 27 et 29 juin, 14 septembre, 18h30, Petite salle. - Film
Le Musée national d'art moderne/Centre de création industrielle consacre son rendez-vous régulier, Film, aux artistes indiens, du 1er au 29 juin tous les mercredis à 19h ou 20h30. - Films de danse
Les 2 juin, 7 juillet, 15 septembre, 20h, Cinéma 2. - Promenades urbaines
Les 18, 25 et 26 juin, de 11h à 18h. - Bolly-Bolly, ateliers pour enfants
Du 2 au 31 juillet, tous les jours sauf mardi, de 14h30 à 16h30, Atelier des enfants. - Le catalogue de l’exposition, 22,5x30 cm, 364 pages, 49,90€
- L’Album, 27x27 cm, 60 pages, 80 ill. coul., 8,50€, version bilingue (français/anglais).
- Pour en savoir plus
Pour consulter les autres dossiers sur les expositions, les collections du Musée national d'art moderne, l’architecture du Centre Pompidou, les spectacles vivants…
En français ![]()
En anglais ![]()
Contacts
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce document
Vous pouvez nous contacter via notre site Internet, rubrique Contact, thème éducation ![]()
Crédits
© Centre Pompidou, Direction des publics, juin 2011
Texte : Noémie Giard
Design graphique : Michel Fernandez
Intégration : Cyril Clément
Pour les œuvres Adagp: Paris 2011
Dossier en ligne sur www.centrepompidou.fr/education/ rubrique ’Dossiers pédagogiques’
Coordination : Marie-José Rodriguez, responsable éditoriale des dossiers pédagogiques ![]()
Références
_1 Catalogue de l’exposition, Rita Kothari, « La Partition », pp.106-107.
_2 On peut lire sur le site de l’artiste : « Malani's work is influenced by her experiences as a refugee of the Partition of India. She places inherited iconographies and cherished cultural stereotypes under pressure. Her point of view is unwaveringly urban and internationalist, and unsparing in its condemnation of a cynical nationalism that exploits the beliefs of the masses. Hers is an art of excess, going beyond the boundaries of legitimized narrative, exceeding the conventional and initiating dialogue … » www.nalinimalani.com
_3 Remembering Mad Meg a été acquise par le Musée national d’art moderne à l’occasion de l’exposition.
_4 Catalogue de l’exposition, Flora Boillot, « Alain Declercq », p.176.
_5 Etalé sur plus de 200 hectares et comptant plus de 600 000 habitants, Dharavi est le plus grand bidonville de Bombay et l’un des plus anciens d’Asie. Il a fait l’objet en 2007 d’un plan contesté de « redéveloppement », le Dharavi Redevelopment Project (DRP). Voir à ce sujet le texte synthétique de Valérie Fernando : « Au cœur de Bombay : le bidonville de Dharavi ». Sur la problématique de l’explosion urbaine, lire Le pire des mondes possibles, de l’explosion urbaine au bidonville global, Mike Davis, trad. Jacques Mailhos, La Découverte, 2006.
_6 Voir à ce sujet l’œuvre d’Amar Kanwar, The Scene of Crime, 2011 (acquise par le Musée à l’occasion de l’exposition).
_7 Jeebesh Bagchi, Monica Narula et Shuddhabrata Sengupta.
_8 En savoir plus sur le projet CyberMoallah
_9 Acquise par les collections du Musée
_10 Catalogue de l’exposition, Cédric Shönwald, « Alain Bublex», p.160.
_11 Extrait du site de Camille Henrot
_12 L’œuvre de Thukral & Tagra s’inspire notamment de la statuaire érotique des temples de Khajurâho.
_13 Connu souvent seulement pour son chapitre consacré aux positions sexuelles, le Kâmasûtra est en fait un ouvrage diffusant les clefs d’un certain art de vivre, en harmonie avec les autres et avec le divin.
_14 Lire, dans le catalogue, le texte d’Emmanuelle Novello, « Les hijras » p.126.
_15 Lire, dans le catalogue, le texte de Nandita Palchoudhuri, « L’artisanat en Inde », p.130.


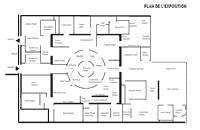



![Alain Bublex, Contribution #2 (Delhi Cold Storage, notes & hypothèses [de travail]), 2010-2011](photos/07-alain-bublex-contribution-2-delhi-cold-storage-2010-2011-200x156.jpg)
![Alain Bublex, Contribution #2 (Delhi Cold Storage, notes & hypothèses [de travail]), 2010-2011](photos/08-alain-bublex-contribution-2-delhi-cold-storage-2010-2011-200x156.jpg)









