Parcours
![]() Dossiers pédagogiques – Collections du Musée
Dossiers pédagogiques – Collections du Musée
Parcours
LE CORPS |
| René Magritte, Les Marches de l’été, 1938 © Adagp, Paris 2006 |
REPRÉSENTER LE CORPS
Défigurer
Fragmenter
Hybrider
LE CORPS À L'ŒUVRE
Le corps en action
Traces et empreintes
Le trait et la pulsion
Un espace du toucher
LE CORPS SUPPORT DE L'ŒUVRE
Le Body-art
Changement d’identités
CORPS ET EXPERIENCE DE L'ESPACE-TEMPS
Traverser la couleur
Éprouver la durée
La menace d’effondrement au centre de la perception de l’œuvre
L’expérience du
labyrinthe
Dépasser les limites apparentes de la perception
La représentation du corps est intimement liée à l’art occidental, à tel
point que certains critiques n’hésitent pas à soutenir que, même sous sa forme
la plus abstraite, la peinture ne serait que représentation du corps. Les mystères
du Verbe qui se fait chair, dogme catholique de l’Incarnation, ayant alimenté pendant
des siècles la question de la Figure et de son corrélat, l’infigurable.
Or,
ce signifiant premier des arts plastiques, d’abord soumis
aux canons esthétiques liant beauté, harmonie et idéal, est réinterrogé à plusieurs
reprises après la Renaissance et de manière éclatante en 1863 par l’Olympia de
Manet.
Substituant le nu réaliste aux images idéalisées, l’Olympia est
le premier tableau par lequel le scandale arrive. La modernité est caractérisée par le caractère polémique et subversif des œuvres.
De la révolution cubiste à l’art brut, en passant par Giacometti et Bacon
on assiste à une véritable remise en cause de toute idée de beauté, de vraisemblance
et de proportion. Disloqué, défiguré, géométrisé, stylisé, le corps traverse
et ébranle la représentation picturale et sculpturale au XXe siècle.
Mais, s’affranchissant même de la représentation, il
se donne à voir comme présence, trace tangible du corps de l’artiste à l’œuvre
dans les drippings de Pollock et dans les empreintes réelles des
corps-pinceaux des modèles de Klein, jusqu’aux extrêmes de l’art corporel
où l’artiste met en jeu son propre corps, le soumettant à des épreuves sensibles à la
limite du supportable.
Faisant appel de plus en plus à la participation du spectateur, à l’enseigne
d’une expérience sensible incluant l’espace et le temps, il est à l’œuvre dans
les installations, le Land art, les vidéos de Bill Viola par
exemple, dans les profondes immersions dans la couleur que demandent les toiles
de Newman ou de Rothko, ou dans la singulière relation à la durée qu’instaurent
les œuvres d’Opalka.
C’est un parcours des collections du Musée national d’art moderne, à l’enseigne des transformations de ce sujet majeur des arts plastiques au XXe siècle, que propose ce dossier.
En même temps que s’éloigne l’image de l’ancienne figure du monde dans les événements tragiques du XXe siècle - guerres mondiales, massacres, génocides, défiant la confiance en l’homme et dans le progrès cher au XIXe siècle -, une importante révolution plastique se met en place. Les artistes, ébranlant les codes figuratifs traditionnels, s’attaquent à la représentation humaine, pour en donner une image disloquée, géométrisée, déformée, défigurée.
Cette révolution plastique est accompagnée d’une remise en cause philosophique de la pensée cartésienne et de la naissance de la psychanalyse, abolissant l’unité du sujet conscient, pour révéler un sujet clivé entre le « moi » et les différentes instances inconscientes.
DÉfigurer

![]() Pablo Picasso, Deux Femmes sur la plage
Pablo Picasso, Deux Femmes sur la plage
(Femmes devant
la mer), 16 juin 1956
Huile sur toile, 195 x 260 cm
Ce tableau est le dernier du cycle des Baigneuses sur la
plage. Le corps humain traité de manière
structurée et géométrique fait penser à la série des Femmes
d’Alger d’après Delacroix, que Picasso
avait réalisée l’année précédente. Les corps féminins, ici monumentaux, semblent
se plier aux exigences du format qu’ils dépassent largement.
Surfaces planes
et volumes s’imbriquent dans l’espace, et la
peinture dialogue avec la sculpture,
selon l’habitude de Picasso de passer indifféremment de l’une à l’autre.
Les détails des visages, le motif du miroir à la main où se regarde la femme
de gauche, se subordonnent à la puissante structure d’ensemble. La couleur
elle-même, réduite à l’essentiel, détache les deux nus ocre-rouge du fond
bleu pâle. Tandis que la figure de gauche dresse son torse à la verticale,
l’autre s’incurve, prolongeant ce mouvement dans le cou qui se baisse pour
finir dans le rectangle du bras.
Même si ce tableau est d’époque plus tardive, la multiplication
des plans - fruit de l’éclatement du point de vue -, ainsi que la simplification
des volumes et la dépersonnalisation de la figure sont typiquement cubistes.
S’intéressant à la représentation
du corps humain, Dubuffet y revient à plusieurs reprises. Notamment en 1950-1951,
avec la série des Corps
de dames, il se mesure au genre le plus
sacré de la peinture occidentale : le nu féminin.
Il dépouille la figure humaine de ses plus chères prérogatives :
ordre, beauté, symétrie. Il aplatit les formes qui se confondent dans la matière. « Changés
en galette, aplatis au fer à repasser », selon ses dires, les corps sont
transformés en des champs ouverts de matière chaotique, juste un peu cernés
par de lointains et vagues contours. Toute profondeur est abolie. L’espace
pictural coïncide avec la surface du support.
Derrière la monstruosité des corps représentés se cache néanmoins
un propos, d’ordre philosophique : montrer que le corps demeure plus complexe
qu’on ne croit, donnant à voir une vision organique de la machine humaine,
comme vue de l’intérieur.
Le peintre américain William de Kooning est subjugué par ces
peintures présentées à New York en 1951. Il s’en inspire pour élaborer ses Womens.

![]() Jean Dubuffet, Le Métafisyx, 1950
Jean Dubuffet, Le Métafisyx, 1950
Huile sur toile, 116 x 89,5 cm
Cette œuvre dérange. C’est la première et insistante constatation
qu’on peut faire à son sujet. On ne peut pas lui trouver le côté ludique et
drôle de son Olympia (1950) ni la bonhomie
d’autres figures féminines réalisées précédemment, Terracotta la
grosse bouche, 1946, par exemple.
Ce qui frappe d’abord c’est la couleur, faisant massivement « corps » avec
la matière picturale, lourde, épaisse. Cette couleur évoque celle de l’or,
et confère à la silhouette féminine un caractère d’icône ou plutôt d’idole
sacrée. Pourtant c’est à une désacralisation de la représentation du nu
féminin que l’on assiste ici.
La figure s’étale immense, prenant largement possession de
l’espace, la tête, de taille réduite, est déjà l’annonce d’un crane. Appel à la
dimension mortelle, à l’être-matière-finie ; femme rime ici avec mère, mater,
materia. Les écrivains au XXe siècle ont
largement insisté sur cette dimension de la femme, « cette mère qui nous
donne la vie mais pas l’infini » de Beckett, ou alors «ces femelles
qui nous gâchent l’infini » de Céline ou de Joyce.
Le titre au masculin
n’arrête pas d’intriguer, un titre qui
est un curieux néologisme, formé par le mot métaphysique, le mot sphinx qui
se lit entre les syllabes, et autre chose encore car, avec ironie, Dubuffet
change les consonnes et déstabilise toute lecture univoque de l’œuvre
par son titre.
Le XXe, siècle qui s’est surpassé en massacres, tortures et
horreurs, trouve dans l’artiste irlandais son « chroniquer » qui
en éprouve, à travers une peinture de corps disloqués et devenus chair, toutes
les convulsions. Les séries des crucifixions, des papes d’après Velazquez,
les portraits de ses amis ou d’hommes d’affaires, l’humanité entière semble
se tordre et se vomir elle-même dans l’espace ambigu de ses toiles, où des
lignes - diagonales, verticales, courbes - et des fonds - où la peinture claire
s’étale uniformément - délimitent l’espace de la mise en scène terrible des
corps.
Au sujet de la réception de ses œuvres, Bacon souhaite qu’elles
puissent agir : « directement sur le système nerveux ». Il est
vrai que, comme l’a souligné Didier Anzieu, le spectateur reçoit les toiles
de Bacon « comme un coup porté au creux de son âme ».

![]() Francis Bacon, Trois personnages dans une pièce, 1964
Francis Bacon, Trois personnages dans une pièce, 1964
Triptyque, huile sur toile, chaque panneau 198 x 147 cm
La construction du tableau en triptyque est une constante
chez Bacon depuis 1944, année dans laquelle il peint Trois études de figures
au pied d’une crucifixion. Lié à l’héritage
de la grande peinture religieuse, le triptyque s’apparente aussi, chez lui, à la
succession d’images propre au cinéma. Ce que l’artiste cherche c’est le rapport, la
mise en relation de plusieurs sensations, la sensation n’existant
pas isolée, pour lui.
Bacon a toujours peint à partir de modèles réels, de photos
ou de photos de tableaux.
Les figures ici représentées, une pour chaque panneau, sont : à gauche, George Dyer, avec qui Bacon se lie de 1964 à 1971, année de la mort de Deyer ; à droite, probablement Lucian Freud, peintre anglais ; et, au centre, Bacon lui-même, la bouche tordue en un cri. Malgré les déformations que le peintre fait subir à l’image, on reconnaît chaque modèle : « Je voudrais, dans un portrait, faire de l’apparence un Sahara, le faire si ressemblant bien qu’il contienne toutes les distances d’un Sahara », affirme-t-il.
Les corps nus baignent, dans un espace dépouillé, sur une
plate-forme ellipsoïdale qui semble les aspirer dans un mouvement qui, des
corps, se transmet à l’espace. Prolongement obscène du corps de Dyer, une cuvette
de wc blanche est comme le lieu où la figure s’évacue d’elle-même. L’athlétique
silhouette de Lucian Freud vrille dans l’espace qu’elle traverse comme un projectile.
De
dos, de face, de profil, c’est l’ordre dans lequel les
corps se présentent ici. « J’espère être capable de faire des figures
surgissant de leur propre chair (…) et d’en faire des figures aussi poignantes
qu’une crucifixion », avoue l’artiste. Ces figures peintes par Bacon ne
peuvent pas ne pas faire penser aux personnages
de Samuel Beckett, le grand écrivain irlandais, son contemporain. Dans ses
romans ainsi que dans son œuvre théâtrale Beckett met en scène des personnages
qui ne sont plus que des corps qui se défont, rampent, stationnent, s’expulsent
d’eux-mêmes. Jusqu’à ne plus être, dans le texte, qu’une
voix qui rejoint le cri qui nous regarde des peintures de Bacon. « J’ai
voulu peindre le cri plutôt que l’horreur » affirme, en effet, l’artiste.
Fragmenter
Selon les lois canoniques de la représentation, l’artiste
visait l’expression, le trait qui caractérise une personne dans sa singularité.
Le
processus de fragmentation de l’image, renvoyant au morcellement
du corps humain, a été souvent utilisé par les artistes du XXe siècle, pour
exprimer l’éclatement de la perception et du moi du sujet moderne.
Ce processus participe de la pulsion destructrice par excellence,
que Freud appelle thanotos, et qu’il
oppose à eros, ou pulsion de
vie. Ces œuvres évoquent un espace inquiétant, d’avant le « stade du miroir »,
moment premier que la psychanalyse situe à la fin de la première année de vie,
où le nourrisson ne percevant jusqu’alors de son corps que des morceaux épars
en proie aux pulsions, se projette dans l’image du miroir. Moment primordial
où convergent, selon Jacques Lacan, la dimension du réel, de l’imaginaire et
du symbolique, car c’est grâce à la parole de l’autre que l’enfant se projette
dans l’image spéculaire.
Dans ces œuvres, au contraire, le corps n’est qu’un agrégat de détails nets, n’arrivant pas à faire
un. Elles nous donnent à voir le multiple,
l’éclaté ; au spectateur donc de reconstruire les nombreuses acceptions
imaginaires et symboliques de l’image éclatée, ou de se perdre dans l’opacité d’un
tel miroitement.

![]() Alberto Giacometti, Table (La table surréaliste), 1933
Alberto Giacometti, Table (La table surréaliste), 1933
Plâtre, 148,5 x 103
x 43 cm
Conçue pour être un meuble, cette sculpture de sa période surréaliste, dont le principe repose sur l’association étrange d’objets qui s’y trouvent réunis, exerce sur le spectateur un sentiment qui s’apparente de l’inquiétante étrangeté. La main coupée, la tête de femme en partie voilée et dont le voile se poursuit dans le vide évoquent, par métonymie, un corps absent de la scène de la représentation. Le curieux polyèdre, en équilibre instable sur le bord de la table, contrastant avec les autres éléments de la sculpture qui restent essentiellement figuratifs, ajoute du mystère à la composition. Présences sorties de l’inconscient qui renvoient à un moi archaïque, non encore délimité. C’est à un retour à ce stade primitif du sentiment du moi que nous convoque cette sculpture.
Le fragment découpé de son corps reviendra souvent dans la sculpture de Giacometti, de Main prise de 1932, à La Jambe, terminée en 1957, en passant par La Main, Le Nez, La Tête sur tige, œuvres de l’année 1947. Cette tendance témoigne des périodes de son travail où le fait de saisir l’ensemble d’une figure, « sa présence », comme le dit Yves Bonnefoy, effort constant dans son œuvre, lui paraît impossible.
Annette Messager, qui revendique la dimension féminine de son art, intègre l’univers domestique dans lequel le regard masculin a cantonné la femme : travaux à l’aiguille, carnets précieusement intimes, revues de beauté, pour en faire son langage plastique en même temps qu’une critique de la condition féminine. Des Pensionnaires, 1972, à Mes petites Effigies, 1988, aux Piques, 1992, son travail affectionne l’esthétique du fragment et révèle un univers de l’intime à l’écoute des mouvements contradictoires de l’inconscient.

![]() Annette Messager, Mes Vœux, 1989
Annette Messager, Mes Vœux, 1989
262 épreuves gélatino-argentiques montées
sur verre et accrochées à des
ficelles
Hauteur
: 320 cm, diamètre : 160 cm
Cette œuvre, qui s’inscrit dans une série, se présente comme une myriade de photographies de corps fragmentés, assemblées de manière à constituer un rond suspendu par des ficelles où les différents formats photographiques et les différents détails de visages et de corps se juxtaposent. Il semble que ce serait l’influence du tableau de Magritte intitulé L’Evidence éternelle, de 1930, où un nu féminin se divise en quatre parties peintes sur quatre toiles différentes, qui aurait amené Annette Messager à utiliser ce procédé.
Contrairement à d’autres installations, où les différents éléments
de l’œuvre - jouets en peluche, photos, inscriptions murales - sont espacés
et accrochés au mur (Mes petites Effigies), ou dressés agressivement sur des longues tiges d’acier (Les
Piques), ici, les gros plans des bouches,
des sexes, des genoux, des pieds, etc., se recouvrent souvent les uns les autres.
Disposés comme au hasard d’une chute, ils sont néanmoins reliés à des fils
qui en orchestrent habilement la composition en tondo, format
souvent associé au genre du portrait à la
Renaissance.
Mais le portrait se révèle impossible.
Le miroir, invoqué par la forme globale de l’œuvre
ainsi que par l’éclat du verre qui recouvre chaque photo, est désavoué par
l’image éclatée.

![]() Tetsumi Kudo
Tetsumi Kudo
Pollution, cultivation, nouvelle écologie,
1970-71
Installation
avec de la lumière
Métal,
contre-plaqué, isorel, fleurs plastiques,
lumière noire électronique, cheveux
artificiels, grillage,
ampoules, ficelles, écriteau avec texte
270 x 430 x
527 cm
Cette œuvre se présente comme une installation où, dans un curieux jardin, baignant dans une lumière noire, poussent des fleurs en plastique et des fragments épars de corps humains. Traumatisé par la bombe atomique, Kudo présente, ici, un univers éclaté, où les têtes, les sexes, les membres humains se mélangent à la terre, ou sont accrochés à des tiges en métal qui se dressent à la verticale.
Un jardin, lieu familier et presque édénique, se transforme ici en son contraire, car on y côtoie l’horreur des corps démembrés, là où même poussent des fleurs, des fleurs en plastique à la place de la végétation naturelle. L’œuvre est à la fois une remise en cause de notre culture occidentale, avec ses dangers de radioactivité, de pollution, et un appel, un espoir peut-être en une nouvelle écologie, comme le dit le titre, où l’homme changerait son rapport à la technologie.
Hybrider
Avec son recours à l’inconscient, au rêve, au processus de
libre association de réalités distinctes, le Surréalisme excelle dans
la représentation de corps hybrides,
lieux de métamorphoses entre l’homme et l’animal, l’inanimé et l’animé, le
réel et l’irréel.
Des monstres mi-humains mi-oiseaux des romans collages et
des peintures de Max Ernst aux Minotaures de Picasso, aux métamorphoses de
Miró, aux corps mêlant l’animé et l’inanimé de Magritte, c’est un cortège de « monstres », à la
fois merveilleux et terribles qui se déploie alors. Troublant la conscience
du spectateur et l‘amenant dans la région enfouie de l’inconscient, qui ignore
le temps et la contradiction, ces corps polymorphes visent la surprise, le
choc visuel et psychique.

![]() Max
Ernst, Chimère, 1928
Max
Ernst, Chimère, 1928
Huile sur toile, 114 x 146 cm
Cette toile, une des plus connues et énigmatiques, occupe une place centrale dans le bestiaire fantastique des surréalistes. S’imposant avec une évidente force de choc, l’œuvre qui illustre à merveille l’esthétique surréaliste a été immédiatement acquise par Breton.
Sortant du fond noir comme des profondeurs de la nuit, la chimère, agrégat monstrueux de membres de différents animaux, se déploie dans la toile comme une apparition. Le torse féminin se prolonge en aigle et renoue avec la thématique de l’oiseau, si chère à l’artiste, annonçant l’oiseau supérieur, le Loplop des années trente auquel l’artiste s’identifie. Le contraste violent entre la forme unitaire de l’animal se détachant de son fond par la découpe de son ombre bleu et par son corps de feu, est souligné par le contraste entre les aplats noir du fond et le modelé du corps hybride.

![]() René Magritte, Les Marches de l’été,
1938
René Magritte, Les Marches de l’été,
1938
Huile sur toile, 73 x 60 cm
Le corps, et encore une fois le corps féminin qui hante l’imaginaire surréaliste, se prête ici à la transformation subtile de la pierre inanimée en être vivant. Sur un porche dont des portions géométriques s’envolent dans le ciel d’été, pour y prendre sa couleur et sa vie, advient la « transsubstantiation » de la statue en femme, qui se dresse devant l’azur du paysage. L’air lui-même semble se pétrifier en gros cubes de bleu, tandis que les nuages le traversent. Inanimé et animé se mêlent à plusieurs niveaux de l’image où tout n’est que passage, transformation. L’art et la vie s’interpellent finement à l’enseigne d’un nu féminin troublant.
Disparaissant en tant qu’image, le corps devient perceptible
sur la toile comme trace réelle de l’artiste à l’œuvre. Quittant le chevalet
pour se poser au sol, ou se dressant à la verticale pour épouser l’espace
du mur, la toile est le support d’une création qui repose sur le geste renvoyant à un
corps unique, celui de l’artiste.
Les Drippings de
Pollock, qui marquent toute la génération de l’Expressionnisme abstrait,
de De Kooning à Motherwell et à Kline, les tracés
brouillés et griffés de Twombly, les empreintes du corps des modèles-pinceaux
de Klein, ou celles du corps de l’artiste chez Penone, caractérisent cette
nouvelle acception du corps dans l’art du XXe siècle.
Le corps en action

![]() Jackson Pollock, Number 26 A, « Black
and White », 1948
Jackson Pollock, Number 26 A, « Black
and White », 1948
Peinture
glycérophtalique sur toile, 205 x 121,7 cm
L’image fragmentée à la Picasso qui caractérisait les travaux précédents de Pollock se voile progressivement, avant de disparaître dans le flux de la peinture liquide coulée ou projetée sur la toile. 1947 est l’année des premiers drippings. Number 26A, de 1948, est un des exemples les plus caractéristiques. La peinture liquide est laissée coulée ou giclée sur la toile, étendue au sol, par l’artiste qui en orchestre le mouvement et la vibration.
Ces toiles sont les plus abstraites de Pollock. La profondeur s’abolit derrière un étoilement d’arabesques noires. Selon le principe de la peinture all-over, chaque partie de la toile est tissée d’éléments identiques qui se répètent et qui pourraient se prolonger à l’infini, au-delà du cadre (all-over : terme désignant la peinture qui recouvre de la même matière picturale la surface de la toile dans son entier). Toute idée de début ou de fin y est abolie. Attaquant la toile de tous les côtés autour desquels l’artiste tourne comme dans une danse, l’œuvre n’est plus qu’une curieuse voie lactée, un entrelacs de lignes colorées et plus ou moins épaisses où le fond et la forme s’abolissent.
Sur la toile blanche de format vertical, la couleur est réduite au noir et aux différentes intensités de gris. Le regard se concentre non pas sur l’objet de la représentation qui se dissout, mais sur le processus créateur lui-même, sur la pulsion, sur l’énergie en acte dont le tableau est la trace. Dans ces curieux tracés où disparaît l’image, advient un corps de peinture qui est celui du peintre à l’œuvre.
Traces et empreintes
Après la réalisation de monochromes de différentes couleurs,
l’élaboration de la formule du bleu outremer foncé (appelé IKB, International
Blue Klein) en 1956, le lâcher d’un millier
de ballons bleus et les sculptures-éponges en 1957, il expose le « vide » chez
Iris Clert en 1958. En 1960, il réalise les Anthropométries et les Cosmogonies qui
se veulent des empreintes de phénomènes naturels,
et fonde le groupe des Nouveaux Réalistes autour de Pierre Restany. S’intéressant
aux éléments naturels - l’air, l’eau, le feu -, il entreprend ensuite
ses peintures de feu.
De son saut dans le vide, le 27 novembre 1960 où le peintre
de l’espace se fait photographier en train de défier la gravité, aux Anthropométries, à Ci-git
l’espace en 1962, le corps est omniprésent dans l’œuvre d’Yves
Klein.

![]() Yves Klein, Anthropométrie de l’époque
bleue (ANT 82), 1960
Yves Klein, Anthropométrie de l’époque
bleue (ANT 82), 1960
Pigment
pur et résine synthétique sur papier monté sur toile
156,5
x 282,5 cm
En même temps que ses monochromes bleus, Klein réalise, avec le pigment IKB, sa série d’Anthropométries. Cette Antropométrie est une variante de la première œuvre de la série Célébration d’une nouvelle ère anthropométrique. Elle en diffère par un léger mouvement, vers le haut et le bas, des cinq corps-empreintes qui tracent ici une ligne plus irrégulière.
Sur le blanc de la toile des jeunes femmes, dont les corps
nus sont enduits de peinture bleue, réalisent, sous la forme d’une performance
publique à la Galerie internationale d’art contemporain, ces tableaux où Klein
orchestre comme le note Catherine Millet « la rencontre de l’épiderme
humain avec le grain de la toile ».
Cette rencontre se fait par simple
contact, la couleur passant directement du corps-pinceau à la toile et de la toile au regard du spectateur.
Le savoir faire du peintre n’existe plus dans ces œuvres où s’efface la facture.
Les corps de chair, eux-mêmes réduits à des tampons, semblent disparaître devant
une autre vérité que ces empreintes de seins, de ventres, de cuisses amènent à la
surface, celle de la trace réelle, donnant à voir l’immédiateté du contact.
Travail de négatif et d’aplatissement des corps niant tout effet de profondeur, l’empreinte est en deçà de la représentation, trace du travail du modèle, en même temps médium et motif. Le corps de l’artiste peignant ainsi que le corps figuré manquent ici. Contrairement à Pollock, dont la peinture était le résultat de son geste et de son corps à l’œuvre, il s’agit ici, comme le souligne Klein, de « projeter ma marque hors de moi ».
Le trait et la pulsion
![]() Cy Twombly, Untitled, 1969
Cy Twombly, Untitled, 1969
Peinture
de bâtiment, crayon à la
cire sur toile, 202 x 264 cm
Après l’intensité de la série des Red Painting (1961), où la peinture du fond se mêle au crayon, Twombly commence, à partir de 1966 et jusqu’en 1970, le cycle des Black board Paintings, moins énergiques, où les signes tracés au crayon à la cire sur des fonds monochromes semblent mesurer l’espace. La couleur a ici presque disparu. Elle s’inscrit, blanc sur gris comme un trait d’épingle, passant devant l’œil telle une apparition-disparition.
Enlevé, son geste n’en est pas pour autant présent, c’est celui que trace le crayon sur le fond brouillé de peinture. Deux traits accompagnés de deux chiffres difficilement lisibles, 25 et 29, sont à peine évoqués. La matière mince du fond, comme un rideau gris de coulures superposées, évoque un espace à la limite de l’abstraction, où se lit un geste qui n’impose pas d’objet, mais le parcours d’une main traçant une griffure qui flotte, dérive, et se maintient à la limite de l’évanescence.
Un espace du toucher

![]() Giuseppe Penone, Souffle 6 [Soffio 6], 1978
Giuseppe Penone, Souffle 6 [Soffio 6], 1978
Terre cuite, 158 x 75 x 79 cm
Le souffle est à la fois geste et objet d’une série de sculptures
intitulée Soffio.
L’artiste engage, ici, son corps dans la matière à laquelle
il veut donner forme. Il l’informe de son empreinte qui va de l’entre-jambes à la
bouche recourbée. La matière retrace le geste et l’objet de la sculpture :
le souffle.
Souffle 6 se présente comme une grande jarre dont la forme arrondie se termine par un cou, et dont un côté est ouvert. Le corps de l’artiste, embrassant l’argile, y a laissé à jamais l’empreinte de l’instant de la prise. Les bords laissent apparaître un bouillonnement baroque de formes qui pourraient faire penser à des nuages, mais aussi à des boucles de cheveux. Intérieur et extérieur, vide et plein, souffle informe et forme, se donnent à voir simultanément. Masculin et féminin coexistent, car la trace laissée en négatif par l’entre-jambes évoque un sexe féminin.
Comme le remarque Didier Semin, les Souffles « (…) sont une sorte d’inversion du visible.
Comme si tout à coup le souffle prenait corps. Ils ont un double statut qui
leur confère une réalité ambiguë : à la fois trace et métaphore (…) » (« Giuseppe
Penone » in L’arte Povera.)
Trace car lieu de vérité, liée à l’empreinte tangible du corps,
métaphore car le reste tourbillonnant de la sculpture est œuvre de l’imaginaire.
Ainsi Penone habite les paradoxes, affectionne les limites et suggère, comme
l’ajoute Semin, dans sa volonté de donner à voir l’impalpable, et ce qui
n’est pas fait pour être vu, la dimension du sublime.
Reprenant l’ancien mythe biblique de la Création, où le souffle
de Yahvé est donneur de vie, comme aussi le mythe grec de Prométhée et d’Athéna
où le souffle de la divinité anime la matière inerte, l’artiste donne vie à la
matière lui insufflant l’anima. Le choix
de l’argile comme matériau de l’œuvre ainsi que la forme qui correspond à une
sorte de jarre vont dans le sens du mythe : le vase que le potier crée
autour du vide qui le constitue, et qui, en Occident est le signifiant par
excellence de la création. (Cf. François Jullien, « Vide et plein »,
in La grande image n’a pas de forme.)
Le mouvement, qui est au
cœur de la sculpture de Penone, se
retrouve dans cette volonté de ne pas arrêter les formes, de les garder au
plus près de leur surgissement, afin de multiplier le pouvoir suggestif de
l’œuvre.
De l’action painting à l’empreinte du corps de l’artiste à l’œuvre, à la présence réelle de celui-ci dans l’œuvre, il y a encore un pas que le Body-art, mouvement commencé aux Etats-Unis dans les années 70, a franchi. Poussant à l’extrême la présence de l’artiste dans l’œuvre, l’art corporel met en jeu le corps devenu lui-même support de l’œuvre.
Déjà dans les années soixante, les actionnistes viennois
poussent très loin la pratique des happenings, mettant
en scène leur propre corps dans le cadre
de pratiques extrêmes mêlant violence, souffrance et sexualité. Réalisées
au cours d’exhibitions publiques à caractère souvent sacrificiel, ces « messes
noires » de l’art veulent avoir un caractère libératoire, et agir
en tant qu’abréaction d’affects et de représentations violentes.
Les
artistes américains Vito Acconci, Bruce Nauman, Dennis
Oppenheim expérimentent, quant à eux, les limites de leur propre corps à l’occasion
de performances où le corps est le support d’interventions qui vont de la
grimace à la blessure. En France, l’art corporel est représenté par Michel
Journiac et Gina Pane.
Le Body-art
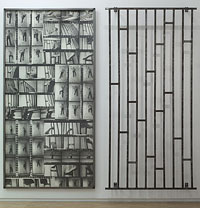
![]() Gina Pane, Action Escalade non-anesthésiée,
avril 1971
Gina Pane, Action Escalade non-anesthésiée,
avril 1971
Photographies noir et blanc
sur panneau en bois, acier doux, 323 x 320 x 23 cm
Photographe Françoise Masson
Un panneau de photographies noir et blanc et un bâti métallique retracent l’action de l’artiste, pieds et mains nus en train de monter les barreaux tranchants de la structure métallique. La souffrance offerte en direct au public est photographiée. L’œuvre, qui ne se veut pas éphémère, reste comme une trace, de la même façon que les blessures laissées sur le corps seront la « mémoire du corps ».
Réagissant au corps stéréotypé de l’imagerie de masse, où le réel, comme le souligne Guy Débord, s’en va dans son image, Gina Pane souligne, par la souffrance physique à laquelle elle s’expose, la réalité, la vulnérabilité du corps. Elle met en scène un corps fragile et une forme de sensibilité que la société contemporaine voudrait occulter.
Changement d’identitÉs
Le corps de l’artiste peut aussi être le support de performances mettant en cause l’identité. Portant atteinte à ce qu’on a de plus propre, l’image de notre corps, des artistes se plaisent à défaire ces identités, non pas seulement du point de vue de l’imaginaire mais aussi en passant à l’acte, comme c’est le cas d’Orlan, tandis que Cindy Sherman, tout en déjouant à l’infini son identité, se contente d’assumer d’autres rôles à travers une multitude de déguisements ne portant pas atteinte à son corps réel.
En 1998, avec la série Réfiguration-Self Hybridation, ce n’est plus dans le réel mais dans le virtuel, à l’aide de l’image numérique, qu’elle continue à transformer son visage d’après les canons de beauté d’autres époques et d’autres civilisations.

![]() Orlan, Refiguration-Self Hybridation, 1998,
Orlan, Refiguration-Self Hybridation, 1998,
Tirage
: 2\3, aide technique au traitement des images, Pierre Zovilé
Cibachrome contrecollé sur aluminium, 116 x 166 x 4 cm (hors
marge :100 x 150)
La série Réfiguration-Self Hybridation s’apparente aux travaux d’Orlan sur son corps, mais ici c’est sa propre image virtuelle que l’artiste travaille, la confrontant à d’autres critères esthétiques. « J’entreprends actuellement un tour du monde des standards de beauté chez les Précolombiens (déformations du crâne, strabisme, faux nez…). A l’aide de l’ordinateur, j’hybride ma propre image avec celle des sculptures présentant ces caractères pour créer une autre proposition, un autre modèle de beauté. » (Beaux Arts Magazine, n°174, novembre 1998).
Refiguration-Self Hybridation, 1998, s’inscrit dans cette
série où Orlan se métamorphose en hybride
d’elle-même et des sculptures olmèques, aztèques et mayas. La beauté peut
prendre, selon l’artiste, des apparences qui ne sont pas réputées belles,
et ce travail se situe dans une réflexion autour de ce concept. Ici, le visage
féminin de profil entreprend une légère rotation vers le trois-quarts. Tandis
que le visage d’Orlan est reconnaissable derrière les hybridations du crâne
immense qui se termine en sculpture, la peau présente le grain doré de ces œuvres
précolombiennes.
Tout est ici lumière, de celle de l’or, au jaune lumineux
des cheveux se découpant sur le bleu outremer du fond, contrastant avec le
rouge carmin des lèvres. Une autre mesure de la beauté est ici donnée à voir,
elle s’identifie à la monstruosité même du visage-mutant, mi-chair mi-sculpture.
Travaillant toujours par séries, ses premières images remontent
au début des années soixante-dix. De la starlette de cinéma à la jeune femme
assassinée dans un parc, à la Vierge à l’enfant, qui mettent en scène l’artiste
travestie « à la manière de », Cindy Sherman revisite différentes
mises en situation du corps féminin et les codes de représentation y afférant
pour les soumettre à un autre regard, d’où se dégage souvent un certain érotisme
et une ambiguïté trouble et déroutante.
Dans la dernière série, son corps a disparu. A sa place, des
corps de mannequins disloqués renvoient à une fantasmatique sexuelle violente
et grotesque, suscitant l’abjection.

![]() Cindy Sherman, Untitled, # 141, 1985
Cindy Sherman, Untitled, # 141, 1985
Cibachrome, 184,2 x 122,8 cm (hors marge : 180 x 122 cm)
En 1985 Cindy Sherman est conviée par le journal Vanity Fair à réaliser des photos inspirées des contes de fées, Fairy tales. S’affranchissant des limites imposées par la réalité, l’artiste donne libre cours à un univers fantastique qui n’a rien à voir avec les contes de fées classiques mais évoque des atmosphères morbides, inquiétantes et surréelles. Androgyne ou sorcière, ces contes lui permettent d’assumer les rôles les plus ambigus.
Ici ce n’est pas seulement un rôle étranger que l’artiste adopte, s‘appropriant une identité masculine,elle franchit la limite entre les deux sexes. Duchamp, déjà, en 1920-21, s’était fait photographier par son ami Man Ray dans la figure de son double féminin Rrose Selavy, dans un déguisement riche en détails. Mais Cindy Sherman adopte ici la figure masculine aux fins d’une narration où la photographie s’apparente du cinéma pour mettre en scène une figure d’assassin, sorte de Jack l’Eventreur.
Dans une nuit éclairée par la lumière verdâtre des projecteurs, émerge la figure en contre-plongée du terrible personnage masculin, tandis que les lumières au fond évoquent celles d’une ville. Des prothèses comme le dentier, le cache-œil, servent ce déguisement où Sherman s’identifie à l’assassin prêt à bondir sur sa proie. La chemise à carreaux déboutonnée, le jeans, le poing serré semblant tenir l’arme du crime ne laissent pas de doutes sur la violence de la scène évoquée. Les éléments du décor ont disparu permettant au regard de se concentrer sur le personnage. Le plan moyen, qui le coupe au-dessus des genoux, intensifie l’action et attire l’attention sur l’attitude et le costume. Le reste de l’image n’est que flou et lumière métallique éclairant, comme un cauchemar, cette simulation d’assassinat urbain.
Corps et expÉrience de l’espace-temps
![]()
« Je déclare l’espace », affirmait Barnett Newman
en 1962 au sujet des vastes champs monochromes de sa peinture, qui met en
cause l’œuvre et ses limites, incluant en elle le hors-limites, l’infini.
Déjà, en 1948, Newman, dans son ouvrage célèbre, The sublimis is now, évoque une peinture qui s’adresse à nous dans
l’ici et maintenant. Le sublime c’est au présent. Il est une dimension à vivre
dans l’expérience de la perception de l’œuvre. La perception, encore plus
que l’objet à percevoir, devient le sujet principal d’œuvres où l’objet de
la représentation a disparu.
Avec les vastes champs de couleurs vibrantes, les interventions
dans la nature du land art, ou avec les installations contemporaines
visant une immédiateté de
la perception, le corps du spectateur est placé dans l’ici et le maintenant
de la rencontre avec l’œuvre.
Des longs couloirs de Bruce Nauman, au
curieux comptage du temps dans les toiles de plus en plus blanches d’Opalka, quand ce n’est
pas l’immersion dans la lumière projetée sur l’écran chez Bill Viola, le
spectateur est invité à des voyages qui dépassent la représentation pour
le situer dans le vif de la perception réelle.
Traverser la couleur
En 1948 il écrit son ouvrage : The sublimis is now (Le sublime c’est maintenant), où il affirme le présent dans l’appréhension de l’œuvre d’art, qui est une rencontre entre la sensibilité du spectateur et l’étendue de la couleur.

![]() Barnett Newman, Shining Forth (to George), 1961
Barnett Newman, Shining Forth (to George), 1961
Huile sur toile, 290 x 442 cm
Conformément à sa pratique, Newman peint ici un tableau immense où la couleur unie se déploie, intense, mais sans profondeur. Se débarrassant du châssis, la peinture semble ne plus avoir de limites, et le peintre travaille, comme il l’écrit, « avec l’espace entier ». Le blanc dominant est traversé par trois « zips » verticaux noirs de différentes épaisseurs. Le noir est, pour l’artiste, la couleur du « vide pour faire place à l’expérience ».
Réalisée après son accident cardiaque en 1957 et la mort de son
frère en janvier 1961, cette toile dédiée au frère disparu est une confrontation
de l’artiste à la mort. La stricte bichromie, la lumière qui se dégage du tableau
auquel le titre fait référence, Shining Forth, littéralement qui brille
au loin, donnent à l’œuvre une dimension mystique et font écho au cycle des Stations
de la croix (1958-1966) qui sont, comme le souligne Henri Maldiney, des
véritables « drames de la lumière ».
Même si la toile est moins large que d’habitude, l’espace du tableau
enveloppe le spectateur et l’immerge dans l’ici et maintenant d’une expérience de
l’espace.
Éprouver la durÉe
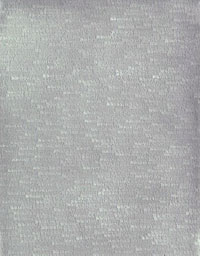
![]() Roman Opalka, Opalka 1965/1-∞
Roman Opalka, Opalka 1965/1-∞
Détail 3307544-332438
Acrylique sur toile, 196 x 135 cm
Travaillant tous les jours et photographiant son visage
une fois la toile terminée, chaque tableau d’Opalka a un format standard
de 196 x 135 cm. Il est la suite immédiate de celui qui précède, les nombres
se suivant dans un calcul qui n’a comme limites que la disparition de son
auteur. Tracés
au pinceau N°0 à la peinture blanche, sur des fonds de plus en plus blancs, chaque
toile est un « détail » d’un tout,
celui du temps dans lequel s’inscrivent l’expérience picturale et la vie de
l’artiste.
Regarder une toile d’Opalka c’est vivre l’écoulement implacable
et continuel du temps qui se mesure au blanchiment progressif de la toile,
auquel fait écho l’effacement de la netteté des
contours dans la photographie du visage du peintre qui l’accompagne. C’est
vivre une expérience de l’espace-temps qui nous renvoie inexorablement à notre
condition mortelle et à notre être en proie à la durée.
L’emblème de son travail, Opalka dit le trouver dans L’Aurige de Delphes. (Art Press, n°168, entretien avec Hervé Legros.) Cette statue dont des parties manquent est, pour Opalka, une étonnante image du temps, car le jeune homme a tout perdu, ses chevaux, son char, son bras gauche, et continue pourtant, avec ce qui lui reste de rênes, à conduire ce qui a disparu. « Il manifeste ce qu’on ne voit plus, comme le blanc sur blanc que j’espère atteindre : le non visible est présent, un miracle se matérialise. » Travail de l’infini dans le fini de l’espace et du temps, celui de la toile et de la succession des toiles le long d’une œuvre qui dure une vie.
La menace d’effondrement au centre de la perception de l’œuvre

![]() Richard Serra, Corner prop n°7 (for Nathalie), 1983
Richard Serra, Corner prop n°7 (for Nathalie), 1983
Acier, 2 plaques
280 x 270 x 200 cm
première
plaque (support) : 140 x 140 x 5 cm
seconde plaque : 150 x 270 x
5 cm
Dans cette sculpture où deux plaques d’acier superposées perpendiculairement s’effleurent, la relation au lieu est primordiale. Tandis que ses lignes, ses surfaces géométriques entrent en résonance avec les angles droits de la pièce, c’est en effet l’angle du mur qui permet à la plaque rectangulaire de tenir en équilibre.
« Occupation et définition constituent pour Serra des fonctions résolument indissociables, ainsi qu'elles le sont dans le monde que nous habitons et appréhendons », écrit encore R. Krauss à son sujet dans L’Originalité de l’avant-garde et autres mythes modernistes. Elle ajoute plus loin : « Deux sortes de lignes existent en sculpture : celle qui occupe l’espace sans le définir et celle qui le définit sans l’occuper. » Serra joue sur l’interrelation des deux dans la définition d’un nouvel espace, par l’intervention de l’œuvre modulable, dans la pièce du musée où elle est présentée ou dans l’extérieur où elle se déploie. Elle sollicite le point de vue du spectateur et son corps tout entier dans la perception de l’œuvre.
L’expÉrience du labyrinthe

![]() Bruce Nauman
Bruce Nauman
Going around the Corner Pièce,
1970 (Prendre le tournant)
Installation : 4 caméras vidéo, 4 moniteurs
noir et blanc,
4 cimaises d'environ 324 x 648 x 648 cm
Installation à réaliser sur le lieu de l'exposition d'après
le plan fourni par l'artiste et conservé au Cabinet d'art graphique.
Going around the Corner Pièce fait partie d’une série d’œuvres que Nauman entreprend à partir de 1969, appelées Corridors. Se dénouant sur des espaces étroits et complexes le spectateur se doit de les parcourir.
Dans cette pièce sont installés quatre moniteurs
posés
au sol et reliés à quatre caméras qui filment le spectateur
sur son passage. Néanmoins c’est au tournant de la pièce,
c’est-à-dire là où il ne s’y attend pas,
que le spectateur se voit, avec un décalage spatio-temporel par
rapport au moment où il a été filmé.
La place du
spectateur, pris dans un circuit fermé où il évolue,
et soumis à une expérience donnée, ne peut pas ne pas
faire penser aux célèbres expériences pavloviennes basées
sur le principe du stimulus-réponse. Manière peut-être
pour l’artiste de questionner l’être au monde de l’homme
moderne, surveillé et trompé par le système tout puissant
de l’image qui le transforme, à son insu, en spectacle.
DÉpasser les limites apparentes de la perception
Si l’image est présente dans son œuvre et si, dans certains travaux, il interroge la peinture et en particulier l’œuvre de Pontormo (1494 - 1557, Florence) (The Greeting, 1995), recréant dans une installation vidéo une peinture vivante, c’est la perception humaine elle-même que Viola explore.

![]() Bill Viola, Five Angels for the Millennium, 2001
Bill Viola, Five Angels for the Millennium, 2001
Installation vidéo sonore, salle noire de dimensions variables,
5 projections murales de 240 x 130cm
5 sources de son stéréo
Projetées sur cinq immenses écrans, cinq figures accomplissent au ralenti leur action : plongée dans l’eau, sortie de l’eau et ascension, dans un décor sonore tendu jusqu’à l’explosion. Explosion acoustique qui accompagne l’émergence de la forme lumineuse. Figure toujours brouillée, participant à la fois de l’élément aquatique et du ciel. En effet comme l’indique le titre, Five Angels for the Millennium, il s’agirait de cinq anges : celui qui s’en va en plongeant, celui de la naissance, celui du feu, celui qui monte dans un mouvement ascensionnel, et celui de la création.
La consonance mystique est évidente dans cette œuvre. Viola, qui s’insurge contre le manque de dimension contemplative propre à notre époque, met ici en scène une figure spirituelle difficilement représentable, celle de l’ange, qui a hanté la représentation picturale en Occident pendant des siècles. Cette représentation est poussée ici aux confins de l’infigurable, et l’image à la limite de la dématérialisation.
Plongé dans le noir profond de la pièce où est projetée l’œuvre, le spectateur est invité à une expérience de tous les sens, remettant en cause la perception et ses lois. Le temps semble s’allonger dans la durée des actions qui se prolongent. Eau et ciel se confondent dans un espace qui abolit les limites entre les choses. Le visible est menacé par l’invisible, l’obscurité rongeant à chaque instant la lumière. La tension émotionnelle, véhiculée par le son, explose au moment de l’apparition des corps propulsés hors de l’eau ou engloutis en elle. Rien ne reste, tout bouge inlassablement et l’image aussitôt formée rentre dans le processus de sa disparition.
Création, naissance, mort, élévation, vie, sont les moments forts de l’œuvre scandés par le titre. Une œuvre qui, voulant libérer chez le spectateur les affects refoulés, est de l’ordre de la catharsis. « Il n’existe pas de lieu officiellement consacré à l’expérience subjective dans notre culture. L’art y pourvoit », déclare en effet Bill Viola.
Margherita Leoni-Figini
Pour consulter les autres dossiers sur les collections du Musée national d'art moderne
En français
![]()
En anglais
![]()
Contacts
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce document
Contacter : centre.ressources@centrepompidou.fr
© Centre Pompidou, Direction de l’action éducative
et des publics, février 2006
Mise à jour : août 2007
Texte : Margherita LEONI-FIGINI, professeur relais de l’Education
nationale à la DAEP
Maquette : Michel Fernandez
Dossier en ligne sur www.centrepompidou.fr/education/ rubrique 'Dossiers
pédagogiques'
Coordination : Marie-José Rodriguez