Parcours exposition
![]() Dossiers
pédagogiques
Dossiers
pédagogiques
Parcours
exposition
|
|
|
|
| Le mouvement des images. Vue de salle. Projection / salle 21. Œuvres de Jackson Pollock et Dennis Oppenheim. © Centre Pompidou – Droits réservés |
Cinéma et arts plastiques. Une redéfinition réciproque
Défilement. La répétition
comme structure
• Le ruban filmique : la matière première du cinéma
• La
multiplication des images appliquées à la peinture
• Le cinétisme : le mouvement
du spectateur
• La répétition comme méthode : le défilement réduit à
l’essentiel
Montage. Du fragment à l’assemblage
• Le
contraste : la recherche d’un
choc
• La simultanéité : la recherche d’une synthèse
• Montage
et découpage :
les limites du cadre
Projection. Le dispositif
cinématographique
• Le pouvoir de la lumière : créer des formes éphémères
• La
projection comme redoublement du réel : un
outil pour mieux voir
• Le tableau comme écran : la projection appliquée à la
peinture
Le récit. La référence au cinéma
de fiction
• La fascination des héros : la représentation
des personnages de fiction en peinture
• Les recettes narratives : l’art parodie le cinéma
• La
peinture comme storyboard : la transposition
picturale des
ébauches narratives
« Veuillez éteindre la lumière. Puisqu’on va parler de
films, autant le faire dans le noir. »
Début d’une conférence d’Hollis Frampton à New
York en 1968.
Lorsque l’on pénètre dans le Musée pour découvrir l’accrochage des collections contemporaines intitulé Le mouvement des images, on est tout d’abord surpris par la couleur noire qui recouvre les cimaises et la pénombre qui règne dans les salles. Loin du « white cube » auquel l’art contemporain nous a habitués, cet accrochage semble présenter les œuvres dans des conditions de perception qui sont celles du cinéma. Dès les premiers pas dans le Musée, on aperçoit d’ailleurs des films projetés sur les murs ou diffusés par des moniteurs encastrés, ce qui conduit à se demander quel est le rapport entre ces œuvres cinématographiques et une exposition d’arts plastiques. Ces films sont-ils des œuvres au même titre que les autres, que les peintures ou les sculptures à côté desquelles ils sont exposés, ou conservent-ils une spécificité ? S’interrogeant ainsi, on reformule la question que posait Walter Benjamin dans les années 30 : le cinéma apporte-t-il un changement radical dans la définition de l’art ?
Tel est bien l’enjeu de cette présentation qui actualise la question, notamment en utilisant la technologie numérique pour présenter des films en boucle, en éliminant la contrainte temporelle d’un début et d’une fin de séance : les films numérisés sont toujours visibles et sont par conséquent présentés comme des tableaux. Ainsi, le cinéma peut-il être confronté à d’autres types d’œuvres et intégré à une conception plus large de l’art, et en particulier le cinéma expérimental, proche de l’art contemporain puisqu’il s’agit pour tous deux d’explorer leurs composantes essentielles.
Ce processus d’intégration du cinéma au sein des arts plastiques a en réalité commencé au début du 20e siècle, avec des artistes comme Man Ray, dont on peut voir le film, Le Retour de la raison, 1923. Dès cette époque, le cinéma a modifié la manière de faire des œuvres chez un grand nombre d’artistes. A travers les chapitres qui structurent l’espace du Musée, « Défilement », « Montage », « Projection », « Récit », qui sont des catégories du registre cinématographique, on découvrira comment le dispositif mis en place par le cinéma a pu rejaillir sur la création plastique et contribuer à son dynamisme et à son inventivité. Chacun des chapitres met en avant une de ces caractéristiques dominantes en réunissant des œuvres cinématographiques, exposées comme des pièces à part entière, et des œuvres issues des arts plastiques dont on percevra les emprunts faits aux précédentes.
Avertissement
Certaines œuvres peuvent choquer la sensibilité des
jeunes visiteurs :
Nan Goldin, Heart Beat, salle 7
Paul Sharits, Piece Mandala/End war, rue.
En s’inspirant du cinéma expérimental qui exhibe la structure répétitive de l’image cinématographique, les arts plastiques, à partir de la seconde moitié du 20e siècle, transforment la pratique de la série apparue à la fin du 19e siècle, avec la peinture de Monet, en une recherche sur la capacité de la répétition à produire du nouveau.
Le ruban filmique : la matière première du cinéma
En effet, l’un des principaux buts que s’est fixé le cinéma expérimental est de révéler l’illusionnisme du cinéma de fiction comme un impensé. Comme le note l’artiste et théoricien Hollis Frampton en 1971, « l’illusion du mouvement est certes le complément habituel de l’image filmique », mais ce n’est qu’un postulat et « rien dans la logique structurelle du ruban filmique ne justifie un tel postulat » (cf. ouvrage cité en bibliographie, p. 109).
Les films expérimentaux décomposent le processus cinématographique pour travailler ses éléments séparément et s’intéressent tout d’abord à sa matière première, la pellicule. Ils donnent à voir la matière cinématographique structurée par la répétition d’images qui, une fois mise en mouvement, produisent l’illusion d’une continuité. Dans le cinéma traditionnel, « La répétition d’une forme change celle-ci en mouvement » (catalogue Le mouvement des images, p. 52). Le cinéma expérimental donne à voir cette matière cinématographique, interroge cette répétition, revient au morcellement des images. La pellicule peut être utilisée comme un matériau, autant à regarder qu’à projeter. Tel est le cas de l’œuvre de Peter Kubelka, Portrait d’Arnulf Rainer, 1958-60, où la répétition des images est remplacée par la succession d’amorces noires et blanches exposée comme un tableau abstrait. La pellicule peut aussi être composée d’une succession d’images toutes différentes, filmées une à une, comme dans le film de Robert Breer, Image par image, 1955, qui insiste sur la fragmentation du procédé, produisant comme un scintillement stroboscopique.

![]() Richard Serra, Hand Catching Lead,
1968
Richard Serra, Hand Catching Lead,
1968
Film cinématographique 16 mm noir et blanc, silencieux,
durée : 3’
Le film de Richard Serra, Hand Catching Lead, 1968, présenté pour la première fois en 1969 dans l’exposition « Anti-Illusion. Procedures/Materials », s’offre comme une métaphore du ruban filmique. Le dispositif est simple : des feuilles de plomb tombent régulièrement dans le champ de la caméra, tandis que la main de l’artiste tente de les attraper. Les premières, par leur chute répétée et verticale, évoquent le mouvement de la pellicule ; la main de l’artiste figure les barres transversales du cadre qui disparaissent avec l’accélération du défilement. Au fur et mesure de cette scansion répétitive, la main s’obscurcit et s’apparente à une ombre chinoise.
Hand Catching Lead réaffirme une narration potentielle au cœur même de la matière filmique. Richard Serra « reconstitue, à main nue – d’une seule main en fait –, la séance de cinéma », écrit Philippe-Alain Michaud (catalogue Le mouvement des images, p. 8). Il montre que le processus cinématographique n’a besoin que des conditions rudimentaires pour créer des images se suffisant à elles-mêmes. Il rejoint le travail de Stan Brakhage qui, depuis les années 50 jusqu’à aujourd’hui, réalise des films émouvants et sensuels sans avoir recours à la fiction : dans Chartres series, 1994, par exemple, la pellicule, d’abord utilisée pour filmer les vitraux de la cathédrale, puis repeinte, devient un jeu de transparence et d’opacité d’où naît un étonnant effet onirique.
La multiplication des images appliquée à la peinture
Cette structure marque en profondeur la composition des images fixes au 20e siècle. Ce phénomène concerne aussi bien des artistes tels qu’Andy Warhol, intéressés de prés par le cinéma, que des grands maîtres comme Picasso qui, dans la dernière partie de son œuvre, invente une nouvelle manière de travailler inspirée par le processus cinématographique.

![]() Andy Warhol, Ten Lizes, 1963
Andy Warhol, Ten Lizes, 1963
Huile et laque sur toile
(procédé sérigraphique)
201 x 564,5 cm
Ce tableau gigantesque se réfère au cinéma à plusieurs égards. Sa forme allongée rappelle le ruban filmique. Le portrait est celui de l’actrice Elizabeth Taylor, nommée familièrement « Liz », réalisé à partir d’une photographie de studio pour la promotion de l’un de ses films. Et enfin, si le portrait répété dix fois évoque la surabondance des images dans nos sociétés de consommation, sa multiplication - avec pour chaque image de légères différences - ressemble à des photogrammes. Warhol réinsère l’image de la star, figée par la photographie, dans l’univers cinématographique auquel elle appartient et lui procure un analogue visuel de la durée. Les films qu’il réalisera par la suite seront un prolongement de ce travail pictural.
--> Voir le dossier
Pop art
![]()

![]() Picasso, Le
peintre et son modèle,
1970
Picasso, Le
peintre et son modèle,
1970
Crayons de couleur sur carton ocre
Dessin 8. Ensemble de 8 dessins
23,8 x 31,5 cm
La série du Peintre et son modèle réalisée par
Picasso en 1970 peut, elle aussi, être interprétée comme une application
du dispositif cinématographique au travail pictural. La série consiste
en une succession d’études réalisées à quelques minutes d’intervalle, comme
si l’œil du peintre était une caméra capable de saisir les variations infimes
qui se produisent dans la continuité du temps. Dans les dernières années
de son œuvre, Picasso se donne ainsi un nouveau programme de recherche
visant à procurer un mouvement aux images. « C’est le mouvement de
la peinture qui m’intéresse, l’effort dramatique d’une vision à
l’autre », dit-il, en 1971 (cf. le catalogue, p. 61). La série acquiert
une dimension cinétique.
![]() Sylvia
Bächli, Karola, 1997
Sylvia
Bächli, Karola, 1997
Gouache, encre de Chine
et crayon gras sur papier
Achat, 2000
AM 2000-166
La duplication de l’image est l’une des caractéristiques de la création actuelle. Karola, 1997, de Sylvia Bächli est un portrait fragmentaire, composé de dessins dispersés sur les cimaises du musée. Les blancs qui séparent les feuilles comptent autant que les feuilles elles-mêmes, incrustant dans l’œuvre la présence du temps et peut-être le « blanc » de séquences manquantes. « L’intensité des associations de feuilles est modulée par la distance entre chacune d’elles, distance qui assume ici la même signification que le silence en poésie ou la pause en musique ». (Jonas Storve, catalogue p. 64.)
--> En savoir plus sur l’artiste : www.silviabaechli.ch ![]()
Le cinétisme : le mouvement du spectateur
Bien qu’immobiles, certaines œuvres plastiques produisent une illusion de mouvement. C’est ce que cherchent les artistes issus du mouvement cinétique à partir du milieu des années 50. Leurs œuvres invitent le spectateur à se déplacer pour assurer lui-même la continuité entre les éléments qu’il perçoit, et grâce à la persistance rétinienne, avoir l’illusion d’une image en mouvement.

![]() Raymond Hains, Pénélope, 1950-80
Raymond Hains, Pénélope, 1950-80
Film cinématographique
16 mm noir et blanc et couleur, silencieux
Une analyse du fonctionnement rétinien et des illusions d’optique sont à l’origine du cinétisme. Le film de Raymond Hains, Pénélope, peut être interprété comme participant d’une telle analyse. Réalisées grâce à un dispositif complexe, associant deux mouvements simultanés et un filtre en verre cannelé, ces images produisent l’illusion de formes colorées qui s’interpénètrent, comme si elles étaient douées de vie. De même que ses premières affiches lacérées, ce film témoigne de l’intérêt de Raymond Hains pour une création spontanée, faite de couleurs qui s’assemblent et se dispersent de manière autonome, assurant à elles seules la composition de l’œuvre.

Yacov Agam est l’un des plus célèbres artistes du mouvement cinétique. En 1972, Georges Pompidou lui confie la décoration de l’antichambre de ses appartements privés à l’Elysée, pièce offerte au musée après sa mort. L’artiste conçoit sa décoration comme un ensemble qui évoque les différents instants de la journée. Aperçu de loin, les murs semblent ornés de bandes de couleurs disposées sans ordonnancement particulier, sur des surfaces en relief. De près, selon le positionnement qu’il adopte dans la pièce, le visiteur découvre un dégradé de couleurs retraçant le parcours du soleil, de l’aube au coucher. Le tout se reflète dans la sculpture sphérique placée au centre de la pièce qui opère une synthèse du décor. Le visiteur se déplace ici non seulement dans l’espace mais aussi dans le temps.
La répétition comme méthode : le défilement réduit à l’essentiel
Au milieu des années 60, aux Etats-Unis, les artistes du Minimalisme adoptent la répétition comme méthode de recherche. La succession d’éléments peut aboutir à la création d’une illusion d’optique ou, d’une manière plus radicale, à une expérimentation concernant la perception de l’espace. Cette recherche se poursuit jusqu’à aujourd’hui sous une forme plus humoristique.

![]() Donald Judd, Stack, 1972
Donald Judd, Stack, 1972
Acier inoxydable, plexiglas
rouge
470 x 102,5 x 79,2 cm
Après la publication, en 1965, de son texte fondateur intitulé
« Specific objects » (De quelques objets spécifiques) dans lequel
il redéfinit l’œuvre d’art comme un objet capable de révéler l’espace qui
l’environne, Donald Judd commence à réaliser des Stacks (piles).
Ces œuvres sont constituées d’éléments alignés verticalement, accrochés au
mur en porte-à-faux. Le nombre d’éléments varie en fonction de la hauteur
de plafond, mais doit en principe être un nombre pair pour qu’aucun d’entre
eux ne joue le rôle de centre et n’introduise une organisation hiérarchique.
Au contraire, aucun élément ne doit se distinguer des autres ; les intervalles
d’espace doivent avoir la même hauteur que les parties pleines, la répétition
d’un même module, plein ou vide,
étant déterminante pour l’expérimentation : c’est elle qui sert d’étalon
pour mesurer l’espace. Le défilement se vide ici de tout contenu pour devenir à
la fois la structure et le sujet de l’œuvre.

![]() Jeppe Hein, Moving Neon Cube,
2004
Jeppe Hein, Moving Neon Cube,
2004
Verre, câble électrique, programmateur, transformateur
70 x 180 x 180 cm
Héritier à la fois du Minimalisme et de l’Art conceptuel dans son vocabulaire formel, le jeune artiste danois Jeppe Hein utilise lui aussi dans Moving Neon Cube la répétition d’un module. Grâce à une structure en néon qui s’allume progressivement, l’œuvre dessine la trajectoire d’un cube que l’on ferait rouler, sans toutefois prétendre à l’illusionnisme. Elle décompose plutôt le mouvement de ce cube au ralenti, comme s’il pouvait devenir un sujet d’étude. Le jeune artiste substitue ainsi à la problématique spéculative du Minimalisme une question dérisoire. Dans ce sens, on peut rapprocher ce travail des études pseudo scientifiques et humoristiques de François Morellet, présent dans l’exposition avec 6 répartitions aléatoires de 4 carrés noirs et blancs d’après les chiffres pairs et impairs du nombre Pi, 1958. Les deux artistes parodient le sérieux de la méthode minimaliste.
Au cinéma, le découpage de la réalité en une succession d’images
appelle un corollaire, le montage. En effet, la rupture de la continuité
naturelle implique une reconstruction artificielle où tout est permis. De
nouveaux liens inattendus peuvent être tissés entre les choses. Les arts
plastiques s’inspirent aussi de cette composante du cinéma, en l’adaptant
toutefois à leur contrainte. Se déployant dans l’espace et non dans le temps,
comme le notait déjà Lessing dans son Laocoon à la
fin du 18e siècle, ils font dans la simultanéité ce que le cinéma fait dans
la succession.
Les arts plastiques traduisent, à travers la composition, l’assemblage,
l’installation et tout autre procédé de synthèse, ce que le cinéma réalise
par le montage.
Le contraste : la recherche d’un choc
Le montage, comme rapprochement d’images, peut répondre à plusieurs intentions : la recherche d’un fort contraste, d’une opération de synthèse, le franchissement de la limite… Pour les arts plastiques, sous l’influence des mouvements d’avant-garde qui tendent à choquer la sensibilité d’un public encore très conventionnel, la recherche de contraste domine dans la première partie du 20e siècle.

![]() Fernand Léger, Ballet mécanique,
1923-1924
Fernand Léger, Ballet mécanique,
1923-1924
Film cinématographique 35 mm couleur et noir et blanc,
muet, durée : 17’
Co-réalisation : Dudley Murphy
Photographie : Man Ray et Dudley
Murphy
C’est après avoir travaillé le contraste dans sa peinture que Fernand Léger réalise ce film. Dès 1913, dans Formes et contrastes par exemple, il recherche une opposition systématique des éléments picturaux, que ce soient les valeurs, les lignes ou les couleurs, dans le but de produire une toile dynamique qui évoque l’intensité de la vie. En 1924, il réalise son Ballet mécanique, un film qu’il monte suivant le même principe.
Des objets sont filmés en gros plan, comme des fouets de cuisine, qu’il confronte à des machines, des visages, des morceaux de corps. Les images sont répétées, recadrées, manipulées, notamment par surimpression, produisant une œuvre rythmée, à l’origine accompagnée d’une musique de Georges Antheil. Léger accomplit ainsi dans le médium cinématographique le programme que sa peinture avait fixé.
--> Voir le dossier
Cubisme ![]()
La simultanéité : la recherche d’une synthèse
Le collage, pratiqué par les artistes depuis le début du 20e siècle, est l’équivalent le plus direct du montage. Limité à la bidimentionnalité, le collage se transforme en assemblage, voire en dispositif spatial, lorsqu’il acquiert une troisième dimension.
![]() Max Ernst, La Femme sans
tête,
1929
Max Ernst, La Femme sans
tête,
1929
40 collages
Gravures découpées et collées sur papier collé sur
carton
Don de M.Carlo Perrone 1999
AM 1999-3
S’il n’a pas inventé le collage, au contraire d’autres techniques picturales dont il est à l’origine, comme le frottage ou le dripping, Max Ernst utilise abondamment ce procédé en explorant la diversité de ses ressources. Chez Picasso, auquel on doit la technique, ou même dans les premières œuvres de Ernst y faisant appel, les éléments importés avaient pour fonction de créer un décalage par rapport au reste de la composition.
Dans les œuvres qu’il désigne comme des romans-collages, Ernst propose des univers fantastiques émanant de compositions homogènes. Dans le premier de ces romans-collages, La Femme 100 têtes, un livre de quarante planches reproduisant des collages originaux, il mêle des images provenant de gravures du 19e siècle, des paysages, des objets, des personnages, qu’il fait fusionner en estompant les traces de découpage et les raccords. Il crée ainsi une multiplicité de scènes étranges auxquelles on croirait presque : des morceaux de corps autonomes, des machines futuristes, une ville envahie par des papillons... Le collage permet à Ernst de dresser le panorama d’un nouveau monde à découvrir.
--> Voir le dossier
L’Art surréaliste ![]()

![]() Robert Rauschenberg, Oracle,
1962-65
Robert Rauschenberg, Oracle,
1962-65
Tôle galvanisée, eau et son
236 x 450 x 400 cm
Après avoir réalisé de nombreux collages et assemblages de peinture et d’objets qu’il appelle des « combine paintings », Robert Rauschenberg achève en 1965 cet environnement sonore. Composé d’éléments récupérés du quotidien comme une baignoire, une fenêtre ou une portière de voiture et des sons plus ou moins brouillés captés grâce à une radio, cet ensemble évoque la cacophonie du monde urbain moderne. Par ce système, Rauschenberg réintroduit la dimension sonore dans la sculpture, opérant ainsi une correspondance entre les sens, voire une synthèse entre les arts.
On peut rapprocher cette œuvre de l’environnement conçu par Joseph Beuys, Plight, 1985, qui lui aussi intègre plusieurs dimensions sensorielles, et peut être réinterprété comme un montage d’éléments. Mais à la différence d’Oracle, si Plight intègre une dimension sonore par l’intermédiaire du piano qui occupe l’espace, c’est pour insister sur la profondeur et les bienfaits du silence. Cette œuvre fait taire le brouhaha de la vie moderne.
--> Voir le dossier
Pop art
![]()

![]() Jeff Wall, Picture for Women,
1979
Jeff Wall, Picture for Women,
1979
Epreuve cibachrome, caisson lumineux
161,5 x 223,5 x 28,5 cm
Grâce à un dispositif spatial articulé autour d’un miroir, Jeff Wall rassemble en une seule photographie les divers moments du déroulement d’une scène.
En référence à un tableau d’Edouard Manet, Un Bar aux Folies-Bergères, dans lequel une serveuse contemple quelque chose dont on ne perçoit qu’après coup le reflet dans un miroir, Jeff Wall met en scène un homme et une femme qui se cherchent et se trouvent du regard. En effet, on peut lire dans leurs yeux l’espoir propre au désir, en même temps que le trouble de s’être trouvés et l’audace de soutenir le regard de l’autre. Tous les temps sont simultanément représentés dans cette photographie.
--> Voir le
dossier Tendances de la photographie contemporaine
![]()
Montage et découpage : les limites du cadre
Dans les arts plastiques comme au cinéma, la question du montage est l’occasion d’une réflexion sur les limites du champ visuel. Au cinéma, le montage peut donner à voir ce qui, dans un plan précédent, se laissait deviner hors champ, tandis que dans les arts plastiques, il ouvre une réflexion sur les limites du cadre.





![]() Steve
Mc Queen, Deadpan, 1997
Steve
Mc Queen, Deadpan, 1997
1 vidéoprojecteur, 1 bande vidéo,
muet, n/b
A la croisée du cinéma et des arts plastiques, cette vidéo du jeune artiste britannique Steve Mc Queen utilise le cinéma comme l’un de ses matériaux de base. Tournée en 16 mm, puis transférée sur un support vidéo, elle cite une scène du film de Buster Keaton, Streamboat Bill Jr, 1928, où le personnage principal, pris dans un ouragan, reçoit le mur d’une maison sur la tête. Fort heureusement, le cadre d’une fenêtre découpe un espace suffisant pour l’épargner et laisser passer son corps.
Steve Mc Queen parodie cette cascade à la fois drôle et périlleuse où le cadre s’impose violemment au personnage qu’il isole du monde. La scène est montrée plusieurs fois, selon des points de vue extrêmes et décentrés, insistant sur la fragilité du sujet représenté et sur la force du créateur qui découpe et recoud le réel. Avec cette vidéo, Steve Mc Queen se réfère tout aussi bien à la tradition picturale de l’autoportrait qu’au cinéma : en se mettant lui-même en scène, il propose une image ambivalente de l’artiste, entre créature et créateur, comme l’évoquait déjà l’autoportrait en Méduse du Caravage.
--> Pour en savoir plus sur Steve Mc Queen, voir le
site de la galerie Marian Goodman, son représentant en France ![]() www.mariangoodman.com
www.mariangoodman.com
Le dispositif cinématographique, constitué d’un projecteur et d’un écran dans un espace, se caractérise par un jeu d’obstacles à franchir. La pellicule, l’espace de la salle s’interposent entre la source lumineuse et l’écran. Projecteur, lumière, pellicule, espace, écran… des artistes s’inspirent de ce dispositif en modifiant un ou plusieurs de ses composantes. Certaines œuvres remplacent la pellicule par l’installation d’un dispositif, par exemple chez Mona Hatoum, d’autres se substituent à l’écran, les peintures de Pollock notamment. Elles utilisent parfois la source lumineuse pour créer des formes en mouvement : c’est le cas dans le travail de Moholy-Nagy . Parfois, le film est un outil pour mieux voir comme chez Bruce Nauman. Parfois enfin, c’est la peinture qui permet de mieux percevoir la nature du film.
Le pouvoir de la lumière : créer des formes éphémères
Si les jeux d’ombres sont des pratiques ancestrales, comme en témoigne par exemple le passage où Platon, dans La République (vers 385 av. JC), raconte l’allégorie de la caverne, le cinéma a pu renouveler l’intérêt qu’on leur porte. Le cinéma attire l’attention sur la magie de la lumière et engage des artistes à développer leur travail dans ce sens.

![]() Constantin Brancusi, Léda,
1926
Constantin Brancusi, Léda,
1926
Photogramme tiré vers 1936 d’un fragment
de film en 35 mm
Epreuve aux sels d’argent, 23,9 x 29,9 cm
Si, dès le début du siècle, Constantin Brancusi fait appel à des photographes pour conserver la mémoire de ses œuvres, autour de 1914 il décide de photographier lui-même les œuvres qui peuplent son atelier. Puis, au début des années 30 il acquiert une caméra pour les filmer. Ce passage d’un outil à l’autre montre la maturité acquise dans son œuvre. En effet, à cette époque, Brancusi voulant associer à leur présence physique leur développement dans le temps, anime certaines de ses sculptures de mouvement.
Pour Léda, par exemple, sculpture en bronze polie créée quelques années auparavant, il fixe sous le disque en acier poli, dans lequel Léda se reflète, un moteur et un roulement à billes qui donnent à l’œuvre une dimension spatiale et temporelle renouvelée, créant un jeu d’ombres et de lumière inépuisé. Le film a pour fonction de fixer cette beauté éphémère.
--> Voir le dossier
Brancusi
![]()

![]() Laszlo Moholy-Nagy, Ein Lichtspiel
schwarz-weiss-grau, 1930
Laszlo Moholy-Nagy, Ein Lichtspiel
schwarz-weiss-grau, 1930
Film cinématographique 35 mm noir et blanc, silencieux,
durée : 7’30’’
Laszlo Moholy-Nagy est l’un des premiers artistes à s’intéresser à la lumière comme moyen direct de création. Dès 1919, il crée des photogrammes, des photographies réalisées sans appareil, en posant des objets sur du papier sensible qu’il expose sous une lampe. La lumière fait œuvre, d’une manière presque autonome.
Développant cette idée, il crée autour de 1922 des sculptures motorisées qu’il appelle Light-Space-Modulator. Composées de pièces de métal et de verre, ces sculptures sont éclairées par des projecteurs. Elles captent alors la lumière et projettent leurs formes sur les murs environnants dans un jeu d’éclats, d’ombres et de reflets. C’est cette danse de la lumière dans l’espace que donne à voir le film Ein Lichtspiel schwarz-weiss-grau.
--> Pour en savoir plus sur Laszlo Moholy-Nagy, voir le
site de la fondation qui lui est dédiée
![]() www.moholy-nagy.org
www.moholy-nagy.org

![]() Mona Hatoum, Light Sentence,
1992
Mona Hatoum, Light Sentence,
1992
Treillis métallique, moteur électrique, minuteur, ampoule,
câbles, fil électrique
L’installation construite par Mona Hatoum prolonge les recherches de Moholy-Nagy, tout en proposant un système plus minimaliste. Réalisée à l’aide de casiers métalliques manufacturés, et d’une ampoule animée d’un mouvement vertical, elle produit un jeu d’ombres et de lumière qui occupe l’espace entier de la salle d’exposition. Mais son dépouillement procure à la lumière une solennité et une monumentalité, contrastées par la régularité de la structure métallique qui évoque l’enfermement.
Produisant un effet oscillant entre la sérénité et l’oppression, cette pièce transforme la projection lumineuse en un moyen d’expression à part entière.
La projection comme redoublement du réel : un outil pour mieux voir
La projection, ici entendue comme la projection d’un film, peut aussi être un outil d’observation, à condition que le film soit une copie conforme du réel qui exacerbe ses détails.

![]() Bruce Nauman, MAPPING THE
STUDIO II
Bruce Nauman, MAPPING THE
STUDIO II
With Color Shift, Flip, Flop & Flip/Flop (Fat Chance John Cage),
2001
Installation vidéo, 7 DVDs, couleur, son
Cette installation se compose de quarante-deux bandes vidéo, enregistrées pendant quarante-deux nuits, diffusées simultanément par sept projecteurs sur les quatre murs d’une salle. A la profusion de ce matériel, répond l’apparente pauvreté du sujet de ces films : le studio de l’artiste, la nuit, pendant son absence. Réalisées grâce à des caméras à infrarouge qui, telles des caméras de surveillance, tournent en plan fixe, les images projetées sont quasi immobiles. Sans artiste, sans sujet, sans mouvement, elles semblent d’un minimalisme radical. Et pourtant, elles sont peuplées de micro-événements : quelques bruits de souris, un chat qui passe, des lucioles.
Contrairement à Mapping the Studio I où l’enregistrement n’a pas été manipulé, ici l’artiste a colorisé des séquences. Certaines sont inversées ou retournées, créant des « flip, flop » (des « sauts »). On aperçoit du matériel qui a pu, ou va servir. En somme, ces bandes vidéo révèlent toute une vie sous-jacente, infime ou potentielle que l’œil nu ne saurait voir. De même que John Cage, à qui est dédiée cette pièce, faisait écouter le silence pour qu’on en découvre la richesse, Bruce Nauman montre le travail du presque rien, l’activité du studio qui, bien que ténue, se poursuit tout de même sans lui.
La projection de ces bandes permet de découvrir cette activité minuscule mais déterminante pour l’artiste en ce qu’elle constitue la base nécessaire à l’élaboration de son travail. L’activité du studio répond à la question du commencement de l’œuvre.
Le tableau comme écran : la projection appliquée à la peinture
Dans le dispositif de projection cinématographique, une distance sépare l’image de sa source lumineuse. Des œuvres picturales comblent (Jackson Pollock) ou font sentir cette distance (Gerhard Richter). En effet, le recours à un médium - qui nous est de moins en moins familier - fournit une occasion de penser la nature des images mécaniques.
![]() Jackson Pollock, Number 26 A,
1948
Jackson Pollock, Number 26 A,
1948
Peinture glycérophtalique sur toile
205 x 121,7 cm
Dation, 1984
AM 1984-312
Le peintre comme projecteur, la peinture comme projection,
le tableau comme écran… le travail de Jackson Pollock est ici proposé sous
un angle nouveau.
Travaillant debout, au milieu de son œuvre, Jackson Pollock systématise,
autour de 1948, le dripping, technique qui consiste à laisser
couler une peinture liquide sur la toile, soit en perçant directement le
pot, soit à
l’aide de bâtons. Au lieu du face à face traditionnel du peintre avec son
chevalet qui autorise un regard distancié, le dripping place
Pollock au cœur de sa peinture qui devient une trace de sa présence sur la
toile. La technique de Pollock instaure une proximité intense entre l’artiste
et sa toile.

![]() Gerhard Richter, Chinon,
1987
Gerhard Richter, Chinon,
1987
Huile sur toile
200 x 320 cm
Contre cette absorption de l’artiste par sa toile telle que Pollock l’a mise en œuvre, les peintres de la génération suivante réagissent en instaurant de nouveau une distance avec l’image. L’utilisation du modèle photographique a été l’un des moyens pour y parvenir.
Gerhard Richter utilise des photographies qu’il projette sur un mur
pour réaliser ses peintures, opération qu’il indique par une mise au point
volontairement défaillante que traduit l’aspect flou de ses images. Les
photos qu’il choisit sont des photographies de famille, ou de reportage,
ou comme ici un paysage, sans qualités particulières. Ce ne sont surtout
pas des photographies d’art. Au contraire, en calquant ses tableaux sur
des images anonymes, il réduit la peinture à une simple photographie que
tout le monde peut faire avec n’importe quel appareil photo automatique.
La peinture devient alors elle-même une activité mécanique qui se passe
d’un auteur. Gerhard Richter évacue de la peinture la subjectivité de l’artiste
qui, traditionnellement, l’accompagne.
La projection d’une image photographique sépare l’artiste de
son
œuvre.
Défilement, montage, projection : ces trois composantes cinématographiques mises en exergue par le cinéma expérimental ont inspiré ou imprégné l’œuvre de nombreux artistes. Mais ceux-ci interrogent et exploitent aussi certaines caractéristiques du cinéma de fiction : ses héros (Mimmo Rotella), ses modèles narratifs (Fischli/Weiss), ses recettes pour maintenir le spectateur en haleine (Longo)….
La fascination des héros : la représentation des personnages de fiction en peinture
Les personnages de fiction sont l’occasion pour les artistes de revisiter l’art du portrait, en même temps que de révéler leur impact en tant que représentations sociales.

![]() Mimmo Rotella, Batman, 1968-98
Mimmo Rotella, Batman, 1968-98
Décollage sur toile
190 x 140 cm
Composée à partir d’affiches prélevées sur les murs de la ville, cette œuvre évoque
la popularité du personnage de Batman et l’imaginaire qu’il véhicule. Contrairement
aux affiches décollées de Raymons Hains et de Jacques de la Villeglé qui
privilégient la composition spontanée et abstraite, celles de Rotella,
commencées au même moment, au début des années cinquante, favorisent l’iconographie
et constituent un important témoignage sociologique.



![]() Robert Longo, Men in the cities,
1980-99
Robert Longo, Men in the cities,
1980-99
Triptyque
Fusain et crayon sur papier contrecollé sur
carton
Chaque panneau : 244 x 142,5 cm
A mi-chemin entre le hip hop et les figures figées de Pompéi, les personnages de Robert Longo, dessinés au fusain, évoquent la mort au cinéma et l’exercice de style qu’elle devient pour les acteurs. Jouer la mort d’un gangster implique d’attirer l’attention sur l’impact de la balle qui l’atteint, en même temps qu’il tombe avec une grâce fluide proche de la danse.
Cette toile fait partie d’une série dans laquelle Robert Longo a travaillé sur ce jeu d’acteurs, rôle qu’il fait jouer par des amis. Il prend des photos, les projette en diapositives pour dessiner les personnages, et épure les formes pour les rendre génériques. Enfin, il sélectionne les images qui montrent différentes positions du corps pour les juxtaposer comme une suite musicale dans de grands polyptiques. Présentées de cette manière, ses images acquièrent une dimension monumentale qui souligne l’importance de la mort au cinéma en tant que représentation collective.
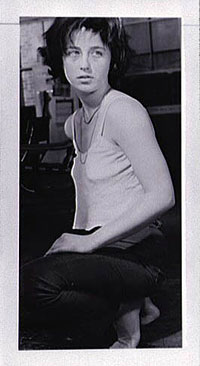
![]() Cindy Sherman, Sans titre,
1981
Cindy Sherman, Sans titre,
1981
Cibachrome
123,5 x 60,2 cm
Dès la fin des années 70, les photographies de Cindy Sherman construisent des fictions en s’inspirant du cinéma. L’artiste se déguise, joue des rôles, parodiant les clichés de femmes fatales, ingénues ou dociles. A partir des années 80, celles-ci incarnent des personnages de plus en plus inquiets. Sur cette photographie de 1981, le regard de la jeune femme, fixé sur ce qui pour nous est hors champ, exprime une interrogation mêlée de méfiance.
Plus tard les photographies de Cindy Sherman porteront cette inquiétude au comble de l’horreur pour manifester la violence exercée à l’encontre de la femme lorsqu’elle est traitée comme un objet.
--> Voir le dossier Tendances
de la photographie contemporaine ![]()
Les recettes narratives : l’art parodie le cinéma
Le travail artistique parodie aussi le cinéma de fiction pour révéler ses procédés mystificateurs : de la prétention didactique des dialogues solennels à la construction d’un suspense grâce à un montage saccadé, toutes ces recettes narratives sont tournées en dérision.
![]() Fischli & Weiss, Le Droit
Chemin (Der Rechte Weg), 1983
Fischli & Weiss, Le Droit
Chemin (Der Rechte Weg), 1983
Betacam numérique PAL, couleur,
son
005200
Achat, 2003
AM 2003-359
Après La Voie de la moindre résistance, film tourné à Hollywood en 8 mm parodiant une enquête policière dans le monde de l’art, les artistes Fischli & Weiss réalise Le Droit chemin avec les mêmes personnages : un rat gigantesque et un panda en peluche.
Tourné en 16mm, le film parodie cette fois-ci le cinéma moralisateur qui propose aux spectateurs des leçons sur la vie. Le scénario propose une histoire édifiante et grotesque à la fois : les deux personnages se rencontrent en pleine nature, dans une forêt, et apprennent laborieusement à se connaître au cours d’une quête qui sera celle de leur vie. Ils partent en effet à la recherche de l’origine du rat qui serait né d’une racine. A travers des dialogues grandiloquents qui contrastent avec le déguisement des artistes, et la traversée de paysages variés, Fischli & Weiss se jouent du sérieux du cinéma professionnel.
A ce film on peut comparer celui de l’artiste canadien Mark Lewis présenté dans l’exposition, Two Impossible films, 1995-1997. Réalisé en 35 mm et en cinémascope, il se réduit aux génériques de deux films qui n’ont jamais existé : une adaptation du Capital de Marx par Eisenstein, et un film avec Freud. Un montage rapide, des extraits de dialogues percutants et une musique à suspense rythment ces génériques qui, ainsi dépourvus de suite, décodent tous les artifices propres à séduire les spectateurs de cinéma.
--> Voir un extrait du film dans l’Encyclopédie
des nouveaux médias ![]()
La peinture comme storyboard : la transposition picturale des ébauches narratives
La peinture s’inspire aussi des méthodes d’élaboration de fictions telles qu’elles se pratiquent au cinéma. Du simple croquis au storyboard complet qui présente le déroulement de l’histoire, ces éléments guident la réalisation de l’œuvre. Ils rencontrent l’intérêt que les peintres portent, depuis l’Art conceptuel, au processus de réalisation plutôt qu’au résultat, et leur suggèrent de nouvelles formes polyptiques.
![]() Bruno Perramant, Révolution,
2001
Bruno Perramant, Révolution,
2001
Polyptique de 5 toiles
Huile sur toile
Achat, 2004
AM 2004-40
Composée de deux grands paysages et de trois tableaux de plus petit format, cette œuvre inspirée d’un documentaire sur le terrorisme dans les années 70 morcelle son sujet en séparant ses différentes composantes, le cadre spatial, les personnages, répartis sur plusieurs supports. Ainsi étudiées tour à tour, elles sont comme des repérages, des notes prises pour un tournage ou un casting, avec des agrandissements et des plans larges. Mais ces éléments se rassemblent d’eux-mêmes autour de la question que l’on devine écrite sur l’un des paysages : « Mais tous ces morts ?». Grâce à cet ensemble, l’artiste propose un embryon de narration.
![]() Francis
Alÿs, Sans titre,
1997
Francis
Alÿs, Sans titre,
1997
Installation murale de 22 dessins
Crayon, encre, crayon de couleur, collages
de photographies et d'illustrations de magazine, peinture à l'huile sur
papier
120 x 200 cm
Achat, 2004
AM 2004-165
Francis Alÿs travaille la peinture sous forme de projet, allant parfois de la plus simple esquisse à la série monumentale. Inspiré par la culture populaire aussi bien du point de vue iconographique que dans ses méthodes de travail parfois collectives, il restitue à la peinture une modestie qui la rapproche de notre quotidien. Travaillant lui-même la vidéo, il la traite comme une image parmi d’autres et dévoile toutes les étapes qui mènent à son élaboration.
Avec cette œuvre de 1997, composée de divers éléments sur papier, comprenant des dessins, des collages, de la peinture, simplement fixés au mur par des scotchs, il révèle la mise en place d’une forme, la marionnette d’un ventriloque, qu’il fait évoluer dans son univers graphique. Cette œuvre permet de suivre l’évolution tant formelle qu’iconographique de ce petit personnage, comme s’il s’agissait d’un projet d’animation.
1877
- Emile Reynaud invente le Praxinoscope, un dispositif
qui permet de voir une animation à
travers un cylindre à facettes de miroirs, dans lesquelles se reflètent des
images peintes. C’est le premier dispositif d’images en mouvement.
1882
- Etienne-Jules Marey construit un fusil photographique grâce auquel
il invente la chronophotographie.
1891
- Thomas Edison invente une caméra et un appareil de vision individuel
qui reconstitue le mouvement des images : le Kinétographe et
le Kinétoscope. Il manque encore au cinéma la possibilité d’être
projeté sur écran et d’acquérir ainsi une dimension publique.
1895
- Louis Lumière dépose un brevet pour le cinématographe et
organise les premières projections de ses films.
1896
- Georges Méliès tourne ses premiers films. Ils sont ensuite colorisés
manuellement.
1900
- A l’Exposition universelle de Paris, le cinéma
est la principale attraction.
1905
- Premiers coloriages de films au pochoir.
1911
- Un studio de cinéma s’installe dans la banlieue de Los Angeles, à
Hollywood.
1915
- Invention de la caméra Technicolor qui
enregistre en deux couleurs sur deux négatifs différents. L’ajout d’une
troisième
couleur n’est possible qu’en 1932.
1916
- Les futuristes italiens publient le manifeste de la Cinématographie
futuriste qui définit le cinéma comme une synthèse de
tous les arts.
1924
- Au théâtre des Champs-Elysées, Réné Clair présente Entracte,
un film expérimental avec, entre autres, Marcel Duchamp, projeté à l’entracte
d’un ballet non moins expérimental d’Eric Satie et Francis Picabia, intitulé Relâche.
- Ballet
mécanique de Fernand Léger.
1927
- Abel Gance présente Napoléon, un
film réalisé avec
trois caméras pour être projeté sur trois écrans distincts.
1928
Diffusion aux Etats-Unis du premier film parlant, Lights of New
York, de Bryan Foy.
1929
- Exposition Film und Foto à Stuttgart où sont exposés
des films et des photos d’artistes plasticiens qui remettent en cause la
peinture.
-
Salvador Dali et Louis Buñuel tournent Un Chien andalou,
puis, l’année suivante, L’Âge d’or.
1952
- Premier film de Stan Brakhage, cinéaste qualifié de
« ciné-artiste » par Jonas Mekas.
1955
- Robert Breer réalise Image by Image,
un film composé de
240 photogrammes différents qui crée un effet de battement d’images.
1962
- Premier film de Paul Sharits, le grand « coloriste » du
cinéma expérimental.
1963
- Première exposition des peintures inspirées
de photographies de Gerhard Richter.
-
Andy Warhol réalise son premier film, Sleep,
qui montre un dormeur pendant toute la durée de son sommeil.
1969
- Le film Hand Catching Lead de Richard
Serra est projeté pour la première fois à
New York dans le cadre d’une exposition intitulée « Anti-Illusion. Procedures/Materials ».
1971
- Michael Snow présente La Région centrale,
un film de plus de trois heures, réalisé par une caméra fixée à un bras
mécanique
animé d’un mouvement autonome. C’est un film sans cinéaste.
- Line describing a Cone,
d’Anthony Mc Call, utilise
des fumigènes pour rendre visible le faisceau lumineux que diffuse le projecteur.
C’est un film sans écran.
1977
- Premières photographies de Cindy Sherman faisant référence au cinéma.
1978
- Premières photographies de Jeff Wall.
1981
- Premier film de Peter Fischli & David
Weiss, La Voie
de la moindre résistance.
1993
- 24h Psycho : l’artiste
écossais Douglas Gordon utilise le film d’Hitchcock au sein d’une installation.
Il sera suivi par Matthias Müller, Mark Lewis et bien d’autres, dans cette
référence concrète au cinéma.
2006
- Zidane, un portrait du 21e siècle, réalisé
par les artistes Philippe Parreno et Douglas Gordon, est présenté au Festival
de Cannes et diffusé par le circuit commercial.
- Le mouvement des images au Centre Pompidou
Essais sur le cinéma et les arts plastiques
- Cinéma, art(s) plastique(s), sous la dir.
de Pierre Taminiaux et Claude Murcia, L'Harmattan, Paris, 2004
-
Pierre-Damien
Huyghe, Du commun : philosophie
pour la peinture et le cinéma, Circé, Belfort, 2002
-
Françoise Parfait, « Vidéo et cinéma expérimental. Des
différences et des répétitions », Vidéo : un art contemporain,
Editions du Regard, Paris, 2001
-
Walter Benjamin, « L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique », Œuvres
complètes III, Gallimard, Folio, 2000
-
Hollis Frampton, L’Ecliptique du savoir. Film, photographie,
vidéo, Editions Centre Pompidou, 1999
![]()
-
François Albera, « Les Passages entre les arts. Cinéma,
architecture, peinture, sculpture », Qu’est-ce que l’art au 20e
siècle, Fondation Cartier-Ensba, 1992
Catalogues d’exposition
- Le mouvement des images, Centre Pompidou,
2006 ![]()
- Cinéma,
peinture, cinéma, Editions Hazan, Paris, 1989
- L’Invention d’un art, Centre Pompidou, 1989 ![]()
Lien internet
- Les collections du Musée - « Le mouvement des images »
- A consulter : la bande annonce de l’exposition
(illustrations et extraits de films)
![]()
Contacts
Afinde répondre au mieux à vos attentes,
nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce document
Contacter : centre.ressources@centrepompidou.fr
Crédits
© Centre
Pompidou, Direction de l'action éducative et des publics, septembre
2006
Mise à jour : août 2007
Texte : Vanessa Morisset
Dossier en ligne sur
www.centrepompidou.fr/education/ rubrique ’Dossiers pédagogiques’
Maquette : Michel Fernandez
Coordination :
Marie-José Rodriguez