DE LA LETTRE À L'IMAGE
Un choix d‘œuvres dans les collections du Musée
René Magritte, Querelle des universaux, 1928
Huile sur toile, 53,5 x 72,5 cm
- Introduction
- La lettre, élément d'une chaîne
- La révolution mallarméenne
- Le grand chambardement des arts plastiques
- Un choix d'œuvres, des pistes à expérimenter
- La libération de la lettre et des mots
- F. T. Marinetti, une nouvelle conception de la page et de la lecture
- Guillaume Apollinaire, peindre la poésie
- Fauvisme et cubisme : la lettre, fragment de réalité
- Raoul Dufy, peinture et paysage urbain
- Pablo Picasso et les Papiers collés
- Le tableau-poème
- Sonia Delaunay, Blaise Cendrars, le premier livre simultané
- Dada : la liberté absolue en art
- Marcel Duchamp et Francis Picabia, le mot moteur de l'œuvre
- Raoul Hausmann, « Écouter avec les yeux, voir avec les oreilles »
- Kurt Schwitters, « Poésure et peintrie »
- Le surréalisme, littérature et arts plastiques
- René Magritte, représenter la pensée par la peinture
- La lettre et l'abstraction géométrique
- Auguste Herbin et son alphabet plastique
- Horacio Garcia-Rossi, le mouvement de la lettre
- Le lettrisme, la 3e voie après le figuratif et l'abstrait
- Isidore Isou, un surdoué pluridisciplinaire
- Proches de l'expressionnisme, deux peintres de l'écriture
- Christian Dotremont, sur les traces du Grand Nord
- Cy Twombly, l'expression du corps
- Fluxus, l'écriture et la vie
- Ben, la série des Introspections
- Mark Brusse, du « souvenir » à la « valeur historique »
- L'art, entre concept critique et poésie
- Marcel Broodthaers, un admirateur de Mallarmé et de Magritte
- Alighiero e Boetti, utilisateur et créateur de codes et d'alphabets
- Ed Ruscha, un « regardeur de mots »
- Jan Mančuška, la lettre dans un espace à trois dimensions
- Les affichistes, « le lacéré anonyme »
- Jacques Villeglé et l'affiche lacérée : un répertoire formel sans limite
- Bibliographie
- Introduction
INTRODUCTION
la lettre, ÉlÉment d’une chaÎne
La lettre a pour particularité de n’avoir aucune signification, de même elle n’est pas un son qui fait sens. Graphie sans lien avec le visuel ou l’expérience, au contraire des idéogrammes, elle n’existe que comme élément d’une chaîne. La lettre est liée à l’écriture et non au langage. L’Occident, qui l’a vue comme un outil abstrait, fut même fier de sa pauvreté sémantique, signe d’un grand progrès par rapport aux autres scripts. Pourtant, la lettre n’a pas toujours été prisonnière de la linéarité de l‘écriture.
Ainsi, côté poésie, depuis l’antiquité, fait-elle cause commune avec les mots pour créer des images. Les premiers poèmes-dessins sont attribués à Simmias de Rhodes, poète grec du 4e siècle avant Jésus-Christ. Ses textes en forme de hache ou en forme d’ailes seraient les premiers poèmes figurés, ancêtres des calligrammes. Le dessin par Rabelais de sa dive bouteille fait aussi partie des exemples célèbres. Au début du 19e siècle, avec la Restauration et la Monarchie de Juillet, la presse satirique s’amuse à agglomérer les lettres pour représenter, en forme de poire, la tête du roi Louis-Philippe. Au 16e siècle étaient également apparus, de façon furtive, les premiers vers libres.
Côté image, la lettre connaît son âge d’or avec l’enluminure au Moyen Âge où moines et scribes en font le prétexte à des univers − lettres-fleurs, lettres-animaux, lettres-hommes, lettres-objets −, sans oublier les nombreux alphabets qui vont du raffinement précieux à la cocasserie.1
Tout ceci, néanmoins, était considéré comme de « l’enfantillage ». Car si la peinture de chevalet découlait des enluminures, ce n’était pas pour revenir à des mondes en miniature. En poésie, le vers était strict et devait respecter les rimes, les pieds et les strophes. Le poème figuré n’apparaissait que comme un exercice ludique ou une prouesse virtuose. Cependant, la typographie commençait à prendre sa place et à créer des effets de sens.
La rÉvolution mallarmÉenne
Au milieu du 19e siècle, le poème en prose et le vers libre, avec Baudelaire, Rimbaud et les poètes symbolistes vont s’affranchir des règles de la poésie classique. Fin du 19e siècle, se fait jour une écriture poétique dont le pouvoir de suggestion tient autant à la musique, au dessin qu’à la typographie. Pour les historiens et les poètes, c’est à Mallarmé qu’il revient d’avoir donné une réalité poétique à toutes ces tentatives, certains artistes contemporains, comme Marcel Broodthaers par exemple, le voyant même à l’origine de l’art d’aujourd’hui.
En mai 1897, paraît dans la revue Cosmopolis, en onze doubles pages, avec des plages blanches entre les mots et les vers, Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Mallarmé substitue à l’ordre syntaxique des mots le rythme de la pensée et de la rêverie.
Dans le prolongement de la révolution mallarméenne du vers libre, Marinetti et Apollinaire, notamment, vont développer leurs propres formes d’expression, Marinetti avec ses Mots en liberté nés d’une théorie de l’écriture qui supprime toute syntaxe, Apollinaire avec ses Calligrammes où l’espace et le dessin des mots bouleversent la présentation du poème.
Le grand chambardement des arts plastiques
Pour être juste, la lettre n’est pas tout à fait absente de la peinture de chevalet. Comme l’écrit Michel Butor : « Des mots dans la peinture occidentale ? Dès qu’on a posé la question, on s’aperçoit qu’ils y sont innombrables, mais qu’on ne les a pour ainsi dire pas étudiés ».2 Mots intégrés à l’espace pictural − signature de l’artiste, phrase biblique, nom du donateur, mots à décrypter dont la mission est de faire dépasser le visible −, ou extérieurs − légendes, cartels, titres qui modifient totalement le regard…
Mais la lettre s’est, un moment, absentée (à part la signature) de la création plastique. De Courbet à Matisse en passant par les impressionnistes, les artistes de la modernité ont donné tout pouvoir au visible, l’art étant par essence ce qui ne peut se dire. Chassés d’un côté, le mot et la lettre allaient revenir de l’autre.
Car, parallèlement aux nouvelles formes d’écriture poétique, les artistes, au début du 20e siècle, remettent en cause les catégories artistiques (peinture, sculpture, dessin), ouvrent l’art à de nouveaux matériaux. L’introduction de la lettre dans les arts plastiques fait partie de ce grand chambardement. La révolution poétique y joue un grand rôle, d’autant que Marinetti et Apollinaire sont tous deux liés de très près au monde des arts plastiques. Mais pas seulement. Les artistes, par leur culture visuelle et leur pouvoir d‘interroger ou de montrer le monde, ouvrent de nouveaux espaces où ils n’habillent plus la lettre mais la prennent telle qu’elle est, comme matériau plastique. De ces recherches plastiques sont nées une multitude d’expressions dont a témoigné l’exposition Poésure et peintrie, « d’un art l’autre », organisée au Centre de la Vieille Charité à Marseille en 1993.
Un choix d’œuvres, des pistes À expÉrimenter
Ce dossier, réalisé à l’occasion de l’exposition De la lettre à l’image destinée aux publics jeunes, propose un éclairage sur les utilisations de la lettre par les artistes. La plupart des œuvres choisies ont été exposées en 2012, dans les accrochages moderne et contemporain du Musée, des œuvres qui retracent quelques-unes des grandes transformations de l’art depuis le début du 20e siècle, en même temps qu’elles s’offrent comme autant de démarches à expérimenter.
Ainsi, l’introduction de la lettre et du mot dans la peinture se fera tout en douceur avec une œuvre de Raoul Dufy qui ouvre son espace aux signes de la ville moderne, tandis que Picasso les intègre quelques années plus tard comme des indices du réel dans ses tableaux cubistes. Avec Blaise Cendrars et Sonia Delaunay naît le tableau-poème. Puis, avec les dadaïstes, lettres et mots participent au décloisonnement des disciplines, Marcel Duchamp et Francis Picabia en font le moteur ironique de leurs curieux objets, Raoul Hausmann et Kurt Schwitters un matériau à la fois visuel et sonore. Avec René Magritte, un des maîtres du surréalisme, ils sont utilisés pour penser, sur la toile même, la peinture.
Quelques exemples très typés sont ensuite présentés, allant du lettrisme avec Isidore Isou, à différentes manifestations proches de l’art conceptuel, Alighiero e Boetti, Marcel Broodthaers, Ed Ruscha, Jan Mančuška, en passant par deux peintres de l‘écriture, Christian Dotremont et Cy Twombly, le mouvement Fluxus, l’abstraction géométrique et les affichistes.
La libÉration de la lettre et des mots
Fin du 19e, début du 20e siècle, la science et la technique dévoilent de nouvelles interprétations du monde, créent de nouveaux objets, de nouvelles sensations, de nouvelles images − photographiques, cinématographiques, publicitaires. L’accès à l’enseignement, à l’écriture et à la lecture notamment, est devenu obligatoire3. L’art se transforme, façonné par ce monde nouveau en même temps qu’il en témoigne ou l’interroge. Après Mallarmé, Marinetti et Apollinaire ébranlent l’académisme de l’écriture poétique, jetant des ponts entre poésie et peinture.
Filippo Tommaso Marinetti, une nouvelle conception de la page et de la lecture
1876, Alexandrie (Égypte) – 1944, Bellagio (Italie)
Les mots en liberté
Filippo Tommaso Marinetti, Mots en liberté : trains (vers 1910)
Encre noire sur feuille de papier pliée en quatre et dépliée, 30,9 x 42,1 cm
Filippo Tommaso Marinetti est très tôt « fasciné par la culture de l’écrit telle qu’elle se manifeste au sein de la ville moderne, à travers l’affiche, le tract politique, la colonne Morris ou l’étalage du kiosque à journaux ».4 À Paris, après une enfance et une adolescence passée en Egypte, fréquentant les milieux anarchistes et les poètes symbolistes, il veut libérer la poésie de ses règles, tant dans sa tradition orale qu’écrite. Son intérêt pour l’impact visuel des signes imprimés s’exprime déjà dans son long poème La momie sanglante (1904), où des lignes et même des pages de points s’alignent. L’année suivante, il publie ses premiers textes sur l’automobile et lance sa revue Poesia, revue franco-italienne où apparaît, à travers la typographie − diversité des caractères et ruptures d’échelle −, une nouvelle conception de la page et de la lecture. En 1909, Marinetti publie le Manifeste futuriste dans Le Figaro. S’adressant « à tous hommes vivants de la terre », il y prône la vitesse, la destruction des musées et des bibliothèques, la beauté du monde moderne et des machines, un « art-action » comme acte de participation à la vie. S’il est avant tout littéraire, ce manifeste rallie très vite une jeune avant-garde picturale, désireuse de faire table rase du passé. La même année, dans sa revue ouverte à tous les poètes modernes, Marinetti lance une grande enquête sur le vers libre.
En février 1910, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla et Gino Severini publient le Manifeste des peintres futuristes qui exalte un art de l’élan vital, un art qui témoigne de la vitesse, de la simultanéité des couleurs, des formes et des sens (la synesthésie). De nombreux manifestes seront publiés par les futuristes dans ces années 1910.
Avec son Manifeste technique de la littérature futuriste, publié en mai 1912, Marinetti revendique la destruction de la syntaxe, la suppression des temps des verbes, des adjectifs, de la ponctuation ainsi que la disposition des substantifs sur la page « au hasard de leur naissance », pour suggérer la dynamis, la sensation vitale. En juin 1913, dans son manifeste Imagination sans fils et les mots en liberté, il préconise en particulier une révolution typographique par l’utilisation d’encres de couleurs différentes et de plusieurs caractères dans la même page.
C’est dans son ouvrage Zang Tumb Tumb que tous ces partis pris prennent forme et, avant qu’il ne soit publié en mars 1914, Marinetti en déclamera des extraits entiers dans les capitales européennes, Rome, Paris, Londres, Berlin où, souvent, en même temps, seront exposés les peintres italiens.
Comme l’explique Giovanni Lista, biographe de Marinetti, cette nouvelle poésie orale ne pouvait que s’accompagner d’une nouvelle poésie écrite : « Toute l’expérimentation futuriste […] se déroulera par déplacements continus et parfois contradictoires entre ces deux valeurs ; la dynamis et la physis, autrement dit entre la volonté de faire de la poésie un sismographe de l’action, et la recherche d’une expression de la matière impliquant un nouveau institutionnel du livre. […] L’écrit devait par conséquent s’émanciper de sa nature purement technique de forme d‘enregistrement afin d’atteindre une nouvelle matérialité. » La poésie a intégré les avancées de la peinture futuriste et réciproquement : la simultanéité et le dynamisme. Mots, lettres et ponctuation rendent sensible l’agitation de la vie moderne, de ses bruits, couleurs, formes. Ce sont les Mots en liberté, expression forgée par Marinetti et dont va s’inspirer Apollinaire pour ses Calligrammes.
Pour en savoir plus sur Marinetti, consulter le dossier pédagogique Le Futurisme à Paris. Une avant-garde explosive, chapitre 2.
Sur You Tube, écouter la lecture de Zang Tumb Tumb.
Guillaume Apollinaire, peindre la poÉsie
1880, Rome (Italie) − 1918, Paris (France)
Créer une langue nouvelle dans un monde nouveau
Guillaume Apollinaire, La Mandoline, l'Œillet et le Bambou
Titre attribué : Calligramme de la série Étendards [1914 / 1915]
Encre sur 3 morceaux de papier, 27,5 x 21 cm
Guillaume Apollinaire publie son premier calligramme, Lettre-océan, en 1914 dans sa revue Les Soirées de Paris. Il ne l’appelle d’ailleurs pas calligramme, mais idéogramme lyrique (puis poème idéographique) − idéogramme au sens où il s’agit d’un signe qui transmet, non les sons du mot, mais l’idée elle-même, et lyrique pour évoquer « un « lyrisme visuel » né de l’audace « des artifices typographiques ».5 Le mot calligramme n’apparaît qu’en 1917.
La Mandoline, l'Œillet et le Bambou compte donc parmi ses premiers idéogrammes lyriques. Le titre donne l’ordre dans lequel le poème est censé être lu, mais le lecteur est libre de le lire comme il l’entend. Formes graphiques et sens s’enrichissent mutuellement. Les trois objets représentés s’inscrivent dans une dynamique : le manche de la mandoline, le bambou et la tige de l’œillet forment un triangle autour duquel s’organisent des formes souples et arrondies. On note la forme de la mandoline dont le manche s’élève comme un clairon et les majuscules qui en soulignent l’épaisseur, en même temps qu’elles renforcent le message écrit. 1914-1915, Apollinaire est au front. La guerre a fait trembler la terre.
Ô batailles la terre tremble comme une mandoline
FEMME COMME LA BALLE À TRAVERS LE CORPS LE SON
TRAVERSE la vérité car la RAISON c’est ton Art
L’œillet, divisé en deux parties, la fleur et la tige, évoque le thème de la féminité, poème d’amour d’un soldat sur le front, désirant un monde nouveau où la sagesse ne viendrait pas des mots mais du nez et des odeurs.
Que cet œillet te dise
la loi des odeurs
qu’on n’a pas encore
promulguée et qui viendra
un jour
régner sur
nos cerveaux
bien +
précise & + subtile
que les sons qui nous dirigent
Je préfère ton nez
à tous tes organes
ô mon amie
Il est le trône de la futur SAGESSE
Le bambou coupé ramène à un univers plus masculin, par sa forme sans doute mais aussi par les odeurs évoquées.
O
nez de la pipe les odeurs cendre
fourneau y forgent les chaînes
O
univers infiniment déliées qui lient les
autres raisons formelles
Biographie
Sensible à la place des mots sur le blanc de la page, Guillaume Apollinaire en vient à redisposer ses premiers poèmes – coupes des vers, lignes inégales − pour leur publication dans Alcools en 1913, comme Les Colchiques, poème écrit en 1901 selon une forme classique en quatorze alexandrins, qu’il ajoute à ses nouvelles productions. Ce serait après avoir entendu Cendrars lire son poème La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France qu’il aurait décidé, au dernier moment, de supprimer la ponctuation (voir chapitre Le tableau-poème). En juin 1913, il publie l’Antitradition. Manifeste futuriste, où la disposition dynamique des mots sur la feuille montre l’influence des futuristes et de Marinetti.
En 1914, il crée ses premiers calligrammes auxquels il donne pour filiation le vers libre. Mais son but, précise-t-il, n’est pas de détruire, il se veut « bâtisseur ». S’il est un amoureux inconstant, son engagement au service de l’art est total, reconnaissant parmi les premiers des artistes tels que Picasso, Matisse, Braque, Dufy…, les défendant envers et contre tous dans ses nombreuses chroniques. Encourageant sans cesse le dialogue entre poésie et peinture, il défend les mouvements d’avant-garde littéraires et picturaux. Il veut, avec ses calligrammes, « peindre la poésie ».
En 1917, alors qu’il est réformé suite à une blessure à la tête (voir le tableau de Giorgio de Chirico, Portrait prémonitoire de Guillaume Apollinaire, 1914), désormais critique sur la violence d’une guerre mortifère, attentif aux recherches verbi-voco-visuelles des dadaïstes (voir le chapitre : Dada : la liberté absolue en art), il est, lui aussi, dans l’attente d’une langue nouvelle, comme en témoigne son poème la Victoire.
Ô bouches l'homme est à la recherche d'un nouveau langage
Auquel le grammairien d'aucune langue n'aura rien à dire
Et ces vieilles langues sont tellement près de mourir
Que c'est vraiment par habitude et manque d'audace
Qu'on les fait encore servir à la poésie
[…]
On veut de nouveaux sons de nouveaux sons de nouveaux sons
On veut des consonnes sans voyelles
Des consonnes qui pètent sourdement
Imitez le son de la toupie
Laissez pétiller un son nasal et continu
Faites claquer votre langue
Extrait de la Victoire
Première publication en 1917 dans la revue Nord-Sud
Âgé de 38 ans, il meurt, en 1918, d’une grippe espagnole. Quelle suite aurait-il donnée à ses calligrammes ? Apollinaire n’a pas eu de disciple à proprement parler, mais les rapports de complémentarité qu’il a créés entre mots et images ont suscité de nombreuses inventions, tels les poèmes-paysages ou les poèmes-affiches de Pierre Albert-Birot.
Fauvisme et cubisme : la lettre, fragment de rÉalité
Parallèlement à la transformation de l’écriture poétique, des peintres de paysage, tel Dufy qui peint des affiches publicitaires sur le bord de la plage, introduisent dans leurs toiles des lettres et des mots. Pour Picasso et Braque, la lettre fait partie de ces fragments de réel qu’ils mettent dans leurs tableaux pour leur redonner vie et échapper à l’abstraction du cubisme.
Raoul Dufy, peinture et paysage urbain
1877, Le Havre (France) - 1953, Forcalquier (France)
Dos à la mer, ils peignent les réclames
Raoul Dufy, Les affiches à Trouville, 1906
Huile sur toile, 65 cm x 81 cm
En 1906, Raoul Dufy, peintre normand amoureux des paysages et des bords de mer, se retrouve avec son ami Albert Marquet à Trouville. Installés dos à la mer, tous deux peignent le mur d’affiches qui leur fait face, charpenté par les mots « VALS », « OPUS »… Marquet en peint une version, Dufy deux. Dufy aime en particulier la simplicité de ces formes géométriques qui délivrent leurs messages et la vivacité de leurs couleurs pures.
Dans la version appartenant aux collections du Musée, Dufy se sert du motif des affiches pour construire sa toile. Au premier plan, des personnages, peints en notes rapides et noires, créent un espace en mouvement. Au second plan, le mur d’affiches prolongé par les façades des maisons, à droite, érige un plan médium coloré et stable. Leurs inscriptions publicitaires sont les signes de la ville moderne. Le troisième plan, le ciel, en nuances de bleu et de gris, crée une forme triangulaire qui unifie l’espace du tableau.
Biographie
Dufy réalise cette œuvre en 1906, alors qu’influencé par Matisse, le « fauve », il travaille depuis deux ans avec Albert Marquet en Normandie. Comme beaucoup d’artistes à l’époque, la rétrospective de l’œuvre de Cézanne, en 1907, l’impressionne. Il rejoint l’année suivante Georges Braque, le « cubiste », à l’Estaque, pour travailler le volume.
Mais Dufy revient vite au travail de la couleur. Installé à Vence en 1919, sa palette retrouve son aspect éclatant. À la fois attiré par les aplats colorés et par un dessin directement issu du pinceau, proche d’une écriture, il est amené à séparer forme et couleur dans des compositions qui traduisent le bonheur de vivre.
Son œuvre lui vaut en 1952, un an avant sa mort, le Prix de Peinture à la Biennale de Venise.
PICASSO et les papiers collÉs
1881, Málaga (Espagne) – 1973, Mougins (France)
Renouer avec le réeL
Pablo Picasso, La Bouteille de vieux marc [printemps 1913]
Fusain, gouache, papiers collés et épinglés sur papier, 63 x 49 cm
À la suite de Cézanne, les peintres modernes mettent au rang des accessoires la perspective comme moyen de composition. Picasso et Braque s’interrogent sur la façon de traiter les volumes en deux dimensions. Leurs recherches les conduisent à déconstruire le motif, à en montrer sur un seul plan tous les points de vue, frôlant peu à peu l’abstraction. Dans la période du cubisme dite synthétique, à partir de 1912, les deux peintres reviennent à une simplicité des formes et introduisent dans leur peinture des morceaux de papier ou de menus objets pour renouer avec le réel. La Bouteille de vieux marc appartient à cette période.
La Bouteille de vieux marc représente, avec des formes simplifiées, un homme en train de lire son journal dans un café… Pour figurer le mur − lequel, à regarder de près, est aussi la table −, le peintre a collé un morceau de papier peint aux motifs géométriques. Et, sur le rebord de la table, comme une incitation à toucher, la représentation en relief d’une moulure de mur. À ce premier jeu visuel autour du motif du mur et de la table, s’en ajoute un autre né de la typographie des mots : les lettres de l’étiquette « Vieux Marc » dessinées au fusain, hésitantes, en minces capitales, sont opposées aux gros et solides caractères d’imprimerie de la coupure de journal. Laquelle coupure, posée sur la page que tient entre ses mains le lecteur − on voit dépasser le haut de son crâne −, l’est également sur la table. Elle a pour titre Le Journal.
L’introduction en 1912 de lettres, de mots, de coupures de journaux dans les papiers déchirés puis dans les toiles se poursuivra tout au long de l’œuvre de Picasso. Car ces lettres ou morceaux de journaux ne sont pas que de simples signes visuels, arbitrairement découpés, comme l’a montré, en 2003, l’exposition intitulée Picasso − Papiers journaux, organisée par le musée Picasso. L’écriture est pour lui une façon de connaître le réel. Curieux de tout, il accordait une grande importance à l’information et à la presse : « Je suis curieux, très curieux. […] Je lis les journaux, les revues, je les lis bien, je m’applique, et j’écoute les informations au poste. […] », a t-il pu dire. Chaque jour il lisait Le Journal et deux ou trois autres titres qu’il posait sur la table, ou qu’il tenait entre ses mains.
« Parmi tout ce qu’aura gardé Picasso, on trouve […] nombre de coupures, découpures ou déchirures de presse. Leur ensemble participerait d’une génétique de l’œuvre où le papier journal serait l’index du temps : temps présent ou déjà passé, temps de la vie, de l’œuvre mais aussi temps de l’Histoire. Petites histoires des faits divers, de la météo et des pages de divertissement, mais aussi histoire de tout un siècle. » (Anne Baldassari.)6
Biographie
Originaire d’Andalousie, Pablo Ruiz Picasso grandit à Barcelone. Son père est professeur à l’École des Beaux-arts où il est admis à l’âge de 14 ans, avant d’entrer à l’Académie royale de Madrid. Puis il découvre la vie de bohème, expose pour la première fois ses travaux dans un cabaret artistique et littéraire, Els Quatre Gats, et fréquente le Bordel du « Carrer D’Avinyo » qui lui inspirera l’un de ses plus célèbres tableaux, Les Demoiselles d’Avignon. En 1901, commence, après le suicide de son ami Casagemas, la période dite bleue, couleur dont il découvre le potentiel émotionnel.
À partir de 1904, il s’installe définitivement en France dans un atelier de Montmartre, le « Bateau-Lavoir », où il rencontre Fernande Olivier, fréquente des artistes, des écrivains, comme Gertrude Stein, des poètes, notamment Guillaume Apollinaire. Une époque heureuse qui se traduit par sa période dite rose.
En 1907, tandis qu’il peint Les Demoiselles d’Avignon, impressionné par la rétrospective Cézanne, il décide de travailler avec Georges Braque. Ensemble, ils aboutissent à la formulation du cubisme. La déclaration de guerre met un terme à leur collaboration.
En 1917, travaillant aux décors et costumes des Ballets russes, il rencontre Olga, une des danseuses de la troupe, qu’il épouse l’année suivante. Leur fils Paul naît en 1921.
Durant cette période d’accalmie sentimentale et de prospérité, Picasso pratique un retour à une forme d’art classique. Mais, dès 1925, il se rapproche de l’art surréaliste et s’intéresse de plus en plus à la sculpture. D’autres compagnes vont jalonner sa vie : Marie-Thérèse Walter (1927, mère de Maïa), Dora Maar (1936), Françoise Gilot (1943, mère de Claude et Paloma), Jacqueline Roque (qu’il rencontre en 1954 et épouse en 1961).
Le 27 avril 1937, le bombardement de la petite ville basque de Guernica, en Espagne, par l'aviation allemande au service des nationalistes franquistes, le bouleverse. Il peint Guernica qu’il expose au pavillon républicain de l’Exposition internationale de Paris, œuvre qui le rapproche du Parti communiste dont il devient membre.
À la fin des années 1940, il s’installe à Vallauris en Provence, entame une nouvelle carrière de céramiste, tout en réalisant des peintures, des sculptures, des terres cuites et autres objets. Dans les années 1960, il pose les bases d’un expressionnisme ludique, cocasse et provocateur, au style volontairement négligé, témoin d’un appétit de vivre.
Le tableau-poÈme
Au début des années 1910, nombreux sont les artistes qui se revendiquent inventeurs du tableau-poème : les futuristes, les peintres et poètes russes… Parmi les premiers tableaux-poèmes, peut-être le premier, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913, de Sonia Delaunay et Blaise Cendrars est une œuvre simultanée où les deux artistes mettent leur art au service d’un projet commun. Le procédé aura du succès, comme le montrent aujourd’hui les livres d’artistes réalisés conjointement par un plasticien et un poète.
Sonia Delaunay, Blaise Cendrars, le premier livre simultané
Sonia Delaunay, 1885, Gradizhsk (Russie) – 1979, Paris (France)
Blaise Cendrars, 1887, La Chaux-de-Fonds (Suisse) – 1961, Paris (France)
Saisir d’un seul regard texte et peinture
Sonia Delaunay, La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, 1913
Aquarelle, texte imprimé sur papier simili Japon, reliure parchemin peint, 199 x 36 cm
Dimensions de l'œuvre fermée : 18 cm x 11 cm
Sonia et Robert Delaunay qui connaissent Apollinaire depuis 1911 et l’ont même hébergé en novembre et décembre 1912 après l’affaire du vol de la Joconde, participent régulièrement aux soirées auxquelles le poète convie ses amis, au 202 du boulevard Saint-Germain. C’est là que le couple rencontre Blaise Cendrars, « un petit jeune homme frêle et blanc », raconte Sonia Delaunay dans ses mémoires, Nous irons jusqu’au soleil (éditions Laffont, 1978). Tous deux parlent le russe. Une complicité immédiate s’établit entre eux.7
Dès le lendemain, Blaise Cendrars confie à Sonia son petit livre récemment publié, Pâques à New York,un poème qui l’émeut par sa modernité et son rythme. Elle en réalise, avec beaucoup de liberté, la reliure, utilisant des matériaux d’une grande diversité − peau de chamois, papier, tissu − dans des formes géométriques astucieusement composées − une imbrication de triangles et de carrés, de lignes droites, d’obliques et de demi-courbes.
Peu de temps après, c’est La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France qu’il apporte, récit d’un voyage par un jeune poète, allant de Moscou à Kharbine, accompagné de Jehanne, petite prostituée. Un récit sans aucune ponctuation, livré au rythme interne des personnages − le poète et Jehanne, mais aussi les soldats russes qui montent sur le front de la guerre avec le Japon − et des arrêts et cadences du train.
Dans leur « présentation synchrone » de bleu, vert, rouge, orangé,… les formes géométriques de Sonia se déploient à gauche, épousant le rythme du texte de Blaise, 445 vers imprimés en 12 caractères différents. Destiné à être publié comme un livre, ce tableau-poème mesure 18 cm de haut quand il est plié et quasiment deux mètres quand il est déplié.
Une soixantaine d’exemplaires ont été réalisés au pochoir, à l’aquarelle. Le nombre prévu était de 150. Mis bout à bout, ils devaient égaler la hauteur de la Tour Eiffel, monument cher à Blaise aux pieds duquel, selon la légende, il aurait vu pour la première fois un wagon du Transsibérien lors d’une exposition universelle, ainsi qu’à Robert Delaunay dont on connaît la série de peintures sur la Tour et sur laquelle Cendrars composera un poème en août 1913.8
L’œuvre dépliée permet de saisir, d’un seul regard, de façon simultanée, texte et peinture « comme un chef d’orchestre lit d’un seul coup les notes superposées dans la partition », écrit Apollinaire dans les Soirées de Paris.9
Sonia Delaunay et Blaise Cendrars sont-ils les inventeurs du tableau-poème ? Les futuristes, ont déjà réalisé des œuvres où texte et image sont intimement liés, mais par un seul artiste, les Russes peut-être l’ont-ils déjà fait à quatre mains, mais qui en avait alors connaissance ?10
Biographie
Sonia Delaunay
Née en Ukraine, dans une famille ouvrière, Sonia Stern est adoptée par son oncle, avocat à Saint-Pétersbourg, à l’âge de cinq ans. Elevée dans un milieu cultivé, elle commence des études de dessin à Karsruhe, en Allemagne. Attirée par l’impressionnisme, elle s’installe à Paris en 1905, où elle découvre le fauvisme. Dans sa période fauve, Sonia fait éclater son goût pour les couleurs vives, comme dans Jeune Finlandaise ou Jeune fille endormie, deux toiles de 1907 appartenant aux collections du Musée. Sa première exposition personnelle est organisée en 1908. En 1909, elle réalise une première reliure pour les Œuvres de Rimbaud.
En 1910, elle épouse Robert Delaunay. « Nous nous sommes aimés dans l’art comme d’autres couples se sont unis dans la foi, dans le crime […] La passion de peindre a été notre lien principal », écrit-elle. Tout en continuant la peinture, se livrant à ses intuitions et à son goût, elle réalise des collages, des broderies, des reliures de livres…
Dès 1912, Sonia peint, dans le sillage de Robert, des toiles composées suivant la loi du « contraste simultané », loi découverte par Michel-Eugène Chevreul selon laquelle l’intensité d’une couleur varie en fonction de celles qui se trouvent à proximité, le maximum d’intensité naissant de la confrontation d’une couleur primaire et de sa complémentaire, par exemple le rouge confronté au vert, le bleu à l’orange. Mais, pour Sonia, la simultanéité prend un sens élargi, elle devient l’incarnation de la vie moderne, la simultanéité des moyens d’expression, la vision globale de l’œuvre… Outre Cendrars, elle collabore avec de nombreux artistes dont le poète Tristan Tzara, les chorégraphes Serge de Diaghilev et Léonide Massine pour des costumes de ballets, ou le cinéaste Marcel L’Herbier.
C’est surtout dans le domaine de la mode et de la création de tissu qu’elle innove en appliquant ses recherches de contrastes simultanés et de formes géométriques pures.
Après la mort de Robert, en 1941, Sonia n’a de cesse de faire connaître l’art de son mari, tout en poursuivant son propre travail qui lui vaut une reconnaissance et de nombreuses expositions.
Biographie
Blaise Cendrars
Blaise Cendrars vécut-il toutes les aventures qu’il relate dans ses ouvrages d’écrivain-reporter ? Qu’importe, comme il a pu le dire lui-même, puisque son œuvre est là qui nous touche. D’origine suisse, Frédéric Louis Sauser mène une vie itinérante dès son plus jeune âge de par la profession de son père, un homme d’affaires fantasque. Jeune homme révolté, en 1904 il se retrouve à Moscou en compagnie d’un négociant, Rogovine, qui l’emmène jusqu’à Kharbine par le Transsibérien pour faire fortune. L’année suivante, en apprentissage chez un joailler à Saint-Pétersbourg, il découvre, alors qu’il travaille pour la noblesse russe, la condition du peuple. De retour en Suisse en 1907, il étudie la médecine à l’université de Berne puis, déçu, la littérature et la musique. En 1911, il part pour New York rejoindre Féla Poznanska, jeune étudiante rencontrée à Berne, qui deviendra plus tard sa femme. Il y découvre la vie moderne, écrit son premier long poème, Pâques à New York, qu’il signe du nom de Blaise Cendrars (nom qu’il construit à partir des mots « braise » et « cendres »).
À Paris en 1912, il fréquente les milieux artistiques et littéraires, publie La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France, le premier « livre simultané » réalisé avec Sonia Delaunay. Engagé volontaire dans la Légion étrangère dès le début de la guerre de 14-18, blessé en 1915, il est amputé du bras droit. Réformé, il apprend à écrire de la main gauche, publie notamment J’ai tué, 1918, livre illustré par Fernand Léger, puis, profondément bouleversé par la guerre et ses atrocités, s’éloigne de Paris et devient l’assistant d’Abel Gance pour J’accuse et La Roue.
Avec son Anthologie nègre, 1921, une compilation de contes africains, il est le premier à considérer le conte de tradition orale comme de la littérature. Après un voyage au Brésil en 1924, à la rencontre des poètes modernes brésiliens qui voient en lui « l’homme qui a libéré la poésie », il publie son premier roman, l’Or, 1925, puis Moravagine, Les Confessions de Dan Yack, qui font de lui un romancier de l’aventure.
Il devient grand reporter et, en 1939, correspondant de guerre auprès de l’Armée britannique, publiant ses reportages dans Paris-Soir dont le directeur, Pierre Lazareff, est son ami. Suivent, après quelques années de silence, ses grands livres de mémoires : La Main coupée, Bourlinguer…
DADA : la libertÉ absolue en art
En pleine période de guerre, les artistes dada vont précipiter le décloisonnement des disciplines, intégrant dans leurs œuvres mots et lettres. Marcel Duchamp et Francis Picabia en font le moteur ironique de leurs curieux objets qui remettent en cause les catégories traditionnelles de l’art, Raoul Hausmann et Kurt Schwitters un matériau à la fois visuel et sonore, jetant de nouveaux ponts entre littérature et arts plastiques.
marcel duchamp et Francis Picabia, le mot moteur de l’œuvre
Marcel Duchamp, 1887, Blainville-Crevon (Seine-Maritime) – 1968, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Francis Picabia, 1879, Paris – 1953, Paris
Des complices
Depuis le début des années 1910, Duchamp et Picabia sont amis et complices. Ils se sont souvent retrouvés, en février 1912, devant les œuvres futuristes exposées à la galerie Bernheim-Jeune à Paris. Puis, en octobre, au Salon de la Section d’Or organisé par Picabia, où ils ont exposé avec le groupe de Puteaux −, la Section d’Or étant cette divine proportion utilisée par les peintres classiques italiens, dont Léonard de Vinci.
En 1913, Duchamp, ne pouvant financer sa traversée pour New York, confie à Picabia son Nu descendant l’escalier. Exposé à l’Armory Show, le tableau établit sa renommée à jamais. Quand, deux ans plus tard, ils se retrouvent à New York, tous deux emploient lettres et mots dans leurs œuvres.
Les « machines » peintes ou dessinées par Picabia comportent des mots et des titres savamment composés et, en général, éloignés de ce qui est représenté. Duchamp, quant à lui, achète une pelle à neige sur laquelle il écrit : « En prévision du bras cassé ». Il dira plus tard (en 1961) que cette phrase, au lieu de décrire l’objet comme l’aurait fait un titre, était destinée à « emporter l’esprit du spectateur vers d’autres régions plus verbales ».
Marcel Duchamp, Fontaine, 1917 / 1964
Ready-made. Réplique exécutée d'après la photographie de l'original prise en 1917
par Alfred Stieglitz, et réalisée sous la direction de Marcel Duchamp en 1964
par la Galerie Schwarz de Milan
Faïence blanche recouverte de glaçure céramique et de peinture, 63 x 48 x 35 cm
Le mot fait désormais partie de l’« artillerie » de Duchamp pour questionner l’art et ses objets. En 1917, à New York, il achète un urinoir qu’il intitule Fontaine et signe R. Mutt, ce qui signifierait en langue populaire « imbécile » ou « batard »11. Il envoie « l’objet » au jury (dont il est lui-même membre) de la Société des artistes indépendants pour qu’il soit exposé. Faisant défaut à ses règlements de n’exclure personne, le jury, choqué, le refuse.
Pendant ce temps, Picabia qui séjourne à Barcelone édite une revue, 391, qu’il va poursuivre au cours de ses voyages (4 numéros réalisés à Barcelone, 3 à New York durant l’été 1917, 1 à Zurich en février 1919, à Paris de novembre 1919 à octobre 1924) : « la plus internationale et typographiquement imaginative des publications Dada » (in Journal du mouvement dada). Depuis Marinetti, la revue est devenue un des supports par lesquels la lettre révolutionne l’image.
Les troublions de la Section d’or
Francis Picabia, Le Double monde, 1919
de l'ensemble : Mur de l'atelier André Breton
Ripolin et huile sur carton, 132 x 85 cm
En 1920, Picabia et Duchamp, devenus dadaïstes, se font les troublions de la deuxième exposition de la Section d’Or où se retrouvent des peintres post-cubistes, en exposant Le Double monde et L.H.O.O.Q.
Il y a, dans cette œuvre, Double monde, peinte au ripolin − une matière industrielle −, des lettres, des mots ; comme un embrouillamini de lignes qui traduit un mouvement perpétuel, une sorte de mécanisme à remuer l’air ambiant. Les lettres L.H.O.O.Q. renvoient à la Joconde aux moustaches de Marcel Duchamp, réalisée la même année, en 1919. Duchamp avait choisi cette œuvre, symbole de l’art sacralisé, pour s’en moquer. Un rappel qui conduit à penser que les lignes dévoyées du Double monde évoquent les figures géométriques dans lesquelles Vinci inscrit le corps idéal d’un homme (l’Homme de Vitruve, vers 1492).
Les mentions « fragile », « haut », « bas », écrites dans le désordre, rappellent les réalités matérielles du tableau, tout en s’opposant aux lois universelles. Le Double Monde confronte à l’art spéculatif des post-cubistes, établi sur les proportions de la Section d’Or, la réalité physique de l’œuvre. L’embrouillamini de lignes, qui suggère un mouvement refermé sur lui-même, exprime aussi ce que Picabia pense des post-cubistes en question.
« Dans ce Double monde, écrit Didier Ottinger, Picabia entraine la Section d’Or dans une danse de lassos (qui relie les points et axes de la ‘divine proportion’ » (Didier Ottinger, catalogue de la Collection Art moderne).
Biographie
Marcel Duchamp
Marcel Duchamp est le troisième d'une famille de six enfants, dont quatre sont des artistes reconnus : les peintres Jacques Villon, Suzanne Duchamp, le sculpteur Raymond Duchamp-Villon et lui-même. Après une scolarité à Rouen, il poursuit des études à Paris et fréquente l'Académie Julian. Mais c'est toujours auprès de ses frères qu'il fait son véritable apprentissage de la peinture et de leurs amis, réunis sous le nom de Groupe de Puteaux, principalement des artistes d'inspiration cubiste comme Fernand Léger ou Robert Delaunay, ou encore Albert Gleizes et Jean Metzinger.
Toutefois, très vite sa peinture s'éloigne de la problématique spatiale des cubistes et s'attache à la décomposition du mouvement, ce qui le rapproche des futuristes italiens. Sa toile, Nu descendant l'escalier, le fait connaître à la grande exposition américaine de l'Armory Show, en 1913.
À partir de 1915, installé à New York, il partage son temps entre les États-Unis et la France, diffusant les avant-gardes parisiennes auprès du public américain. À cette époque, il élabore ses œuvres les plus connues, comme le Grand Verre ou Fontaine, mais se consacre de plus en plus aux échecs, qui deviendront, au milieu des années 20, sa principale activité.
C'est à travers le Surréalisme qu'il renoue avec l'art en organisant de nombreux événements en collaboration avec André Breton. De retour sur la scène artistique, il acquiert une renommée croissante et devient célèbre après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 1950, une nouvelle génération d'artistes américains qui se qualifient de néo-dadaïstes, tels Jasper Johns et Robert Rauschenberg, le reconnaît comme un précurseur.
La réédition en 1964 de ses premiers objets readymades parachève cette célébrité en diffusant son œuvre dans le monde entier. Avec l’invention du readymade − une pièce que l'artiste trouve « already-made », c'est-à-dire déjà toute faite −, l'œuvre de Duchamp bouleverse radicalement l'art du 20e siècle.
Biographie
Francis Picabia
Né à Paris d’un père cubain et d’une mère française, Francis Picabia est élevé dans une atmosphère bourgeoise cossue. Son grand-père, passionné de photographie, l’initie à cette discipline. Seuls les arts plastiques l’intéressent. Il s’inscrit à l’École des arts décoratifs où il rencontre Camille Pissarro et fréquente l’Ecole du Louvre et l’Académie Humbert. Il peint des paysages. Sa première exposition, organisée en 1905, lui vaut d’être pris sous contrat par la galerie Haussmann.
En 1908-1909 il réalise ses premières œuvres abstraites (Caoutchouc, 1909, œuvre appartenant aux collections du Musée), épouse Gabrielle Buffet. En 1911, il rencontre Marcel Duchamp. En 1913, il peint Udnie, souvenir du spectacle d’une danseuse polonaise sur le bateau qui le conduit à New York, œuvre qui opère une synthèse entre les différents courants de l’époque : l’abstraction, le cubisme, le futurisme et les formes « mécaniques » de son ami Duchamp.
Mobilisé en 1914, une mission officielle à Cuba lui permet de retourner à New York où il retrouve ses amis exilés dont Duchamp, rencontre Man Ray et Alfred Stieglitz, et réalise ses premières œuvres mécanistes. L’année suivante le voit, alors qu’il est réformé, à Barcelone où il fonde la revue 391 − titre inspiré de la revue de Stieglitz, 291. Après un séjour à Paris, installé en Suisse, il écrit de nombreux poèmes et fréquente Tristan Tzara et les dadaïstes zurichois.
De retour à Paris, sa vie mondaine déplaît à ses amis dadaïstes. En 1924, il collabore avec les Ballets suédois, puis avec le cinéaste René Clair pour le ballet Relâche et le film Entr’acte. La rupture est consommée avec les surréalistes, trop théoriciens pour un artiste épris d’absence de contrainte.
1925, avec son installation dans le Midi, naît la période des Monstres, alliages de collages d’objets hétéroclites − paille, cure-dents, allumettes… − et de peinture industrielle au ripolin, représentant des fleurs ou des personnages. Lors d’un séjour en Catalogne, il découvre des fresques médiévales montrant des séraphins, des agneaux mystiques ou la bête de l’Apocalypse. Dans sa nouvelle série des Transparences, il juxtapose cette iconographie à d’autres éléments, ou la peint sur d’anciens tableaux.
Sa vie mondaine dans les années 1930 s’accompagne d’une production déconcertante, allant du « joli » tableau au collage dadaïste. Pendant la guerre, il peint des nus, contrastant avec la vie quotidienne de l’époque. Puis, à Paris après la Libération, il peint à nouveau des œuvres abstraites. La première rétrospective de son œuvre est organisée en 1949 à la galerie Drouin sous le titre : « 50 ans de plaisir ». Il se remet à écrire des poèmes. Frappé par une hémorragie cérébrale il cesse de peindre.
Pour en savoir plus :
- sur Marcel Duchamp, consulter le dossier pédagogique Marcel Duchamp dans les collections du Musée. La biographie de l’artiste est extraite de ce dossier.
- sur le rôle des revues dans les années 1910 : consulter le dossier pédagogique La diffusion de l’art à travers les revues.
Raoul Hausmann, « Écouter avec les yeux, voir avec les oreilles »
Dada Zurich, créer une langue nouvelle
Tandis qu’à New York, Duchamp et Picabia interrogent le bien-fondé de l’art et provoquent le scandale par leurs œuvres, à Zurich, en 1916, naît autour d‘un groupe d‘artistes, d’écrivains, de musiciens cosmopolites, réfractaires à la guerre et au déni des valeurs humaines, le mouvement Dada, un nom probablement choisi par Tristan Tzara, poète originaire de Roumanie. Un artiste dada ne peut avoir qu’un but : revendiquer la liberté absolue en art. Dada devient un laboratoire où les poètes créent une langue nouvelle que déclame notamment Hugo Ball, en costume cubiste, au Cabaret Voltaire.
gdji beri bimba
glandridi lauhi lonni cadori
gadjama bim beri glassala […]
Jean Arp, à la fois poète et plasticien, parmi les plus inventifs des artistes dada à Zurich, avec sa compagne Sophie Taueber, crée, quant à lui, des objets novateurs d’une grande beauté plastique tout en recourant à l’humour et aux lois du hasard : collages, reliefs de bois vissés et peints, dessins automatiques, papiers déchirés,… Cependant, Arp ne mélange pas les genres. Il dit même : « Si par impossible, j’étais obligé de choisir entre l’œuvre plastique et la poésie, si je devais abandonner, soit la sculpture, soit les poèmes, je choisirais d’écrire des poèmes. »
Dans ce laboratoire d’inventions, la communication joue un grand rôle. Affiches, invitations aux soirées, revues, précipitent les mots dans des caractères élégamment dessinés, colorés de rouge et de noir.
Dada Berlin, la typographie, nouveau matériau de la peinture et de la poésie
À Berlin, en 1918, entre guerre, grèves et insurrection spartakiste, naît un nouveau foyer Dada, le Club dada, à l’initiative de Richard Huelsenbeck, un des fondateurs du mouvement à Zurich, et de Raoul Hausmann, peintre d’origine, converti à la poésie phonétique. Avec ses poèmes-affiches, ses poèmes phonétiques et ses photomontages, Raoul Hausmann va inventer une nouvelle osmose entre poésie et œuvre plastique.
S’il n’est pas le premier à « réciter des poèmes dans des langages abstraits, comprimés et fragmentaires », − expressionnistes, futuristes, constructivistes, dadaïstes zurichois ont déjà travaillé dans le même esprit12 −, son innovation en matière de poésie phonétique tient, comme le précise l’artiste, à son travail sur l’apparence typographique des lettres. « En 1918, écrit-il dans ses souvenirs13, j’introduisis la typographie comme élément pictural et je créai mes « poèmes-affiches », des « poèmes phonétiques » composés d’après le sens sonore des lettres, sans avoir eu connaissance des essais analogues de Khlebnikov et de Ball. »
Raoul Hausmann, Plakatgedicht (Poème-affiche), 1918
Tirage typographique sur papier vert, contrecollé sur papier
32,5 x 47,5 cm
Sans réinventer une langue comme le fait Hugo Ball, Hausmann utilise la lettre comme pur élément visuel et sonore, amenant le spectateur à « écouter avec les yeux » et à « voir avec les oreilles ». « Dans un poème, poursuit-il, ce n’est pas le sens et la rhétorique des mots mais les voyelles et les consommes, et même les caractères de l’alphabet qui doivent être porteurs d’un rythme. »
Outre la lecture publique dans laquelle Hausmann excelle, la revue est le moyen idéal pour diffuser ce nouvel art. De 1919 à 1924, il publie dans sa revue Der Dada ses poèmes ainsi que ceux de ses amis Johannes Baader, Richard Huelsenbeck, John Heartfield et George Grosz.
Raoul Hausmann, ABCD, 1923-1924
Encre de Chine, reproduction de photographie et imprimés découpés, collés sur papier,
40,4 x 28,2 cm
Au cours de l’été 1918, Hausmann réalise ses premiers tableaux avec des coupures de journaux et des papiers colorés, qu’il va appeler, d’un commun accord avec George Grosz, John Heartfield, Johannes Baader, Hanna Höch, des photomontages. « Le terme traduisait notre aversion à jouer l’artiste et, nous considérant comme des ingénieurs […] nous prétendîmes construire, monter nos travaux. »
La paternité de l’invention est là aussi difficile à établir. Mais Hausmann s’impose par la vigueur de ses collages. Mots, lettres, photographies, dessin sont indissociablement liés, matériaux purs libérés de toute signification.
De ce photomontage de 1923, le dernier qu’Hausmann réalise alors que Dada Berlin n’existe plus, le titre se résume aux quatre premières lettres de l’alphabet : ABCD. Placés entre les dents de son autoportrait photographique, elles résonnent comme un morceau de poème phonétique.
Le motif de la bouche est quasiment placé au centre du collage. Pourtant, plusieurs axes de composition organisent l’espace, abolissant toute notion de centre, de fond et de formes. Le « matériel préfabriqué » utilisé, comme le nomme Hausmann, est des plus divers : papiers découpés dans des manuels médicaux, billet de banque tchèque, morceaux de cartes du monde ou d’invitation à une action Merz…
Biographie
Né à Vienne, sa famille s‘installe à Berlin en 1900, où il commence des études artistiques sous la conduite de son père, peintre de portraits et de scènes historiques. Puis il étudie dans une école de peinture et de sculpture l’anatomie et le nu, réalisant toutefois ses premiers dessins typographiques. En 1912, il découvre la peinture expressionniste à la galerie d’Herwarth Walden, Der Sturm. 1915, début d’une liaison féconde, d’un point de vue artistique, avec Hanna Höch qui sera, elle aussi, membre de Dada Berlin.
Citoyen autrichien vivant en Allemagne, il échappe à la conscription mais, comme beaucoup d‘artistes expressionnistes, croit en une nouvelle vitalité qu’apporterait la guerre en détruisant les structures sociales existantes. C’est dans cet esprit qu’il s’intéresse à la psychanalyse, lit Carl Jung, Walt Whitman, Friedrich Nietzsche, et fait de l’idée de destruction le point de départ à toute création.
En 1918, il co-fonde le Club dada à Berlin. Très actif, il écrit quelques textes-clés du mouvement − dont, avec Richard Huelsenbeck, le Manifeste dada −, joue un rôle central dans l’organisation d’événements − comme la première Foire internationale du mouvement dada. Sa contribution essentielle au mouvement, outre la revue Dada qu’il édite de 1919 à 1924, sont ses poèmes phonétiques et ses photomontages. On lui doit aussi la célèbre Tête mécanique, réalisée à partir d’un mannequin de coiffeur et qui, malgré son apparente douceur, est une féroce critique sociale.
Après Dada, il se consacre à la photographie, pour des portraits, des nus et des paysages. De 1939 à 1944 il se refugie en France. Après la guerre, il publie des ouvrages sur Dada dont son recueil de souvenirs, Courrier dada, 1958.
Kurt Schwitters, « PoÉsure et peintrie »
1887, Hanovre (Allemagne avant 1949) – 1948, Kendal (Royaume-Uni)
Tout est Merz
Tout artiste amoureux de liberté en art pouvait-il devenir Dada ? Pas tout à fait puisque Kurt Schwitters voit sa demande d’entrée au Club refusée par Huelsenbeck, pour motif qu’il a exposé à la galerie Der Sturm et publié dans sa revue ; lui et Hausmann reprochant à Walden d’être un défenseur de l’expressionnisme et « un collaborateur hohenzollernien » pour avoir édité un « Chant des chants du prussianisme ».14
Refusé par Dada, Schwitters fonde son propre « label », qualifiant de Merz toutes ses activités : Merzbild, Merzeichnung, Merzbau,… ; le « mot » est apparu dans un de ses premiers collages exposés chez Walden − puisque Dada l’a repoussé − en juillet 1919 et provenant d’un imprimé sur lequel était écrit Kommerz- und Privatbank ….
Comme Hausmann, avec qui il se lie d’une profonde amitié, Schwitters est un poète et un plasticien. Son poème An Anna Blume (À Anna Fleur) le fait connaître, un poème d’amour composé de phrases aux accents sentimentaux − « Ève ma fleur, ô bien aimée de mes vingt-sept ans, je t’aime ! » −, mais aussi de mots déformés, inventés, répétés ou de phrases toutes faites prises dans des journaux ou des conversations.
À partir de 1921, sa poésie se rapproche de la poésie phonétique abstraite, où « seul ‘le son’ demeure ». Tout en utilisant la typographie comme signes acoustiques (pour des indications rythmiques ou d’amplitude de voix), Schwitters veut faire de sa poésie des œuvres à voir. Et, inversement, de ses Merzbilder des œuvres à lire. Pour qualifier ces recherches croisées, il inventera rétrospectivement, en 1946, l’expression « Poésure et peintrie », expression reprise comme titre de l’exposition présentée au Centre de la Vieille Charité à Marseille en 1993.
Die Ursonate, une œuvre « verbi-voco-visuelle »
Écouter, sur You tube, un extrait de l'URSONATE interprété par Kurt Schwitters,
enregistré le 5 mai 1932 à Francfort par la station Süddeutschen Rundfunk.
Son poème le plus connu est la Ursonate. Cette œuvre « verbi-voco-visuelle », à laquelle il travaille pendant plus de dix ans, mise en page par le typographe Jan Tschichold, est publiée en 1932 avec son enregistrement, en tant que numéro spécial de sa revue Merz.
Dans une lettre envoyée à Hausmann en 1947, Schwitters reconnaît ce qu’il doit à son ami : « Merz a fait l’Ursonate dans une forme symphonique d’après ton poème dada ». Il s’agit du poème phonétique fmsbwtözäu, point de départ répété cinquante fois avec quelques bribes phonétiques supplémentaires. Ainsi peut-on voir et entendre dans les premiers vers de l’Ursonate :
Fûmms bö wö tää zää Uu
Dans ce Work in Progress, Schwitters ajoute, au cours des années, des motifs inspirés de mots usuels − tels que Rakete (fusée) −, d’abréviations ou de signes publicitaires, du nom d’une ville − Dresden devient : DDSSNNR −, ou du nom de son ami Arp − dont il inverse l’ordre des lettres : PRA. « La Sonate, explique Schwitters, est constituée de quatre mouvements, d’une ouverture et d’un finale […] Dans le finale, j’attire l’attention sur le retour volontaire de l’alphabet jusqu’au a. On le pressent et on attend le a avec impatience. Mais par deux fois il s’arrête douloureusement au b. […] (Schwitters, 1927.)15
Savoir « former »
Kurt Schwitters, Merzzeichnüng 54. Fallende Werte, 1920
Aquarelle, gouache, encre, mine graphite, papiers et tissu collés sur papier, 30 x 22,5 cm
Côté arts plastiques, Schwitters commence ses collages en héritier du cubisme. Mais, chez lui, les morceaux de réel ne sont pas des rehauts pour donner vie à la peinture, ils occupent entièrement l’espace, transportant couleurs et motifs. À la différence des collages d’Hausmann, les siens ne sont pas non plus des provocations visuelles destinées à exciter l’œil ou l’esprit. Ils importent avec eux une douceur, une mélancolie, une usure comme celle d’un vêtement maintes fois reprisé, en somme une esthétique.
Confronté à une ville en ruines, c’est dans les rues de Berlin qu’il ramasse les fragments de papier, les déchets utilisés. « On peut aussi crier avec des ordures, et c’est ce que je fis en collant et clouant. J’appelais cela Merz, mais c’était ma prière au sortir victorieux de la guerre, car une fois de plus la paix avait triomphé. De toute façon, tout était fichu, et il s’agissait de construire des choses nouvelles à partir des débris. »
Merzzeichnüng 54. Fallende Werte apparaît comme un morceau de nature mis sous un microscope qui pourrait s’étendre à l’infini. Fondé sur une harmonie de bleus et de jaune-beige-rosé, avec des zones de blanc et de noir, de clair et d’obscur, l’espace s’organise en deux grands triangles de part et d’autre d’une diagonale qu’une légère gaze blanche vient unifier à droite, dans la partie basse. Les matériaux utilisés sont des plus variés : aquarelle, gouache, encre, mine graphite, tissu, papiers. Lettres et chiffres sont présents, élégants et décoratifs avec leurs empattements animés de vie.
Tout est accolé avec naturel et liberté. En fait, cette sensation de facilité, marque de fabrique de l’artiste, est le résultat d’un long travail, comme il a pu le dire lui-même : « Liberté ne signifie pas licence effrénée, mais produit d’une rigoureuse discipline artistique […] Un artiste doit avoir le droit, par exemple, de faire un tableau rien qu’en assemblant des papiers buvards, s’il sait former […]
Biographie
Né dans une famille de commerçants aisés à Hanovre, Kurt Schwitters entreprend des études à l’École des Arts appliqués de la ville puis, entre 1909 et 1914, à l’Académie de Dresde où il étudie la peinture. Il réalise des paysages, des natures mortes, des portraits, genres picturaux qu’il pratiquera toute sa vie, le plus souvent pour des raisons financières, parallèlement à ses recherches plastiques.
Incorporé à la déclaration de guerre, mais rapidement déclaré inapte, il est affecté dans une usine métallurgique comme dessinateur technique. Tout en peignant dans une veine cubiste et expressionniste, il écrit ses premiers poèmes. En 1918, il participe à une exposition collective à la galerie Der Sturm avec deux tableaux abstraits.
Installé à Berlin, il réalise dès fin 1918 des assemblages et collages abstraits à partir de matériaux trouvés, cartes de rationnement, morceaux de ficelle ou de journaux, tickets de tram... Son entrée au Club dada lui étant refusée, il donne à ses activités le qualificatif de Merz.
Son poème An Anna Blume (À Anna Fleur) le fait connaître. À partir de 1921, sa poésie se rapproche de la poésie phonétique abstraite. Parallèlement, il écrit de la prose, des pièces de théâtre, des livrets d’opéra, s’engage dans la publication d’une revue, avec Theo Van Doesburg notamment, bien évidemment appelée Merz, qui devient un carrefour d‘échanges et d’idées entre le dadaïsme, de Stijl et le constructivisme. Die Ursonate, son poème le plus célèbre, constitue le dernier numéro de Merz en 1932.
Outre ces activités déjà nombreuses, son ambition est de réaliser une œuvre d’art totale, à la fois peinture, sculpture, théâtre, architecture, qu’il entreprend chez lui à Hanovre, construction qu’il appelle Merzbau, où il accumule toutes sortes d’objets, empruntés ou volés à ses proches. Que ce soit en Norvège où il émigre entre 1937 et 1940 ou, après l’invasion du pays par l’Allemagne, en Angleterre, il recomposera un Merzbau (le dernier avec l’aide du MoMA).
le surrÉalisme, littÉrature et arts plastiqueS
L’articulation littérature et arts plastiques n’a jamais été aussi serrée que pendant l’aventure surréaliste.16 Ses participants font appel dans leurs œuvres au collage et au photomontage dadaïstes pour leur pouvoir de susciter des associations poétiques, étranges, mais ils considèrent peu ou pas la lettre comme un matériau pictural (les exceptions confirmant la règle, Joan Miró ou Man Ray l’utilisent parfois). L’automatisme pictural semble lui aussi s’éloigner du propos. Masson par exemple, avec sa « ligne errante » qui laisse sourdre la pulsion, en délaisse la richesse graphique.
Chez Magritte, le procédé est tout autre. Le mot prend la place de l’image (Querelle des universaux) ou vient la contredire (Ceci n’est pas une pipe). L’arène du combat entre mot et image se tient bien dans la toile.
RenÉ Magritte, reprÉsenter la pensÉe par la peinture
1898, Lessines (Belgique) – 1967, Bruxelles (Belgique)
Des mots choisis au hasard ? Impossible !
René Magritte, Querelle des universaux, 1928
Huile sur toile, 53,5 x 72,5 cm
Une image n’est pas la « chose » et son nom pas davantage. Image et mot sont deux systèmes de notation qui ne se confondent pas avec le réel.
Pour piéger le regard, interroger la perception, Magritte invente de nombreux effets visuels : un rocher qui flotte dans le ciel, un nuage qui pèse sur le sol, un corps qui se métamorphose en pierre et réciproquement, la nuit qui devient lumière et la lumière obscurité… Dans les années 1928-1930, Magritte s’intéresse en particulier aux troubles que crée la confrontation des images et des mots.
Dans Querelle des universaux, quatre formes sombres occupent un espace légèrement en perspective, de la profondeur d’une table, comme pour une nature morte. Sur chacune un mot est écrit ou plutôt peint, comme le souligne Michel Foucault dans son célèbre article Ceci n’est pas une pipe. Des mots choisis au hasard ? Impossible ! La forme sur laquelle le mot feuillage est peint évoque un arrière-plan qui serait un paysage, quelque chose comme une réalité globale, sans détail. Le mot miroir, au premier plan, en ne renvoyant rien, frustre le spectateur et semble lui poser la question de son identité et de sa ressemblance. Quant au mot canon, il le tiraille entre ses différentes occurrences : modèle − règle ou femme-canon −, chant en canon, pièce d’artillerie, petit verre de comptoir … Aucune forme ne peut, comme un mot (simple signifiant), renvoyer à autant de signifiés. La forme qui porte le mot cheval est plus expressive, elle fait preuve d’une certaine élégance, tandis que les lettres du mot cheval descendent comme une crinière sur son échine…
Comme tout objet réel, ces quatre formes ont des ombres. En leur centre, est représentée une étoile qui, elle, n’a pas plus d’ombre que de nom. Bien que peinte, elle fait penser à un papier plié dans la tradition de l’origami japonais. Sa construction géométrique est rigoureuse. S’agit-il du pentagramme de l’absolu connu des penseurs ésotériques, symbole de la lumière pour qui cherche à s’orienter dans le monde spirituel et physique ?
Revenons-en au titre du tableau. La Querelle des universaux renvoie aux philosophies de Platon et d’Aristote qui ont divisé les penseurs du Moyen Age entre les 12e et 14e siècles, querelle qui réapparaît sous une autre forme au 20e siècle avec la philosophie du langage. Les universaux, ce sont les idées générales, telles que les donnait à penser Platon dans son mythe de la caverne, les idées étant la vraie réalité dont dérive l’être des choses dans le monde. Mais rien dans l’expérience ne correspond à ces termes généraux. Pour Aristote, la matière existe, mais seulement « en puissance », virtuellement, attendant que la forme (ou le mot qui est un moule) l’actualise, c’est-à-dire la fasse « être en acte ».
Après Platon et Aristote, les Stoïciens, pour qui les perceptions sensibles sont source de tout notre savoir, diront : je vois le cheval mais non la chevalité […] Ce n’est sans doute pas sans raison que Magritte peint le mot « cheval », il doit connaître ses classiques !
Biographie
René Magritte fréquente de 1916 à 1919 l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles. En 1922, il travaille comme dessinateur dans une usine de papier peint puis dans la publicité. Alors qu’il découvre, en 1925, l’œuvre de Giorgio de Chirico, il abandonne l’abstraction géométrique de ses premiers tableaux. « Mes yeux ont vu la pensée pour la première fois », écrira-t-il en se souvenant de cette révélation.
Le monde réel devient son seul sujet d’inspiration, non pour le peindre tel qu’il est mais pour le mettre en cause, « le visible étant en lui-même suffisamment riche pour constituer un langage poétique évocateur de mystère ».17 « Il faut, dit-il, que la peinture serve à autre chose qu’à la peinture », c’est-à-dire à représenter la pensée.
Devenant rapidement le chef de file du surréalisme belge, il séjourne à Paris de 1927 à 1930 où il entre dans le cercle d’André Breton et participe à l’Exposition surréaliste de 1928. Sa première grande exposition est organisée cette même année à Bruxelles, à la galerie L'Époque.
Faute de moyens financiers, avec la crise de 1929, Magritte revient s’installer à Bruxelles où il réalise des travaux publicitaires et adhère au Parti communiste belge (jusqu’en 1945). En 1933, il expose au Palais des Beaux-arts de Bruxelles et, en 1936, réalise une première exposition personnelle à New York.
En 1943, vient sa période dite « Renoir », série de tableaux où il utilise la « technique » des impressionnistes, suivie en 1948 par la période dite « vache » − dont le Centre Pompidou possède Le Stropiat, 1948 −, des tableaux et gouaches aux tons criards faits pour dérouter les marchands parisiens et le bon goût français.
Les années 1960 voient sa consécration avec des rétrospectives aux Usa et en Europe.
La lettre et l’abstraction gÉomÉtrique
AUGUSTE HERBIN ET SON ALPHABET PLASTIQUE
Que ce soit Auguste Herbin, adepte de l’abstraction géométrique, ou Horacio Garcia-Rossi, artiste cinétique – l’art cinétique se fixant pour but de renouveler l’abstraction géométrique par la vibration de la couleur et le mouvement −, ces deux artistes travaillent avec la lettre et réalisent des alphabets. Deux expériences néanmoins différentes. L’un associe la lettre à un répertoire de formes dans lequel il puise, l’autre cherche à identifier la signification du mot à sa forme.
Un nouveau souffle
Auguste Herbin, Vendredi 1, 1951
Huile sur toile, 96 x 129 cm
Des formes simples : des carrés, des cercles, des triangles, des rectangles, rigoureuses mais chatoyantes, peintes selon les trois couleurs primaires : le jaune, le bleu, le rouge, avec quelques nuances, auxquelles s’ajoutent le noir et le blanc, ce que Piet Mondrian nomme dans son langage néoplastique des non-couleurs… Chaque forme colorée occupe sa place avec stabilité. Dans cette peinture d’aplats, sans ombres ni reliefs, les non-couleurs sont à la fois formes et fonds, fond noir/formes blanches, fond blanc/formes noires. Tout un programme ! Sur quelle île veut nous conduire le peintre ? Est-ce un territoire codé, un rébus à déchiffrer ? Le spectateur est invité à avoir un regard actif et créatif sur l’œuvre.
Autour de 1942, après des années consacrées à l’art géométrique, un art qui exclut la représentation de l’objet, de la nature et le mouvement − dernier avatar de l’illusion −, un art qui ne doit rien au « geste » de l’artiste, Auguste Herbin retrouve un nouveau souffle avec l’invention d’un alphabet plastique qu’il va utiliser jusqu’à la fin de sa vie. À chaque lettre correspond une couleur, une ou plusieurs formes géométriques simples et une note de musique. Composition sur le nom Herbin est la première œuvre réalisée avec cette méthode. Suivent des séries dont les mots renvoient à un contenu spirituel : Christ, Destin, Éternité …, ou teintés d’ésotérisme : Air et Feu, Stable et Instable…, d’autres encore renvoyant à des fêtes religieuses.18 Vendredi 1 fait partie d’une série peinte entre 1949 et 1951, à partir des noms des jours de la semaine.
Dans son ouvrage publié en 1949, L’Art non-figuratif non-objectif, l’artiste a donné des explications sur les correspondances utilisées. Ici, le V, triangle inversé noir, est peint en opposition avec le blanc des quelques barres évoquant le N (le V, noir, et le N, blanc, peuvent prendre toutes les formes et correspondent à toutes les sonorités) ; les formes rouges, sphériques, incarnent le E (sonorité do) ; la forme bleue, hémisphérique, représente le R (sonorité sol, la) ; le fond jaune orangé symbolise le I (sonorité ré)…
Cette démarche évoque Rimbaud et son sonnet des voyelles. Dans le cadre de ce dossier, on pense surtout à ses résonnances avec la poésie concrète et sonore. Lettre et mot, en perdant leur sens et leur linéarité, ont délesté leur pouvoir d’inhibition pour laisser la place à l’autonomie de la création picturale.
Biographie
Issu d’une famille d’ouvriers tisseurs, Auguste Herbin suit, grâce à une bourse, des études à l’École des Beaux-arts de Lille avant de s’installer à Paris. Suit un parcours quasiment obligé pour tout jeune artiste : l’impressionnisme, le fauvisme puis le cubisme. Voisin de l’atelier de Braque et de Picasso, il crée ses premières toiles cubistes en 1913.
À partir de 1917, il se dirige vers un art abstrait et géométrique et découvre les écrits de Theo Van Doesburg. Il réalise alors une série d’« objets monumentaux », des tableaux-totems au format découpé, des sculptures. En 1922, anéanti par la critique, il pratique un retour à la figuration avec des scènes de genre, des natures mortes, des paysages et se retire à Cateau-Cambrésis. Mais quelques années plus tard, sa recherche de spiritualité l’engage définitivement dans l’abstraction. Il rejoint, en 1931, l’association Abstraction-Création fondée par Georges Vantongerloo et Theo Van Doesburg, et s’intéresse aux théories théosophiques de Rudolf Steiner. Il recherche un art universel, concret, composé de formes géométriques simples et de couleurs pures. Dans cette optique, il conçoit son alphabet plastique en 1942.
À partir de 1946, c’est en aîné qu’il retrouve les jeunes créateurs qui se rassemblent autour de Denise René (Vasarely, Dewasne, Jacobsen…) pour débattre des problèmes liés à l’art et à sa destination. Dans son ouvrage L’Art non-figuratif, non-objectif, publié en 1949, exposant sa philosophie de l’art, il écrit notamment : « Lorsque la sève ne monte plus, le bleu est absent, il reste le jaune, c’est l’automne. Quand, dans l’obscur, la vie sort de la graine, c’est par le blanc qu’elle se manifeste, pôle opposé au noir. »
Son aventure humaine est aussi celle d’un homme engagé. Communiste, il refuse néanmoins d’adopter le style imposé par le Parti, le réalisme socialiste. Soucieux de partager et de transmettre, il ouvre en 1958 un centre de recherches pour les artistes. Entre 1955 et 1972, sa renommée s’étend et ses œuvres sont notamment exposées à la documenta de Cassel.
Consulter le site du Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, présentation des collections Herbin.
Horacio Garcia-Rossi, le mouvement de la lettre
1929, Buenos-Aires (Argentine)
Identifier la signification du mot à sa forme
Horacio Garcia-Rossi, Mouvement, 1964-1965
Bois, aluminium, plexiglass, moteur, ampoules électriques
150 x 150 x 60 cm
Artiste cinétique et co-fondateur du GRAV (Groupe de Recherche d’Art Visuel) en 1961, dans le cadre de ses expérimentations sur le mouvement réel, la lumière et l’instabilité de la forme, Horacio Garcia-Rossi s’intéresse à partir de 1964 à la lettre et aux mots. Sa première expérience consiste à enfermer le mot MOUVEMENT dans une boîte à lumière instable, un dispositif utilisé par la plupart des artistes cinétiques, mais auquel il donne, ici, une nouvelle dimension.
« Dans une première approche, explique-t-il, pour identifier le mot à sa forme et à sa signification de langage, au moyen de l’action visuelle, j’ai créé en 1964 une œuvre à lumière instable, intitulée « MOUVEMENT ». Cette œuvre est constituée par la projection sur un écran lumineux du mot « MOUVEMENT » répété dix fois. Les lettres composant le mot « MOUVEMENT » bougent, se superposent entre elles, créant des ambiguïtés en mouvement continuel instable. »
Le mot s’émiette, revient, est mis en abîme par son propre signifié : le mouvement. À le regarder bouger sur l’écran, le spectateur pourrait se croire face à une de ces vidéos pionnières des années 1960, avec un sujet sans histoire mais pas silencieux pour autant, tant la technologie de ces années-là s’accompagne d’un chuintement bien particulier. Moteur et ampoules électriques font vibrer le mot sous le couvercle en plexiglas de la boîte.
Quelques années plus tard, Garcia-Rossi reprend cette recherche dans des œuvres bidimensionnelles cette fois avec, pour base, des termes plastiques tels que carré, cercle, triangle, reflet, couleur, ligne, volume, espace, lumière, ou le nom d’un artiste − œuvres qu’il appelle « portraits » : Portrait du nom de Mondrian à travers son œuvre, Portrait du nom de Malevitch à travers son œuvre, etc. −, de sa fille ou de sa femme, allant même jusqu'à faire un autoportrait de son propre nom.
« Cette recherche, précise-t-il, est axée plus particulièrement sur [l’]aspect visuel, donc la recherche plastique prédomine, mais, en même temps, mon intention est que le portrait du nom soit le plus possible une approche du personnage tel qu’il ressort des données psychologiques considérées. » (1974, voir le site de l’artiste).
Biographie
En 1959, Horacio Garcia-Rossi arrive en France où il retrouve Julio Le Parc et Francisco Sobrino rencontrés au cours de ses études aux Beaux-arts de Buenos Aires ; il expose à la première Biennale de Paris au Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Ses recherches portent alors sur la multiplication de la forme en deux dimensions et le mouvement virtuel, la vibration et la juxtaposition des couleurs. En 1960, il fonde, avec Julio Le Parc, François Morellet, Francisco Sobrino, Joël Stein et Jean-Pierre Yvaral, le Centre de Recherche d’Art Visuel qui devient l’année suivante le Groupe de Recherche d’Art Visuel (le GRAV).
Ces jeunes artistes ont pour but de Transformer l’actuelle situation de l’art plastique. Ils veulent substituer au culte de l’art et de l’artiste, « la conception et la réalisation de l’œuvre » comme « simple activité de l’homme ». À « la forme stable et reconnaissable », idéalisante − naturaliste ou géométrique −, ils opposent « l’instabilité » qui introduit « le temps de la perception, le temps d’appréciation » d’« une œuvre non définitive mais pourtant exacte, précise et voulue ».19 Pendant plusieurs années, c’est ensemble et de façon anonyme qu’ils exposent – certains s’autorisant néanmoins des expositions plus personnelles − ou mènent des actions comme cette journée d’avril 1966 où ils « descendent » leurs œuvres dans la rue pour « dépasser les rapports traditionnels de l’œuvre d’art et du public ».
À partir de 1962, Garcia-Rossi s’investit dans des recherches sur le mouvement réel avec des boîtes de lumière et dans des œuvres qui prévoient l’intervention du spectateur. La notion d’instabilité devient essentielle. Suivent des Reliefs et des Structures à lumière instable où il introduit des couleurs changeantes, des Motifs de différentes formes et couleurs manipulables par le spectateur. Puis commence son travail sur la lettre, les mots et les nombres, suivi par la réalisation d’un « alphabet ambigu » (1969).
Avec la dissolution du GRAV (1968), les années 1970 voient le retour à des problèmes plastiques en deux dimensions, à des questions liées au langage, à un approfondissement de la couleur et de ses possibilités.
Les expérimentations sur la couleur comme lumière sont ses préoccupations essentielles à partir des années 1980 à travers des séries liées à des formes géométriques simples, le cercle ou le carré : couleur lumière (1978/1998), couleur lumière enragée (1999/2002), couleur lumière transparente, lumière en cage, couleur gris lumière transparente (2003/2005), couleur lumière électrique, couleur noir lumière, couleur lumière cinéma, couleur lumière portraits de noms.
Consulter le site officiel d’Horacio Garcia-Rossi.
Le lettrisme, la 3e voie aprÈs le figuratif et l’abstrait
« Un mouvement analogue au classicisme ou au romantisme »
À la fois connu et méconnu, le lettrisme s’est fait d’abord connaître par de retentissants scandales lors de récitals de poésie alphabétique au Vieux Colombier ou dans les caves de Saint-Germain-des-Près. Né à Paris en 1945, à l’initiative d’Isidore Isou, le mouvement lettriste est toujours actif aujourd’hui.
Le lettrisme, écrit Roland Sabatier, historien du mouvement et lettriste notoire, est « un mouvement de création analogue au classicisme ou au romantisme qui s’affirme capable de transformer […] l’ensemble des disciplines esthétiques de son temps, depuis la poésie jusqu’au théâtre, en passant par la peinture, le cinéma et le roman avant de rénover les autres domaines de la culture : la philosophie, depuis l’éthique jusqu’a la métaphysique en passant par l’esthétique, la science, depuis la chimie et la physique jusqu’aux mathématiques, en passant par l’économie politique ainsi que la théologie et la technologie ».20
Au sein de cet ensemble de disciplines, la poésie, fondée sur la lettre alphabétique sonore à laquelle le lettrisme doit son nom, n’a donc été que la première des disciplines abordées par ces créateurs, suivie par des manifestations de peinture. La lettre n’étant pas présente dans la plupart des autres domaines, Isidore Isou proposa de substituer au terme de lettrisme celui d’hyper-créatisme ou d’hyper-novatisme, théorisant la création comme seul fondement de l’évolution du monde et du progrès dans le savoir, comme facteur de « dévoilement permanent ». Mais le terme est resté du fait même des artistes.
Parmi ses représentants, les apports de Gabriel Pomerand, Maurice Lemaître ou François Dufrêne ont été déterminants, tant pour leur participation aux manifestations et publications lettristes (voir notamment le chapitre les Affichistes), que pour leur contribution à une des notions clés du lettrisme : l’hypergraphie (voir définition ci-dessous).
Pour en savoir plus sur le mouvement, consulter le site officiel du Lettrisme.
Isidore Isou (Jean goldstein, dit), un surdouÉ pluridisciplinaire
1925, Botosani (Royaume de Roumanie) – 2007, Paris (France)
Isidore isou, Signes fauves, 1961
Huile sur toile, 46 x 38 cm
La peinture lettriste, à l’image de ces Signes fauves, est un « un art basé sur l’organisation de l’ensemble des signes de la communication visuelle, à savoir : les signes alphabétiques, lexiques et idéographiques, acquis ou possibles, existants ou inventés » (cf. l’ouvrage de Roland Sabatier), appelé par ses pratiquants hypergraphie, la lettre et le signe graphique étant conçus comme les seuls éléments permettant d’échapper au figuratif et à l’art abstrait. Dans ces Signes fauves, il s’agit de dessins idéographiques, de signes proches de graffiti ou de glyphes égyptiens. Du point de vue de la composition, Isou utilise le procédé du damier et du clair-obscur, souvent utilisé par les créateurs d’abécédaires.
Biographie
Enfant surdoué, Isidore Isou s’intéresse très tôt aux grands auteurs de la littérature et de la philosophie. En 1942, à seize ans, il rédige le Manifeste de la poésie lettriste. Fuyant les désastres de la Seconde Guerre mondiale, il arrive à Paris en août 1945 après un voyage de plusieurs semaines à travers l’Europe pour faire connaître la poésie lettriste et ses idées. Il rencontre rapidement des personnalités du monde intellectuel telles qu’André Gide, Tristan Tzara ou André Breton. Formant avec Gabriel Pomerand le premier noyau lettriste, ils organisent ensemble, en janvier 1946, la première manifestation lettriste ou il lit ses poèmes alphabétiques.
En 1947, grâce à Raymond Queneau et Jean Paulhan, il publie, à la NRF, Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique, ouvrage dans lequel il propose comme élément sonore, tant pour la poésie que la musique, la lettre alphabétique, à laquelle peuvent s’ajouter « les bruits que peut produire l’homme tout entier », « le cri originel [étant la] source commune de la poésie et de la musique ».
La même année, Gallimard publie L’Agrégation d’un Nom et d’un Messie, défini comme un roman mais prenant la forme de « mémoires ». Son premier vrai roman hypergraphique, Les Journaux des dieux, où les mots se mêlent aux dessins et à d’autres signes, est publié en 1950.
Entre temps, Isou étend sa conception de la création à d’autres domaines. En 1949, il publie son Traité d’économie nucléaire. Le Soulèvement de la Jeunesse, dont les théories annoncent certaines des revendications des événements de 1968. Il aborde le cinéma avec Traité de Bave et d’Éternité qui dissocie la bande-son et la bande-image et qui préfigure, par la ciselure des photogrammes, la fin du film sur pellicule. Projeté en marge du festival de Cannes en 1951, c’est là qu’il rencontre Guy Debord qui fonde, l’année suivante, l’Internationale lettriste. En 1954, l’une de ses premières pièces, La Marche des jongleurs, est montée par Jacques Polieri.
Par la suite, Isou poursuit ses découvertes dans les domaines de la psychologie, des sciences, du droit, des mathématiques… En 1956 il crée un nouveau territoire : l’art infinitésimal ou imaginaire. L’œuvre de toute sa vie, La créatique ou la Novatique (1941-1976), où s’expriment sa vision et sa méthode de création, est publiée en 2003.
proches de l’expressionnisme, deux PEINTRES DE L’ÉCRITURE
Christian Dotremont et Cy Twombly sont deux peintres qui, chacun avec sa force intérieure, font de la lettre un prolongement sensible de leurs sensations, de leurs ressentis ou de leur inconscient. Le premier est d'abord poète avant de devenir peintre, le second peintre épris de culture et de mythologie.
D'autres peintres auraient pu être évoqués ici, en lien avec ce thème des « peintres de l'écriture ». Henri Michaux par exemple qui, d'abord poète, vit dans l'oubli du mot et de sa signification, la libération de la ligne et « la révélation de l'Ailleurs », ou Bernard Réquichot, inventeur de fausses lettres en écriture illisible.
christian DOTREMONT, sur les traces du grand nord
1922, Tervuren – 1979, Beuzingen (Belgique)
« La vraie poésie est celle où l’écriture à son mot à dire »
Je, quel drôle de mot..., 1975
Logogramme
Encre de Chine sur papier de Chine, 65,5 x 51,5 cm
Texte transcrit à la mine graphite
Le Centre Pompidou organisait en 2011 une exposition des logogrammes de Christian Dotremont à l’occasion d’un don fait au Musée de quatorze d’entre eux par Micky et Pierre Alechinsky. Ce fut, pour une grande part du public, une découverte de voir ces calligraphies à la fois sauvages et maîtrisées par la main d’un poète devenu peintre.
Car, pour Dotremont, « la vraie poésie est celle où l’écriture à son mot à dire ». Ayant rejoint le mouvement surréaliste dès 1940 − il a 18 ans −, l’inconscient et le geste, comme outils de dévoilement, font pour lui partie du processus de création. Ainsi définit-il le logogramme : « le texte, non préétabli, est tracé avec une extrême spontanéité, sans souci de proportions, de la régularité ordinaire, les lettres s’agglomérant, se distendant et donc sans souci de lisibilité ».
Ce n’est donc qu’après coup que le texte est retracé sous le logogramme, puisqu’il ne préexiste pas à la peinture : « en très petites lettres lisibles, calligraphiques », précise le poète-peintre, « il s’agit de faire jouer aussi réciproquement que possible, bien davantage que dans l’écriture créatrice habituelle, l’imagination poétique, prosaïque, verbale, et l’imagination graphique, matérielle. » Les lettres s’étirent, se chevauchent, reconquièrent une valeur plastique que l’imprimerie leur avait fait perdre.
À la vivacité du trait, il allie la respiration de la page blanche, révélation survenue lors de ses voyages en Laponie. Chacun de ses logogrammes est un poème, un message où il met en scène sa vie, ses amours, sa maladie, l’acte même d’écrire, comme dans Je, quel drôle de mot... une interrogation sur l’identité et la création :
je, quel drôle de mot / nécessaire pour commencer / à cesser à tour de drôle / d'être jeu seulement de moi / nécessaire pour commencer / à jouer notre va-tout
Biographie
En 1940, le jeune écrivain et poète Christian Dotremont rejoint le groupe surréaliste belge dont René Magritte est le chef de file, puis, l’année suivante, il rencontre à Paris Paul Éluard et Pablo Picasso. En 1948, il fonde avec les peintres Asger Jorn et Karel Appel, entre autres, le groupe Cobra, nom qu’il invente à partir des premières lettres des villes où résident la plupart des membres du groupe, Copenhague, Bruxelles et Amsterdam.
En s’éloignant de Paris, la capitale de l’art moderne, les membres de Cobra veulent renouer avec les traditions populaires, l’art primitif ; ils s’intéressent aux dessins d’enfants et de fous, s’inspirent de la calligraphie orientale. Christian Dotremont « réalise » alors ses premières « peintures-mots », œuvres à deux pinceaux, notamment avec Pierre Alechinsky. En 1951, il est diagnostiqué tuberculeux, de même que Jorn ; l’aventure collective de Cobra se termine mais que n’oubliera aucun de ses membres.
Après un roman autobiographique, La pierre et l’oreiller, il effectue en 1956 son premier voyage en Laponie, dans le Grand Nord, immense page blanche sur laquelle la nature « écrit » ses signes − arbres, branches, tapis de lichen, traces et empreintes de traîneaux et de rennes − dont il va s’inspirer. Aux logogrammes commencés en 1962, succèdent les logoneiges et les logoglaces, des logogrammes réalisés au cœur du pays lapon, dont des photographies gardent le témoignage. En 1972, il représente avec Pierre Alechinsky la Belgique à la Biennale de Venise.
Cy Twombly, l’expression du corps
1928, Lexington (États-Unis) – 2011, Rome (Italie)
Twombly : « Un écrivain qui accéderait au graffiti, de plein droit et au vu de tout le monde » (R.B.)
Achilles Mourning the Death of Patroclus
[Achille pleurant la mort de Patrocle], 1962
Huile, mine de plomb sur toile, 259 x 302 cm
Après avoir côtoyé tous ceux qui, aux États-Unis, allaient renouveler l’art de la seconde moitié du 20e siècle, Cy Twombly s’installe en Italie en 1957. La littérature et les grandes figures de la mythologie gréco-romaine deviennent ses sujets d’inspiration, le thème de la mort et l’épopée homérique apparaissant dans son œuvre en 1961, épopée à laquelle se rattache Achilles Mourning the Death of Patroclus. Cette œuvre, exécutée alors qu’il a 34 ans, témoigne de la maturité d’expression acquise par l’artiste.
Ici, Twombly s’inspire de la scène de L’Iliade qui suit le chant XVI. Muni des armes d’Achille, qui s’est retiré dans sa tente à la suite d’un désaccord avec le roi Agamemnon, Patrocle a repoussé les assauts des Troyens. Hector, fils de Priam roi de Troie, le prend pour Achille et le tue. Devant le corps sans vie ramené au camp grec, Achille donne libre court à son désespoir.
La mythologie a souvent été le support de la peinture classique. Au 20e siècle, elle n’est plus le soutien d’une représentation, hormis chez quelques peintres comme Gérard Garouste. Mais sa présence reste vivace dans l’imaginaire de ceux qui s’intéressent aux passions humaines et plus encore chez Twombly qui a élu l’Italie comme une terre promise.
En dehors de toute représentation, c’est avec une économie de moyens qu’il restitue la violence du sentiment d’Achille. Deux taches couleur de sang, peintes avec les mains, surplombent un espace vide, blanc, presque blafard, situé entre ciel et terre qu’indique une frêle ligne d’horizon tracée à la mine de plomb. Sur le sol sont écrits quelques mots : Achilles Mourning the Death of Patroclus, ces mots qui, précisément ici, nous intéressent. Comme griffés sur le sol, ils semblent indiquer là où est le corps de Patrocle. Mots allusifs qui insufflent son sens à ce vaste espace.
Toute l’œuvre de Twombly est à relier à une expérience physique de l’écriture. Ici, lisible et transportant du sens, elle est allusive, en appelle à notre culture. En d’autres circonstances, elle est gribouillage, proche du dessin d’enfant, graffiti, écriture automatique ou ratures. « L’œuvre de TW […], écrit Roland Barthes, c’est de l’écriture ; ça a quelque rapport avec la calligraphie. Ce rapport pourtant, n’est ni d’imitation, ni d’inspiration ; une toile de TW, c’est seulement ce que l’on pourrait appeler le champ allusif de l’écriture (l’allusion, figure de rhétorique, consiste à dire une chose avec l’intention d’en faire entendre une autre). TW fait référence à l’écriture (comme il le fait souvent, aussi, à la culture, à travers des mots : Virgil, Sesostris), et puis il s’en va ailleurs. Où ? Précisément loin de la calligraphie, c’est-à-dire de l’écriture formée, dessinée, appuyée, moulée, de ce qu’on appelait au XVIIIe siècle la belle main. TW dit à sa manière que l’essence de l’écriture, ce n’est ni une forme ni un usage, mais seulement un geste, le geste qui la produit en la laissant trainer : un brouillis, presque une salissure, une négligence. »21
On lira avec passion les textes écrits par Barthes sur le peintre, voyant en lui, selon son propre aveu, ce qu’il ne pouvait pas être : « un écrivain qui accéderait au graffiti, de plein droit et au vu de tout le monde ».
Biographie
Cy Twombly étudie à l’Art Students League (New York) avant de connaître, grâce à Robert Rauschenberg, l’enseignement novateur du Black Mountain College, où il rencontre John Cage, Merce Cunningham, Motherwell, … et découvre l’action painting et l’automatisme. Avec Rauschenberg, il voyage en Europe (Espagne, Italie, France) et en Afrique du Nord. De retour à New York, il se lie avec Jasper Johns. En 1957, il s’installe en Italie, terre de mythologies, où il restera jusqu’à sa mort.
Dès les débuts des années 1960, sa personnalité artistique s’affirme. La Biennale de Venise l’invite en 1964 − elle lui décernera un Lion d’or en 2001... Sa première rétrospective est organisée en 1968 par le Centre d’arts du Milwaukee. En 1977 et 1982, il participe à la documenta de Cassel. 1987, Harald Szeemann organise au Kunsthaus de Zurich une rétrospective de ses peintures, sculptures et dessins, présentée ensuite à Madrid, Londres, Düsseldorf et au Centre Pompidou en France. En 1994, c’est au MoMA d’honorer son œuvre. L’année suivante, Dominique de Ménil fonde la Cy Twombly Gallery à Houston, un musée construit par Renzo Piano d’après les plans de l’artiste et qui abrite une collection permanente de ses œuvres.
En 2004, le Centre Pompidou à nouveau l’invite pour Cinquante années de dessins… Son plafond de 400 m2 réalisé pour le salon des Bronzes au 1er étage de l'aile Sully du Louvre est inauguré en 2010. Sur ce plafond d’un bleu Giotto, sont peints une quarantaine de cercles représentant des boucliers antiques ainsi que le nom de sept sculpteurs de l'Antiquité grecque : Céphisodote, Lysippe, Myron, Phidias, Polyclète, Praxitèle, Scopas.
Continuateur de l’expressionnisme américain, Twombly l’est de manière radicalement renouvelée préférant, au geste héroïque d’un Pollock, un geste qui joue du gribouillage, de la trace écrite, de la mémoire et, à l’horizontalité de l’action painting, la verticalité de l’espace pictural. Travaillant par série, son œuvre n’a cessé d’évoluer, de créer de nouveaux motifs. Artiste de l’écriture − en France, Roland Barthes, Philippe Sollers, Marcelin Pleynet ont écrit sur lui −, Twombly l’est aussi de la couleur, une couleur de plus en plus chatoyante à partir des années 1990.
Voir sur le site de la Menil Collection, la Cy Twombly Gallery.
Comme un fleuve qui coule…
Regards de l'enfance, si particuliers, riches de ne pas encore savoir, riches d'étendue, de désert, grands de nescience, comme un fleuve qui coule (l'adulte a vendu l'étendue pour le repérage), regards qui ne sont pas encore liés, denses de tout ce qui leur échappe, étoffés par l'encore indéchiffré. […] Âge des questions. « Pourquoi y a-t-il tant de jours ? Où vont les nuits ? Pourquoi y a-t-il constamment des choses ? Pourquoi suis-je moi et non pas lui ? Pourquoi est-ce Dieu qui est Dieu ? » Âge d'or des questions et c'est de réponses que l'homme meurt […] Première tête dessinée par l'enfant, si légère, d'une si fine charpente ! Quatre menus fils, un trait qui ailleurs sera jambe ou bras ou mât de navire, ovale qui est bouche comme œil, et ce signe, c'est la tentative la plus jeune et la plus vieille de l'humanité, celle d'une langue idéographique, la seule langue vraiment universelle que chaque enfant partout réinvente. Louis XIII, à 8 ans, fait un dessin semblable à celui que fait le fils d'un cannibale calédonien. À 8 ans, il a l'âge de l'humanité, il a au moins deux cent cinquante mille ans. Quelques années après il les a perdus, il n'a plus que 31 ans, il est devenu un individu, il n'est plus qu'un roi de France, impasse dont il ne sortit jamais. Qu'est-ce qui est pire que d'être achevé ?
Henri Michaux, Passages, 1950
Fluxus, l’écriture et la vie
Dans les années 1960, que ce soit dans le Pop’art (Andy Warhol et ses Boîtes de Savon Brillo, 1964, ou Roy Lichtenstein avec ses séries inspirées des Comics, par exemple), le Nouveau réalisme (César et sa compression Ricard, 1962…), la Nouvelle figuration (Télémaque, My Darling Clementine, 1963…), l’Arte povera (Mario Merz et son Igloo de Giap, 1968…), les mots font désormais partie de l’œuvre, le plus souvent déjà présents sur l’objet extrait du réel qu’elle utilise.
Chez Fluxus, intégrée au quotidien, l’écriture est un médium parmi d’autres qui permet de passer de la vie à l’art et de l’art à la vie.
Ben, la sÉrie des « introspections »
(Benjamin Vautier, dit Ben) - 1935, Naples (Italie)
Comme une leçon de morale sur un tableau noir
Ben, Mon envie d'être le seul, 1976
Peinture de la série Introspections
Acrylique sur toile, 100,2 x 100,5 x 4,7 cm
Dans cette aventure de la lettre et de l’image, il serait impossible d’oublier Ben, Ben partout présent dans les boutiques de cartes postales, Ben et ses newletters, Ben qui colonise tout en apposant sa signature, Ben qui ne pense qu’à lui : « Moi seul j’existe ».
Mon envie d’être le seul, autre formulation de « Moi seul j’existe », fait partie des Introspections, série d’aphorismes qui interrogent l’art, la pratique artistique et la condition humaine. Exceptionnellement, cette toile montre un lettrage peint par un professionnel et la couleur des caractères est rouge au lieu d’être blanche. Peut-être le rouge du désir ou de la concupiscence.
Entre naïveté, réalité crue, ironie, décalage, les mots de Ben occupent tout l’espace de la toile comme une leçon de morale sur un tableau d’école.
Biographie
Artiste français d'origine suisse, né à Naples, Ben vit et travaille à Nice. Fin des années 1950, proche des idées de Marcel Duchamp, il fait de son petit magasin de brocante un lieu d’expositions et de rencontres avec de jeunes artistes. C’est au contact de ces futurs ténors du Nouveau réalisme et de Supports/surfaces qu’il définit ce qui lui parait être les critères de reconnaissance d’une d’œuvre : la nouveauté et l’exaltation de l’ego.
En 1962, invité par Daniel Spoerri à la « Misfit’s Fair » de Londres, où il vit pendant deux semaines dans la vitrine de la galerie One, il rencontre Robert Filliou et George Maciunas, l’organisateur, galeriste et éditeur de Fluxus qui l’invite à rejoindre le mouvement. Il en devient un ardent défenseur à travers des performances, des actions de rue telles que se planter devant les passants avec un panneau : « regardez-moi cela suffit ». Entre 1960 et 1963 la notion d’« appropriation » domine son travail, faisant de sa signature la certification de tout objet en œuvre d’art. Il s’intéresse également au théâtre.
Outre l’organisation de festivals, de débats destinés à soutenir de jeunes artistes − au début des années 1980 il rencontre Robert Combas, Di Rosa, François Boisrond, etc. et baptise leur mouvement Figuration libre −, il peint des aphorismes, crée des objets, des sculptures, des installations.
Dans des billets publiés dans des revues ou sur son site internet, il révèle les ragots du monde de l’art contemporain et donne son point de vue sur l‘actualité culturelle. Se tournant vers un art « sans objet », il s’investit dans la lutte pour la reconnaissance des cultures ethniques et soutient la liste Europe Écologie en 2010 pour les élections régionales en région PACA.
Mark Brusse, du « souvenir » À la « valeur historique »
1937, Alkmaar (Pays-Bas)
Sur un principe de réalisation collective
Mark Brusse, Double relief in 18 colors, New York, 1966-1967
Relief mural
Artistes : Karel Appel, Arman, Denise Brusse Koppelman, Mark Brusse, Pol Bury, Erro, Robert Filliou, Al Hansen, Ray Johnson, Alison Knowles, Yayoi Kusama, Marta Minujin, Nam June Paik, Lil Picard, Carolee Schneeman, Daniel Spoerri, M. Strider, Emmett Williams.
Bois, métal, marqueur, peinture, vernis, 86 x 145,5 x 13 cm
Dimensions de chaque petit panneau : 20 x 29 x 1,7 cm
Basé sur un principe de réalisation collective, Double relief est constitué de panneaux de bois sur lesquels différents artistes (18 selon le titre, mais tous les panneaux ne sont pas exposés simultanément) ont écrit le nom de leur couleur préférée avec leur signature et la date de leur intervention. Les premières contributions, effectuées à New York, sont de Robert Filliou − Smog, 6 décembre 1966 −, Arman − Transparent, 8 décembre 1966 −, Marta Minujin, figure historique du happening en Argentine − TV Blue, 9 décembre 1966 −, les dernières de Daniel Spoerri − Bélier-Scorpion Rouge, 18 décembre 1974 − et Erró − The Color of Pain, 28 novembre 2001 −, programmées dès l’origine.
À l’occasion de l’exposition Paris-New York, organisée en 1977, qui voulait montrer le rôle des échanges entre la France et les États-Unis dans le développement de l’art moderne à partir de 1905, Pontus Hulten, alors directeur du Musée national d’art moderne et commissaire de la manifestation, avait sollicité Mark Brusse pour le prêt de cette œuvre.22 En 2001, le Musée, souhaitant acquérir ce témoignage historique de l’avant-garde de la création dans les années 1960, lui envoie un questionnaire pour la documenter. Comme le précise Brusse dans ses réponses, ce relief a été réalisé pendant son séjour à New York entre 1965 et 1967. La sélection des artistes a été « plutôt hasardeuse. La liaison était l’amitié. » Emportant « le petit panneau préparé d’avance, un ‘permanent marker’ (feutre noir) […] l’artiste […] n’avait qu’à noter la couleur et signer au dos. » La pièce, ajoute-t-il, a été fabriquée en pin, un bois « très courant en Amérique pour la construction – étagères, caisses, etc. » Bien que celui-ci soit unique, trois autres types de panneaux-reliefs ont été réalisés sur le même principe.
Brusse n’a alors pas vraiment l’intention de réaliser une œuvre, c’était, « au début, plutôt un effort de communication, [pour] sortir de l’isolement de l’atelier. Avec l’idée en tête qu’une simple notation de couleur donne au spectateur plus de possibilités d’interprétation qu’un objet peint. » Ce relief était resté dans sa collection personnelle, y voyant avant tout de « bons souvenirs », jusqu’à ce qu’il prenne une « valeur […] historique avec les années ».
Dans l’accrochage actuel, Double relief côtoie le grand panneau de Robert Filliou, Principe d’équivalence. Bien fait, mal fait, pas fait, 1968, et Three Arrangements, 1962-1973, de George Brecht (des objets sur une étagère et des vêtements sur un porte-manteau). Avec Double relief, Fluxus propose un autre exemple de cette transformation de la vie en art.
Biographie
Hollandais de naissance, Mark Brusse s’installe en France en 1961 où il côtoie les surréalistes puis les nouveaux réalistes réunis autour de Pierre Restany. Proche de Daniel Spoerri et de Raymond Hains, il n’est pas pour autant membre du groupe. Ses assemblages réalisés à l’époque, faits de bois de récupération et de métaux trouvés dans la rue, ressemblent davantage à « des objets non identifiés » qu’aux objets réels détournés du Nouveau réalisme.
En 1965, à New York grâce à une bourse, il entre en relation avec les membres de Fluxus, il participe à des happenings, collabore avec le musicien John Cage. Crée ses premières installations, des volumes en bois qui peuvent remplir l’espace et bloquer l’accès aux salles (comme dans son installation pour la Kunsthalle de Berne, 1968). Puis il est à Berlin de 1970 à 1972, avant de revenir à Paris où il crée à nouveau des assemblages, petits ou grands, sur socle ou suspendus, avec les matériaux les plus divers.
Curieux du monde, il repart pour de longs séjours au Japon et à partir de 1987 en Corée du Sud. « J’ai toujours été fortement attiré par l’idée d’être quelque part un étranger », avoue-t-il. Ses sculptures, en bois brut badigeonné de blanc pur, souvent de grand format, composent alors une réflexion sur le monde et la vie (The White Moment, 2001 ; The Shape of Silence, 2003). La peinture occupe une place importante dans son œuvre depuis quelques années.
Depuis le début des années 1960, Mark Brusse a participé à de nombreuses manifestations. En 1969, il représente la France à la Biennale de Paris, en 1975 l’Arc au Musée d’art moderne de la Ville de Paris lui consacre une exposition, il est présent la même année à la Biennale de Venise, plus tard il participe à l’Olympiade de l’Art à Séoul, au Symposium de Sculpture à Dacca au Bangladesh…. « Quelque chose d’une quiétude sauvée est à l’œuvre chez Mark Brusse qui instruit la pensée d’une sagesse tout à la fois humble et surprenante. Entre la fable et la philosophie, l’artiste a su se frayer un chemin propre, à l’écart des tracés à la mode. » (Philippe ¨Piguet.)23
l’art, entre concept critique et poÉsie
Pour les artistes conceptuels, à partir du milieu des années 1960, dont Joseph Kosuth est un des chefs de file (voir, dans les collections, son installation One and Three Chairs)24, l’idée doit préexister à l’œuvre. L’artiste a, avant tout, pour tâche d’analyser « ce qui permet à l’art d’être art ». D’où l’importance accordée au mot, organe de conceptualisation et de consignation.25
D’abord simple proposition linguistique, l’œuvre peut, ou non, être réalisée. Réalisée, elle peut l’être par l’artiste ou par un tiers. Dans ce cas, elle peut aussi être traduite, comme Stones + Stones. 2 + 2 = 4, 1987 de Lawrence Weiner qui devient, sur les murs du Musée national d’art moderne, Pierres + Pierres. 2 + 2 = 4. Chez Sol LeWitt, elle est la mise en place, toujours par un tiers, d’un principe de formes répétables, ainsi ses structures modulaires ou ses Wall Drawings26.
Tout en intégrant ces principes de base concernant le statut de l’art, la nature de l’œuvre, la notion de créateur, certains artistes échappent à la rigueur du vocabulaire conceptuel, comme Marcel Broodthaers, Alighiero e Boetti, Ed Ruscha ou Jan Mančuška par la poésie et l’humour.
Marcel Broodthaers, un admirateur de mallarmÉ et de magritte
1924, Saint-Gilles (Belgique) − 1976, Cologne (République fédérale d'Allemagne)
« Pour moi, le cinéma est simplement une extension du langage » (M.B.)
La Pluie (projet pour un texte), 1969
Film cinématographique 16 mm noir et blanc, silencieux
Durée: 2'37"
Marcel Broodthaers a déjà produit quelques films quand il se déclare, en 1964, plasticien. En une vingtaine d’années, il en aura produit une cinquantaine, bien qu’il refuse de se dire cinéaste, affirmant : « Pour moi, le cinéma est simplement une extension du langage ».
Son premier film, La Clef de l’horloge est un poème cinématographique tourné en l'honneur de Kurt Schwitters, avec une pellicule périmée, à l’occasion d’une exposition du « vieux » Merz au Palais des Beaux-arts de Bruxelles en 1957-58. Dans ce court métrage, il interroge la notion d’œuvre d’art, son processus de création et son statut.
Cinéphile averti, les grandes figures du cinéma classique, Charlie Chaplin, Buster Keaton ou Orson Welles, l’inspirent. Ainsi, dans la Pluie (projet pour un texte), film muet de 2’37’’, Broodthaers réalise, avec une pellicule qui rappelle elle aussi l’usure des vieilles images cinématographiques, une sorte d’autoportrait à la Buster Keaton. Assis devant une caisse basse qui lui sert de table, dans une cour dont on lit sur un des murs « Département des Aigles » − il s’agit de son Musée d’Art Moderne créé l’année précédente −, on le voit rédiger un texte quand, soudain, la pluie se met à tomber. Sous les trombes d’eau, poursuivant son geste, plus rien ne s’inscrit sur la page, l’eau effaçant tout pour ne laisser que des flaques colorées par l’encre noire.
Mais, dans les dernières secondes du film, la caméra se rapproche de la page blanche, nous montrant que l’artiste n’écrit pas des mots mais trace un simple artefact de lignes. Nous avons été leurrés par notre propre interprétation de l’image ! Ce film serait une métaphore de la parole du poète et du flux de la pensée qui ne se fige jamais.
Voir le film La Pluie (projet pour un texte), 1969 sur You tube.
Biographie
D’abord libraire, journaliste, critique d’art, poète, admirateur de Mallarmé et de Magritte qu’il rencontre dès 1940, Marcel Broodthaers a 40 ans quand il se « vend » aux arts plastiques. Sa première exposition, organisée à Bruxelles en 1964, s’intitule : « Moi, aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. […] l’idée enfin d’inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit et je me mis aussitôt au travail ». Il y expose, notamment, une sculpture constituée de cinquante exemplaires de son recueil de poèmes, Pense-Bête, plâtrés à moitié. « Aucun, dira-t-il plus tard, n’aura la curiosité du texte ». Ne voyant rien d’autre que : « Tiens des livres dans du plâtre » !27
Dès lors, ses œuvres, où se mêlent humour et absurde, sont l’expression de son jugement critique sur les notions d’œuvre, d’art et de musée. Qualifié de « conceptuel », Broodthaers traduit néanmoins ses idées par le biais d’objets, volontairement insignifiants, d’images et de dessins ironiques, de plaques de plastique thermoformé, de livres, de photographies, de textes ou de courts films, où les mots vont et viennent.
De 1964 à 1970, Broodthaers réalise des assemblages et des accumulations avec des matériaux naturels − ce qui suscite l’intérêt de Pierre Restany. Il utilise, notamment, des coquilles d'œufs − Peinture à l’œuf Peinture à l’œuf, Je retourne à la matière Je retrouve la tradition des primitifs, 1966, titre de l’une de ses œuvres ; vous l’aurez compris : il y a là une allusion à la peinture à l’œuf, technique d'usage courant jusqu'à la fin du 15e siècle avant d’être remplacée par la peinture à l'huile.
Il utilise aussi des moules vides − jouant de l’homonymie du mot moule, la moule, plat belge traditionnel, et le moule, creuset destiné à la répétition d’une forme. « La moule est à elle-même son propre moule et son propre modèle. Elle est parfaite », écrit-il.
Mais les œufs (qui ne sont plus que des coquilles) et les moules étant vides, nous sommes devant deux formes sans contenu, et pas loin de la Querelle des universaux de Magritte.
En 1968, il crée dans son appartement à Bruxelles le Musée d'Art Moderne – Département des Aigles, un musée fictif qui constitue une réflexion critique et ironique sur l’art, ses théories et ses institutions, dont il se nomme « conservateur ». Des caisses vides y sont présentées, « portant des indications de galeries, des marques d’envoi et de destination », ainsi qu’« une série de cartes postales regrandissant Ingres, David, Meissonnier, etc. ».
De 1972 à 1973, parmi ses productions critiques, figure une série de Peintures littéraires consacrée à des écrivains, des poètes ou des peintres, peintures aux allures de rébus, où les œuvres se résument à quelques mots et à un nom, tels ces neuf panneaux intitulés Petrus-Paulus Rubens, 1973 (œuvre appartenant aux collections du Musée).28
Pour Marcel Broodthaers, Mallarmé est « à la source de l’art contemporain ». Son hommage, réalisé en 1969 à partir du poème Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, au titre éponyme, remplace mots et phrases par de simples lignes grises de la longueur et de la hauteur de la typographie d’origine.
À écouter sur Arte radio
Marcel Broodthaers : entretien avec un chat (4’54’’). « Ceci est une pipe ».
Alighiero e Boetti, utilisateur et crÉateur de codes et d’alphabets
1940, Turin (Italie) – 1994, Rome (Italie)
La qualité du travail ne doit rien à la « sacro » main de l’artiste
Au premier abord, une multitude de formes abstraites et colorées s’enchevêtrent les unes dans les autres. À y regarder de plus près, des silhouettes humaines, des animaux, là un dromadaire, là un oiseau, des objets : bonbon, peigne, marteau… apparaissent, et puis des lettres, des lettres qui, parfois, forment un mot. Au fur et à mesure de notre observation, les couleurs sont de plus en plus intenses, les formes se précisent, qui se côtoient sans laisser aucun interstice entre elles, comme un puzzle. Tout un monde sature cette surface dont on perçoit enfin la matière : des fils de couleur, cousus très serrés.
Alighiero e Boetti, Tutto [Tout], 1987
Broderie réalisée à Peshawar, sur commande de l'artiste,
par des afghanes réfugiées au Pakistan
Broderie à la main sur lin, 174 x 251 cm
C’est en effet de la broderie. En 1971, à l’occasion d’un voyage en Afghanistan, Boetti découvre les pratiques artisanales et ancestrales de cette région. Quelques années plus tard, l’invasion soviétique rend impossible ses séjours à Kaboul. Il décide de retrouver les familles réfugiées au Pakistan et leur confie le tissage de motifs, conçus par lui et son assistant, à partir de découpes de journaux et de magazines, d’où ce mélange de lettres et d’images. Pas moins de 84 couleurs sont ici utilisées, avec la même quantité de fil par couleur.
Tutto fait partie d’une série dont certaines pièces ont demandé cinq ans de réalisation. Les principales idées de l’artiste sont ici présentes : le concept comme point de départ de l’œuvre, le « collectif » pour sa réalisation mais aussi l’arbitraire de la règle : une même quantité de fil par couleur, auxquelles s’ajoutent le goût pour le jeu et la force visuelle de la couleur.
Le Musée national d’art moderne possède trois œuvres d’Alighiero e Boetti, chacune à sa manière jouant avec des mots, le temps et l’histoire humaine. Dans Sans titre (Vers le sud…) [Senza titolo, (Verso Sud…)], 1968, sorte de monolithe et de vestige antique, en fait un panneau de bois recouvert d’un enduit gris, on lit : Verso Sud l'ultimo dei paesi abitati è l'Arabia. C’est par ces mots que les Histoires d’Hérodote − père de l’histoire et de la géographie au 5e siècle avant J.C. −, commencent à relater « les grands exploits accomplis soit par les Grecs, soit par les Barbares, [afin qu’ils] ne tombent pas dans l'oubli ». Mais ici dans l’œuvre de Boetti, ils se sont enlisés dans la matière, jusqu’à disparaître.
Biographie
Peintre autodidacte, après une première exposition personnelle où il présente des sculptures faites de juxtaposition ou d’empilement de matériaux, Alighiero Boetti participe, avec Mario Merz, Jannis Kounellis, Luciano Fabro, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, à la première exposition du mouvement Arte povera à Gênes, en 1967. Sous l’égide du critique d’art Germano Celant, ces artistes, inscrits dans l’utopie contestataire de la fin des années 1960, privilégient le geste créateur sur l’objet fini, défiant l’industrie culturelle et la société de consommation.
Puis Boetti est apparenté au mouvement conceptuel (ainsi son classement des Mille fleuves les plus longs du monde, 1970-1973). S'interrogeant sur les personnalités qui constituent un même individu, il ajoute entre son prénom et son nom un « e » (« et » en français), Alighiero e Boetti.
Progressivement, en utilisant des supports variés − tapisseries, broderies, enveloppes −, ou d’autres plus classiques − dessins, sculptures, panneaux… −, son travail se concentre sur l’écriture, les codes et les divers systèmes de signes (alphabets, symboles cartographiques, chiffres..), voire, en invente d’autres dont la clé peut se trouver à l’intérieur de l’œuvre mais aussi à l’extérieur (déposée chez un notaire, par exemple).
Ses voyages au Guatemala puis en Afghanistan, dont il admire les savoir-faire traditionnels, le conduisent à confier la réalisation de ses broderies et de ses tapisseries à des femmes « qui ont en la matière une longue tradition culturelle » (A. e B.). Ainsi sa série de planisphères, Mappa, commencée en 1971 et réalisée jusqu’à la fin de sa vie − une description du monde à partir des drapeaux brodés des nations, modifiés selon le cours des événements politiques − ou ses Tutto, dont le Musée national d’art moderne possède une des versions. Ce qui l’intéresse est la qualité du travail qui ne doit rien à la « sacro » main de l’artiste.
Pour en savoir plus sur l’artiste, consulter le site de la fondation Alighiero e Boetti.
Ed Ruscha, un « regardeur de mots
1937, Omaha (Nebraska, États-Unis)
Des ready-written
Edward Ruscha, Industrial Strength Sleep, 1989
Peinture acrylique et vernis sur toile, 150 x 369,5 cm
Sur fond de nuages épais, dans une trouée de lumière éblouissante, apparaît en lettres capitales et blanches : Industrial Strength Sleep. Par ses dimensions et son horizontalité, la toile évoque un écran cinématographique, et ces mots un générique annonçant une épopée filmique. Par son cadrage rapproché et les grains noirs et blancs de la toile, elle suggère aussi une photographie. Tout juste si l’on ne s’attend pas à quelques coups de tonnerre. Mais non, il s’agit de « sommeil », d’un sommeil à toute épreuve, indique le titre.
Face à ces mots, comme suspendus dans le vide, naît chez le spectateur une impression d’étrangeté. Ce serait précisément cette sensation de vide que recherche l’artiste, écrit Michel Gauthier : « Cette peinture, avec les interrogations qu’elle suscite, illustre […] un trait caractéristique de l’art de Ruscha : la recherche de l’impact visuel au bénéfice d’une forme de vacuité signifiante » (catalogue Collection art contemporain, Centre Pompidou).
Pontus Hulten évoque aussi ce vide, mais sur un autre plan : « Ruscha nous laisse en suspens dans le vide pour ce qui concerne l’origine des formules étonnantes tracées sur ses peintures. Les a-t-il rédigées ou trouvées telles quelles ? […] on est en droit de s’interroger. Certaines […] proviennent directement de la rue ou de la station de radio, d’autres sont ‘aidées’ […] »29 − ‘aidées’, un terme employé par Duchamp à propos de certains de ses « ready-made ». En quelque sorte, on serait face à des ready-written !
D’où vient le goût du peintre pour les lettres ? « Ruscha, poursuit Pontus Hulten, s’est orienté vers les lettres, vers les signes, au sein d’un univers de symboles prodigieusement lourds de sens. Tout le monde sait que Los Angeles est une ville où un analphabète aurait le plus grand mal à se repérer […] Ruscha n’aurait pu le rappeler avec plus d’élégance que dans ses grands tableaux de la célèbre enseigne HOLLYWOOD dominant la colline. »
Le peintre resta néanmoins dubitatif devant cette explication mais, plus tard, en donna une autre qui n’exclut pas celle-ci : « Quand j'ai commencé à envisager de devenir artiste, la peinture représentait à mes yeux la dernière des méthodes. Les journaux, les magazines, les livres – les mots, en somme – avaient plus de sens, à mes yeux, que n'importe quelle fichue peinture à l'huile d'un artiste. »30 Conscient d’un monde qui s’offre à nous sur le mode de la lecture, il s’est voulu « un regardeur de mots », en montrer la matérialité visuelle et l’étrangeté originelle.
Industrial Strength Sleep a également donné lieu à un livre (éditions The Fabric Workshop and Museum, Philadelphia), publié quelque vingt ans plus tard, en 2008.
Biographie
Né au Nebraska en 1937, pratiquant le dessin dès son adolescence, Ed Ruscha se rend à Los Angeles en 1956 pour intégrer le Chouinard Art Institute, fondé par Walt Disney. Il veut être illustrateur, le mot « cartooning », expliquera-t-il, exerçant sur lui une forte attraction dès l’âge de 8 ans. Il étudie la photographie sur le plan technique, le graphisme, l’histoire de l’art et la peinture, découvre la photographie d’une Amérique quotidienne avec Eugène Atget, Robert Frank, Walker Evans, et parallèlement Man Ray, Jasper Johns et Robert Rauschenberg qui l’amènent à s’interroger sur la tradition picturale. En 1958 il travaille chez un imprimeur, approfondissant ses connaissances sur la photographie et la lettre. De retour d’un voyage en Europe, il découvre Kurt Schwitters et Marcel Duchamp, autres redresseurs de torts de la tradition picturale.
En 1962, il commence à photographier des stations services. Entre 1963 et 1978, ce n'est pas moins de dix-sept livres de photographies dont Twentysix Gasoline Stations et Building on the Sunset Strip qu’il va publier. De 1965 à 69, il est graphiste-maquettiste pour Artforum. Au début des années 1970, il réalise son premier film. En 1973, autre œuvre mémorable, il photographie en couleurs les 20 kilomètres d’Hollywood Boulevard à Los Angeles (publiée en 2004).
Une « image acoustique »
Très tôt le médium photographique est pour lui un outil idéal pour sélectionner ses sujets, lui fournissant un modèle de facture anonyme pour ses toiles, une pratique du cadrage et du changement d’échelle. « Voir les choses photographiquement a influencé ma manière de penser et de voir » dit-il.
Attiré par l’espace à deux dimensions, avant même l’émergence de l’art conceptuel, il élabore des tableaux où il superpose sur des fonds monochromes des mots (Boulangerie et Métropolitain, deux œuvres de 1961, etc.). L’étape suivante est la recopie sur de grandes toiles, sans aucun effet plastique, des sigles des mythes hollywoodiens ou des génériques de cinéma. Les premiers tableaux comportant une phrase apparaissent en 1973, dans des formats allongés, puis celle-ci se superpose à une image, d’abord schématique avant de représenter des paysages identifiables, suggérant une identité entre mot et horizon. « Nous vivons dans un monde où tout est déjà lu avant de commencer à exister. L’habitude de lire a transformé à travers le siècle l’Homo Sapiens en Homo legens. »
Ce qui l‘intéresse dans le mot ou la phrase n’est pas le sens, mais « le bruit visuel »31 confie-t-il à Bernard Blistène, ce que Jean-Pierre Criqui, en préface aux Vingt-trois entretiens, appelle « une image acoustique ».
Devenu rapidement une figure mythique de l’art contemporain, notamment par ses livres d’artistes et sa position singulière entre Pop’art (par son goût pour montrer la vie et la culture américaines) et art conceptuel (par son intérêt pour les mots et ses questionnements sur les médiums), il est présent dans les plus grands musées : le San Francisco Museum of Modern Art (1982), le Centre Georges Pompidou, Paris (1989), le Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington (2000), le Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid (2002), le Whitney Museum of American Art, New York (2004)… En 2005, il représente les États-Unis à la 51e Biennale de Venise ; l’année suivante la Galerie nationale du Jeu de Paume, Paris, organise une exposition de ses photographies et de ses livres d’artiste. En 2009, la Hayward Gallery, Londres, présente : Ed Ruscha : Fifty Years of Painting.
Jan ManČuŠka, la lettre dans un espace À trois dimensions
1972, Bratislava (Slovaquie) – 2011, Prague (République tchèque)
Jan Mančuška, Oedipus, 2006
Installation, lettrines en aluminium, fil de fer
Hauteur des lettres : 3 cm
Textes en anglais portant sur trois variations d'un épisode
décrivant le rapport entre un personnage et sa mère
Dimensions variables
Tenant de l’art minimal et de l’art conceptuel, les œuvres de Jan Mančuška invitent à découvrir et à expérimenter l’espace, selon des trajectoires qui ne doivent rien au hasard. Ici, le mot et la phrase deviennent le prétexte à explorer un espace à trois dimensions, ce qui est déjà en soi une gageure car rarement ceux-ci sortent d’un support bidimensionnel.
Traversant l’espace, tendues à hauteur des yeux, trois lignes composées d’un chapelet de mots − des lettrines en aluminium de quelques centimètres, posées sur des câbles en acier fixés aux murs de la salle −, invitent le spectateur à suivre trois variations d’un même récit : l’appel téléphonique de Dan, amoureux de Marta, petite amie de son ami qui l’accompagne, et qui, au lieu d’appeler celle-ci, tombe sur sa propre mère. Situation confuse, cocasse, entre Dan, homme timide et ivre, et son ami, qui n’ose pas l’affronter... Dan concluant qu’ « il avait appelé Marta et avait pourtant parlé à sa propre mère » !
Le spectateur doit lire séparément chacune des trois variations, éprouver la direction de l’espace en même temps que la lecture du récit, mais il peut aussi suivre d’autres trajectoires : les trois textes se croisent en trois points en formant un triangle central, encourageant des lectures alternatives. Parallèlement à un travail conceptuel sur le langage comme moyen d’expérimenter l’espace, l’artiste utilise donc également les ressorts de la narration et du mythe parmi les plus anciens sur les relations entre fils et mère.
Biographie
Né en 1972 en Slovaquie, Jan Mančuška fait des études à l’Académie des Beaux-arts de Prague où il obtient son diplôme en 1998. D’abord peintre, il abandonne vite ce mode d’expression pour l’écrit, réalise des films et des installations, ses dernières activités étant liées au théâtre. Son œuvre s’inscrit dans l’héritage conceptuel.
Ses participations à Manifesta 4 (Biennale européenne d’art contemporain organisée à Frankfurt/Main en 2002) et à la 51e Biennale de Venise (en 2005) lui valent d’être remarqué et représenté par la galerie new-yorkaise Andrew Kreps. Dès lors, il est exposé dans de nombreux musées et galeries, en République tchèque, à Berlin, New York, Amsterdam. En France, le Musée d’art moderne de Saint-Etienne l’invite en 2004…
Parmi ses œuvres les plus connues : While I walked…, 2005 (œuvre appartenant aux collections du Frac-Lorraine), où le spectateur retrace les déambulations de l’artiste dans une installation constituée de phrases en aluminium entrecroisées.
Jan Mančuška était considéré comme l’un des artistes contemporains tchèques les plus connus avant que ne survienne sa mort en 2011.
les affichistes, le « lacÉrÉ anonyme »
Jacques VilleglÉ et l’affiche lacérÉe : un rÉpertoire formel sans limite
1926, Quimper
Du « domaine de l’heureusement illisible »
Jacques Villeglé, Tapis Maillot, 1959
Affiches lacérées collées sur papier journal marouflé sur toile, 118 x 490 cm
En 1949, Jacques Villeglé et Raymond Hains prélèvent pour la première fois sur une palissade, près de la Coupole à Montparnasse, de longs morceaux d’une série d’affiches de concerts. Ils vont les réassembler, l’un commençant par la droite, l’autre par la gauche en jouant sur les aplats colorés et les fragments typographiques. À partir de quelques mots déchirés, ils en façonnent le titre : Ach Alma Manetro, Ach provenant du nom de Bach, Alma de l’endroit près duquel se donnait le concert, Manetro étant ce qu’on appelle en typographie un « bourdon », un mixage de mots où quelques lettres se sont égarées.
Tapis Maillot date de février 1959 alors que Villeglé n’intervient plus sur l’organisation des éléments prélevés. Près de la Porte Maillot, il a repéré un ensemble d’affiches de cinémas de quartier, portant des noms de films et de lieux où ils étaient projetés. Le temps faisant, les affiches ont été déchirées, « lacérées » par des mains anonymes, suscitant de nouveaux titres, ou faisant partie, comme le dit Villeglé, du « domaine de l’heureusement illisible, de l’insaisissable mallarméen ».
La première présentation de cette œuvre en juin 1959 se fait chez le plasticien et poète François Dufrêne où sont présentées un ensemble d’affiches lacérées sous l’intitulé « Lacéré anonyme ». L’exposition réunit Villéglé, Dufrêne et Hains et marque la constitution du groupe des Affichistes. L’œuvre de Villeglé est installée au sol, foulée par les visiteurs, ce qui en accentue la lacération, d’où son appellation de tapis, Maillot étant le lieu du prélèvement.
Biographie
Originaire de Bretagne, Jacques Villeglé s’inscrit en 1945 à l’École des Beaux-arts de Rennes où il étudie la peinture puis l’architecture ; il y rencontre Raymond Hains qui, lui, apprend la sculpture et s’intéresse à la photographie. Tous deux se retrouvent, deux ans plus tard, à l’École des Beaux-arts de Nantes. En août 1947, à Saint-Malo, Villeglé récolte des « objets trouvés », des déchets du mur de l’Atlantique, qu’il considère comme des sculptures et qu’il montre à son ami. Ensemble, ils font la tournée des galeries parisiennes, Hains souhaitant exposer ses photographies réalisées avec un objectif de son cru, muni de verres cannelés ; ils rencontrent la galeriste Colette Allendy chez qui Hains réalise une première exposition.
En 1949, Hains et Villeglé récoltent leur première série d’affiches. Puis Hains achète une caméra et Villeglé décide de s’associer à ses projets. Il arrête ses études et s’installe à Paris, prélève épisodiquement des affiches lacérées, invente le concept de « lacérateur anonyme » et réalise avec Hains quelques films, dont Hépérile éclaté d’après un poème phonétique de Camille Bryen.
Il se plonge dans l’actualité culturelle parisienne, assiste aux récitals lettristes de Gil J. Wolman et François Dufrêne qu’il considère comme les « meilleurs diseurs » du mouvement lettriste fondé par Isidore Isou. Grâce à Dufrêne, les deux artistes rencontrent Yves Klein, Pierre Restany, Jean Tinguely et cofondent avec eux, en 1960, le mouvement du Nouveau réalisme.
Le répertoire formel de l’affiche lacérée va se révéler pratiquement sans limite, certaines privilégiant la couleur, d’autres la transparence, le frottement, l’effacement, le froissement, le recouvrement …
Après Mai 1968, Jacques Villeglé fait de nouveaux prélèvements sur les murs du métro parisien : des idéogrammes politiques, croix de Lorraine, croix gammées, croix celtiques, …, qui le conduisent à réaliser « un abécédaire socio-politique ». Puis vient, fin des années 1990, la série des ardoises sur lesquelles il reprend des caractères ou des messages, citations, graffiti, haïkus… tout en poursuivant son travail de « lacéré anonyme » élargi à toute la France.
BIBLIOGRAPHIE
Catalogues d''exposition
- Collection Art contemporain, La collection du Centre Pompidou-Musée national d’art moderne, éditions du Centre Pompidou, 2007
- Collection Art moderne, La collection du Centre Pompidou-Musée national d’art moderne éditions du Centre Pompidou, 2006
- Poésure et peintrie « d’un art, l’autre », Musées de Marseille-Réunion des Musées Nationaux, 1993
- Robert et Sonia Delaunay, le centenaire, Mam VP, Paris/Musées, S.A.M.A.N., 1985
- Picasso – Papiers journaux, par Anne Baldassari, Musée Picasso, 2003
- Dada, éditions du Centre Pompidou, 2000
- Kurt Schwitters, éditions du Centre Pompidou, 1994
- Rétrospective Magritte, Bruxelles, Palais des Beaux-arts, octobre-décembre 1978 ; Paris, Centre Pompidou, janvier-avril 1979
- Christian Dotremont. Logogrammes, éditions du Centre Pompidou, 2011
- Marcel Broodthaers, Galerie nationale du jeu de Paume, 1991
- Cy Twombly. Cinquante années de dessins, éditions Gallimard/Centre Pompidou, 2004
- Catalogue général de l’Œuvre d’Alighiero et Boetti, éditions Electa, établi par l'archivio Alighiero Boetti, sous la direction scientifique de Jean-Christophe Ammann, 2010
- Edward Ruscha, éditions du Centre Pompidou, 1989
- Art & Publicité 1890-1990, éditions du Centre Pompidou, 1991
Textes et entretiens d’artistes
- Marinetti, Les Mots en liberté futuristes, première édition 1919, L’Âge d’homme, 1987
- Miriam Cendrars (texte), Philippe Gauckler (illustrations), Blaise Cendrars, Feux et cendres de la création, éditions Gilou/Alpen Publishers S.A., 1988
- Raoul Hausmann, Courrier Dada, 1958, éditions Eric Losfeld, réédité aux éditions Allia
- Roland Sabatier, Le lettrisme. Les créations et les créateurs, Zéditions, 1989
- Ed Ruscha, Huit textes / Vingt-trois entretiens – 1965-2009, Les Presses du réel, 2011 Edité et préfacé par Jean-Pierre Criqui. Traduit de l'américain par Fabienne Durand-Bogaert
- Jean-Loup Cornilleau, Le Gloussaire portatif, éditions de biais, 2010
Essais
- Massin, La Lettre et l’image. La figuration dans l’alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours, Gallimard, 1970
- Michel Butor, Les Mots dans la peinture, 1969, Skira
- Marc Dachy, Le journal du mouvement dada, Skira, 1990
- Michel Foucault, Ceci n’est pas une pipe, Fata Morgana, 1973
- Roland Sabatier, Le lettrisme. Les créations et les créateurs, Zéditions, 1989
- Roland Barthes, L’Obvie et l’Obtus. Essais critiques III, coll. Tel Quel, éditions du Seuil, 1982
Pour consulter les autres dossiers sur les expositions, les collections du Musée national d'art moderne, l’architecture du Centre Pompidou, les spectacles vivants…
En français ![]()
Contacts
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous souhaiterions connaître vos réactions et suggestions sur ce document
Vous pouvez nous contacter via notre site Internet, rubrique Contact, thème éducation ![]()
Crédits
© Centre Pompidou, Direction des publics, octobre 2012
Texte : Marie-José Rodriguez
Design graphique : Michel Fernandez
Intégration : Cédric Achard
Dossier en ligne sur mediation.centrepompidou.fr/
Coordination : Marie-José Rodriguez, responsable éditoriale des dossiers pédagogiques ![]()
Références
_1 Voir l’ouvrage de Massin, La lettre et l’image. La figuration dans l’alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours, Gallimard, 1970.
_2 Michel Butor, Les Mots dans la peinture, Skira, 1969.
_3 En France, l’école devient obligatoire pour les enfants de 6 à 14 ans en 1882 (loi du 28 mars 1882).
_4 Giovanni Lista, biographe de Marinetti, catalogue Poésure et peintrie, « Entre dynamis et physis ou les mots en liberté du futurisme », Musées de Marseille-Réunion des Musées Nationaux, 1993.
_5 Guillaume Apollinaire, L’Esprit nouveau et les poètes, 1917.
_6 Anne Baldassari, Picasso – Papiers journaux, « Picasso et la presse, une traversée du siècle », Musée Picasso, 2003.
_7 Voir catalogue Robert et Sonia Delaunay. Le centenaire, Paris Musées/ SAMAM, 1985. Danielle Molinari : « L’aptitude à la métamorphose ».
_8 La Tour, in Du monde entier au cœur du monde, « Dix-neuf poèmes élastiques », Denoël, t.I. 1957.
_9 Les Soirées de Paris, 1914, n°26-27.
_10 En janvier 1913, le poète Alexei Kroutchenykh fait paraître les premiers recueils aveniristes illustrés par des lithographies et des collages primitivistes et rayonnismes du peintre Mikhaïl Larionov. En 1916, Natalia Gontcharova illustre Igra v Adou (Jeu en enfer) de Kroutchenykh et Khlebnikov tandis qu’Olga Rozanova collabore avec Kroutchenykh pour la Guerre universelle. Quant à Kasimir Malevitch, il crée en 1913, avec Matiouchine pour la musique et Alexei Kroutchenykh pour le livret, le premier opéra aveniriste Victoire sur le soleil. Néanmoins, selon Marc Dachy, que ce soit à Paris ou un peu plus tard à Zurich, on savait alors peu de chose de l’avenirisme russe (in Journal du mouvement dada).
_11 Ce chapitre consacré à Dada a pour principales sources trois ouvrages : Marc Dachy, Le journal du mouvement dada, Skira, 1990 ; Dada, catalogue, éditions Centre Pompidou, 2000 ; Kurt Schwitters, catalogue, éditions Centre Pompidou, 1994.
_12 Voir l’article consacré à Raoul Hausmann dans le catalogue de l’exposition Dada, éditions Centre Pompidou, 2000.
_13 Raoul Hausmann, Courrier Dada, 1958, édité par Eric Losfeld, réédité aux éditions Allia.
_14 Les Hohenzollern, famille d'origine noble, régnèrent pendant 900 ans, tout d'abord sur de petits territoires puis, au fil des siècles, sur un immense empire s'étendant de la Prusse à la Rhénanie. Guillaume II, dernier Hohenzollern à régner, fut contraint à l'abdication après la Première Guerre mondiale et la proclamation de la République de Weimar en novembre 1918.
_15 Les citations dans ce paragraphe consacré à Schwitters sont extraites du catalogue de l’exposition Kurt Schwitters, 1994, éditions Centre Pompidou.
_16 Sur les rapports de la littérature et des arts plastiques, voir le dossier La Révolution surréaliste.
_17 René Magritte, La ligne de vie, conférence, 1938.
_18 Extrait du Petit journal Herbin, Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis, 2012.
_19 Transformer l’actuelle situation de l’art plastique. Garcia-Rossi, Le Parc, Morellet, Stein, Yvaral du GROUPE DE RECHERCHE D’ART VISUEL. Paris, le 25 octobre 1961. Tract édité à l’occasion de la présentation des recherches du GRAV le 4 novembre 1961.
_20 Roland Sabatier, Le lettrisme. Les créations et les créateurs, Zéditions, 1989.
_21 Roland Barthes, L’obvie et l’obtus. Essais critiques III. Coll. Tel Quel, éditions du Seuil, 1982. Lire également dans ces essais ses textes consacrés à Bernard Réquichot.
_22 Lettre de Pontus Hulten à Mark Brusse, daté du 3 novembre 1976.
_23 Philippe Piguet, Mark Brusse, Sculptures dessins, catalogue d’exposition, Centre d’art contemporain Corbeil-Essonnes, 1992.
_24 One and Three Chairs, de Joseph Kosuth, présente trois degrés distincts d’un même objet : une chaise réelle, sa photographie et sa définition issue du dictionnaire.
_25 Pour en savoir plus sur l’art conceptuel, consulter le dossier pédagogique consacré à ce mouvement.
_26 Sol LeWitt. Dessins muraux de 1968 à 2007, à voir au Centre Pompidou Metz, jusqu’au 29 juillet 2013.
_27 Propos de Marcel Broodthaers, in Marcel Broodthaers, catalogue, Galerie nationale du Jeu de Paume, 1991.
_28 Marcel Broodhaers, Petrus-Paulus Rubens, 1973. Sur sept toiles différentes sont écrits en caractères Dorchester les mots bijoux, armures, femmes, nuages, chiens, fleurs, tapis, autant de motifs picturaux chers à Rubens, et sur une huitième le nom de Pieter Jansz Saenredam, peintre hollandais du 17e siècle, aux antipodes de la peinture fastueuse de Rubens, avec ses sobres vues d’architecture ; le neuvième panneau, en caractères Bodoni, porte le nom de l’artiste flamand et la date de réalisation de l’œuvre : Petrus-Paulus Rubens, 1973.
_29 Pontus Hulten. « Écrire sur le tableau », catalogue Edward Ruscha, éditions Centre Pompidou, 1989.
_30 Ed Ruscha, Huit textes. Vingt-trois entretiens 1965-2009, textes rassemblés par Jean-Pierre Criqui, les Presses du réel, 2011.
_31 Entretien avec Bernard Blistène, in catalogue de l’exposition organisée au Centre Pompidou en 1989.

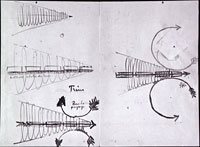


![Pablo Picasso, La Bouteille de vieux marc [printemps 1913]](photos/5-Picasso_200.jpg)


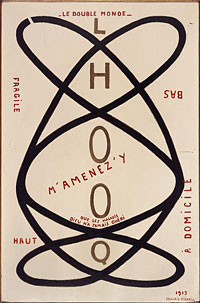












![Alighiero e Boetti, Tutto [Tout], 1987](photos/19_boetti_200.jpg)


